
Amitav Ghosh, romancier et essayiste: «La modernité était essentiellement un projet colonial» (entretien)
La Malédiction de la muscade, le dernier ouvrage du romancier et essayiste Amitav Ghosh, s’ancre dans la colonisation des Bandanais au XVIIe siècle. Un récit qui fait écho à l’exploitation des ressources et à la crise écologique actuelles.
Son nom est quasiment inconnu des francophones. Amitav Ghosh est pourtant une sommité dans son domaine, lu et écouté avec déférence dans le monde anglo-saxon. Il enseigne d’ailleurs la littérature comparée à l’université Queens College de New York et est professeur invité à la prestigieuse université Harvard. Stakhanoviste de l’érudition, ce romancier et essayiste indien d’expression anglaise est l’auteur d’une œuvre kaléidoscopique qui étreint aussi bien les questions de l’identité que le postcolonialisme ou encore la crise climatique. Une pile de distinctions et de prix se déverse sur ses épaules: docteur honoris causa à Paris-Sorbonne, prix Médicis étranger en 1990 pour Les Feux du Bengale, prix Padma Shri du gouvernement indien en 2007 et, récemment encore, en 2024, le tant convoité prix Erasme.
Le grand public l’a découvert à la faveur de la parution, en 2016, du Grand Dérangement, dont la traduction en français est sortie en 2021 (éd. Wildproject), ouvrage qui l’a hissé haut dans le classement des «100 plus grands penseurs du monde» du prestigieux magazine Foreign Policy. Amitav Ghosh s’y interrogeait sur notre incapacité à saisir l’ampleur de la question du changement climatique. Dans le prolongement de celui-ci, il revient aujourd’hui avec La Malédiction de la muscade. Une contre-histoire de la modernité, une série de récits de faits réels qui ont eu lieu lors de la colonisation néerlandaise de l’archipel des Banda au XVIIe siècle mais qui font fortement écho à la crise écologique actuelle.
Votre dernier ouvrage s’intitule La Malédiction de la muscade. A quoi fait référence ce titre assez énigmatique?
L’histoire de la noix de la muscade est au cœur de ce qui s’est passé aux îles Banda au XVIIe siècle, à savoir leur conquête par les Néerlandais. Cet événement est très révélateur de la manière dont la modernité conçoit le monde, aujourd’hui encore. A mon avis, c’est la violence extraordinaire de cette conquête, d’une ampleur sans précédent, et plus généralement des conquêtes du début de la modernité, qui a entraîné l’extinction d’innombrables civilisations florissantes dans les Amériques et en Afrique. Ce sont elles aussi qui ont incité les élites européennes à penser le monde comme une sorte de réservoir inerte de ressources, existant principalement pour être exploité par ceux qui étaient assez puissants pour le faire. On pense généralement que cette vision du monde est le fait d’une conception particulière de la «nature». Personnellement, je crois, au contraire, que ce changement de paradigme et de conception du monde est né, en premier lieu, de conflits spécifiquement humains. C’est le processus de soumission et de conquête des humains qui a permis aux élites européennes d’envisager de faire la même chose avec le monde non humain.
Dans votre livre aussi, vous vous attaquez de manière virulente à l’ère moderne et à ce que vous appelez les «mythes de la modernité». Quelles sont les illusions dans lesquelles celle-ci nous plonge?
Le problème de la modernité est qu’elle prétend offrir un idéal universel auquel tous les êtres humains pourraient aspirer. Cependant, cela n’a jamais été possible, tout simplement parce que la modernité, telle que nous la connaissons, implique l’utilisation d’énormes quantités d’énergie et d’autres «ressources» matérielles – la modernité est donc fondamentalement et substantiellement un processus d’augmentation de l’empreinte carbone de l’humanité. Lorsqu’une petite minorité de la population mondiale – disons le Japon, l’Occident et quelques autres pays – augmentait son empreinte carbone, les effets n’étaient pas aisément perceptibles. Mais une fois que la majorité du monde s’est lancée dans une très légère augmentation de son empreinte carbone par habitant, les effets sont rapidement devenus palpables. Et il est désormais parfaitement clair que si le monde continue sur cette voie, cela entraînera une catastrophe pour l’humanité tout entière. Il est donc évident que la modernité était essentiellement un projet colonial, car pour être viable, il devait présupposer que seule une minorité de la population mondiale puisse en récolter les bénéfices, tandis que la grande majorité devait rester relativement pauvre.
Mais aujourd’hui, après la décolonisation, la configuration géopolitique n’est plus la même…
Depuis la décolonisation, ce modèle est devenu impossible à appliquer: l’Indonésie, le Kenya, etc. ne sont plus disposés à maintenir une empreinte carbone par habitant relativement faible afin que les pays déjà riches puissent maintenir leur empreinte carbone par habitant beaucoup plus grande. C’est cette contradiction essentielle au cœur de la modernité qui pousse aujourd’hui le monde vers le désastre.
«La faculté narrative est la plus animale des capacités humaines.»
Quelles sont les autres illusions que vous reprochez aux récits de la modernité?
Une autre grande illusion de la modernité est l’idée selon laquelle seuls les humains possèdent l’intelligence et la capacité de raconter des histoires. En réalité, nous avons toujours été entourés de nombreuses formes d’intelligence et, dans le monde prémoderne, ainsi que l’ont montré de grands chercheurs comme l’anthropologue Philippe Descola, les gens l’ont parfaitement compris. Les histoires prémodernes sont donc remplies de toutes sortes de non-humains (fantômes, démons, dieux, animaux, plantes) qui parlent et racontent des histoires. Dans un sens, ces voix sont toutes des formes d’intelligence non humaine. L’un de mes principaux arguments, dans La Malédiction de la muscade, est que, loin d’être un attribut exclusivement humain, la faculté narrative est la plus animale des capacités humaines, le produit d’un des traits que les humains partagent incontestablement avec les animaux et bien d’autres êtres…
A propos de ces récits prémodernes qui sollicitent des intelligences non humaines: comment et dans quelle mesure peuvent-ils être une source d’inspiration pour affronter les enjeux contemporains, notamment ceux de l’environnement et de l’écologie?
L’argument central de mon précédent livre, Le Grand Dérangement. D’autres récits à l’ère de la crise climatique, est que le changement climatique, en tant que phénomène, résiste aux techniques de la littérature moderne. Cette idée m’est venue quand j’ai examiné la question de la probabilité et la manière dont elle influence notre compréhension de la littérature. Ainsi, si quelqu’un inclut un événement très improbable dans un roman, la première chose qu’on se dit, en gros, c’est: «Oh! Ce livre est plein d’événements improbables, ça n’a pas de sens, ce n’est pas convaincant.» Bien sûr, tout le problème du changement climatique est qu’il génère des événements improbables: c’est pourquoi on fait tant de titres sur les «tempêtes sans précédent», les «vagues de chaleur sans précédent», etc. Il arrive assez fréquemment maintenant que nous assistions à des choses complètement improbables, comme le réseau électrique en panne au Texas, les tornades à Venise. Ce genre d’invraisemblance est très difficile à intégrer dans le cadre d’un roman. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Dans la littérature prémoderne, toutes sortes d’événements improbables se produisent sans cesse. Cela est certainement vrai de la fiction médiévale indo-iranienne bengali et des histoires médiévales bengalies. Je trouve cela très intéressant. J’ai ainsi commencé à lire des histoires médiévales, des histoires bengalies prémodernes et, à bien des égards, elles confrontent des éléments de l’environnement bien plus directement que les histoires bengalies contemporaines, qui sont formées autour des mêmes types de problèmes que les histoires occidentales contemporaines.
Revenons à votre dernier ouvrage. Vous dites que l’histoire des Bandanais ne devrait plus, curieusement, paraître si éloignée de notre situation actuelle. Dans quelle mesure nous inspire-t-elle dans le monde d’aujourd’hui?
Les Bandanais ont été exterminés parce qu’ils avaient la chance de posséder le muscadier. Ils ont ainsi été parmi les premiers peuples de la planète à subir les conséquences de ce que nous appelons aujourd’hui «la malédiction des ressources». Dans un certain sens, le changement climatique peut être compris comme la mondialisation de la malédiction des ressources. Le monde entier souffre désormais sous cette malédiction.
Cela renvoie à ce que vous appelez la «terraformation», que vous utilisez dans une acception particulière. Qu’entendez-vous par ce terme?
Le mot «terraformation» vient de la science-fiction, il est généralement défini en référence à d’autres planètes. Ceci est intéressant car, bien entendu, la transformation des paysages colonisés (ce qui est exactement ce qu’implique le terme «terraformation») est l’un des aspects les plus importants du colonialisme de peuplement. Cette mission a été explicitement adoptée par les colons anglais, dès le XVIIe siècle: ils voulaient littéralement refaire la Nouvelle-Angleterre à l’image de l’Angleterre. Cela impliquait une transformation complète de l’environnement, dont une partie a été réalisée grâce à des interventions humaines explicites telles que la construction de barrages sur les rivières et l’abattage des forêts. Mais une grande partie de cela a également été accomplie grâce au déploiement d’entités et d’agents non humains, comme le bétail et les agents pathogènes, qui appartenaient à un domaine considéré comme distinct, à savoir la «nature». Les colons savaient parfaitement qu’ils transformaient activement ce qu’ils appelaient la «nature», mais ils s’accrochaient, pour duper tout le monde, à l’idée qu’il s’agissait d’un domaine obéissant à ses propres lois. Cela leur a permis de se dégager de toute responsabilité dans les transformations écologiques provoquées par leur bétail ou par les maladies. Bien sûr, les Amérindiens n’étaient pas dupes, mais pour les colons, l’idée de «nature» comme domaine à part entière était très importante dans leur projet colonial.
Pourquoi, cependant, entend-on peu parler de ce terme dans les débats actuels sur le changement climatique?
Le concept a dû être activement réprimé pour préserver l’efficacité de l’idée de «nature», indépendante et obéissante à ses propres lois. Cette entreprise de censure a été largement réussie. Et ce n’est pas un hasard si le déni du climat est plus fort dans les anciens pays colonisés anglo-saxons. Les négationnistes nient leur responsabilité dans les changements environnementaux mondiaux d’aujourd’hui, à peu près de la même manière que leurs ancêtres.
«Le changement climatique peut être considéré comme une extension des guerres coloniales.»
Comment l’expliquez-vous?
Une grande partie de la conquête a été réalisée grâce au bétail et à des agents pathogènes qui se sont parfois propagés de manière tout à fait délibérée. Et tout cela est très loin d’être terminé. Ces guerres de transformation écologique se poursuivent encore en Amazonie, car l’enjeu est la tentative de transformer l’ensemble de l’Amazonie en une sorte de Midwest. Mais ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est l’effritement de paysages «terraformés». Les régions de l’Amérique du Nord qui ont été le plus largement conçues pour ressembler aux modèles européens sont les plus touchées par le changement climatique. Si vous regardez la Californie, ou le sud du Texas autour de Houston et la majeure partie du delta du Mississippi, ce sont des endroits où le paysage s’effondre littéralement. Il ressort clairement des incendies qui ravagent la Californie que ce qui a été fait à cette terre était en fait une sorte de profonde provocation du paysage. On pourrait en dire autant de l’Australie, à Victoria. De nombreux endroits soumis à la terraformation coloniale sont aujourd’hui dévastés par de terribles vagues de chaleur et des incendies de forêt. Dans un sens, le changement climatique peut être considéré comme une extension des guerres biopolitiques coloniales: il s’agit désormais d’une guerre des riches contre les pauvres.

Qu’entendez-vous par là?
Dans le discours occidental, la crise climatique est presque toujours présentée comme un problème de technologie et d’ingénierie, etc. Mais si vous allez dans les pays du Sud, personne ne voit les choses de cette façon. Il s’agit plutôt d’un conflit entre les riches et les pauvres, un conflit entre des pays qui ont fait un usage excessif des combustibles fossiles pour devenir riches et d’autres dont l’empreinte carbone par habitant est très faible. Dans les pays du Sud, la crise est donc considérée comme un problème géopolitique, comme un problème historique. En Inde, des gens meurent à cause de l’air pollué. Mais si vous leur dites «ne pensez-vous pas que vous devriez réduire votre empreinte carbone?», ils vous répondront: «Pourquoi devrions-nous le faire alors que l’empreinte carbone des pays riches est incommensurablement plus grande que la nôtre? Ils se sont enrichis en nous gardant pauvres, maintenant c’est notre tour de s’enrichir.» C’est ainsi que les choses sont vécues dans ces pays. Il s’agit d’un problème historique et géopolitique, et non d’un problème technologique ou d’ingénierie comme cela est perçu en Occident. Je pense que c’est l’erreur que font beaucoup de soi-disant auteurs de «Climate fiction» lorsqu’ils examinent cette question. Ils le voient essentiellement de la même manière que les scientifiques et les technocrates, à savoir comme un problème à résoudre par l’ingénierie, etc.
En 2016, vous avez publié Le Grand Dérangement, où vous alertiez déjà sur l’urgence climatique. Qu’est-ce qui a changé depuis? A vos yeux, les choses évoluent-elles?
De nombreux changements importants ont eu lieu depuis 2016. La plupart sont dus aux conséquences de plus en plus évidentes du changement climatique. Les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt auxquels nous assistons avec une fréquence toujours croissante, font qu’il est impossible d’ignorer ou de nier l’ampleur du changement climatique. En effet, le phénomène du déni radical et direct s’est transformé en autre chose, en une sorte de déni «doux», plus subtil, qui cherche principalement à ralentir la transition énergétique. Même dans les domaines de la littérature et des arts, il y a eu un énorme changement, dans la mesure où existe aujourd’hui une bien plus grande sensibilité à la crise planétaire qu’elle ne l’était en 2016. Mais d’une manière plus large, on pourrait quand même dire que très peu de choses ont changé, que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et que le statu quo reste la norme.
Vous n’y changeriez rien, si c’était à réécrire aujourd’hui?
Je changerais certainement l’attention que j’avais exclusivement mise sur le changement climatique en excluant d’autres aspects de la crise planétaire actuelle. Parce que notre crise ne concerne pas seulement le changement climatique. Comme le dit la romancière canadienne Margaret Atwood, «tout change». Je pense que la perte de biodiversité est un problème crucial dont je n’ai pas parlé dans le livre. Ces extinctions qui se produisent autour de nous sont extrêmement importantes. Pire encore, je dirais qu’il existe de nombreux autres types d’effets anthropiques, notamment en Inde. De vastes zones mortes apparaissent dans le golfe du Bengale et dans la mer d’Oman. Mais il y a aussi l’effondrement des systèmes politiques. Je n’aurais jamais imaginé que nous assisterions à un effondrement politique à la vitesse à laquelle nous y assistons actuellement. Je pense que tous sont des crises et aspects interconnectés.
Dans le passé, vous avez établi un lien entre les conflits armés dans le monde et le réchauffement climatique. Quelle est la nature de ce lien?
Les liens entre changement climatique et militarisation sont encore plus clairs et évidents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient lorsque j’ai écrit La Malédiction de la muscade. J’y ai écrit: «C’est une grave erreur d’imaginer que les Etats ne se préparent pas au monde agité qui arrive. C’est simplement qu’ils ne s’y préparent pas en réduisant les émissions; ils s’y préparent plutôt en préparant la guerre.» Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation massive des dépenses et des activités militaires à l’échelle mondiale, tandis que les dépenses consacrées à l’atténuation du changement climatique restent négligeables.
«Je ne comprends pas ces intellectuels qui veulent que vous soyez inquiets, mais pas trop.»
Certains observateurs estiment qu’il est contreproductif et peu motivant pour les citoyens d’associer l’écologie à des imaginaires et des lexiques comme ceux de la sobriété, de la fin de l’abondance, de la frugalité, etc. Au contraire, ils estiment que l’écologie doit solliciter des affects de joie, voire de célébration, pour que ce soit plus joyeux…
Je pense que personne ne sait véritablement ce qui motive les gens. Je ne comprends pas ces intellectuels qui veulent que vous soyez inquiets, mais pas trop, seulement dans une certaine mesure et pas plus. Mais comment peut-on décider à quel point les gens devraient être inquiets? Comment peuvent-ils nous dicter de pareilles choses? Comment peuvent-ils calibrer l’échelle de l’inquiétude? Tout cela conduit à une régulation du ton. Comment les scientifiques peuvent-ils simultanément nous dire qu’il s’agit de la plus grande menace à laquelle notre espèce ait jamais été confrontée, et en même temps nous dicter exactement à quel point nous devrions ou non nous inquiéter, si nous devrions ou non être pessimistes, etc. Nous devrions accepter le fait que les gens ressentent ces choses de différentes manières. Vous ne pouvez pas dicter aux artistes et aux écrivains ce qu’ils devraient ressentir à propos de quoi que ce soit.
D’une manière générale, quel regard portez-vous sur les mouvements de jeunesse pour le climat?
Nous constatons que de plus en plus de jeunes prennent conscience du fait que nous vivons dans une dystopie. Malheureusement, au lieu de nous éloigner de celle-ci, nous nous y dirigeons à toute vitesse. C’est donc une situation très sombre. Je ne suis en aucun cas un pessimiste, mais il n’est certainement pas facile, à ce stade, d’être optimisme. Quoi que nous fassions, il est difficile de voir que cela peut améliorer les choses.
Lire aussi | Les jeunes se mobilisent à nouveau pour le climat
Pour conclure, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour l’avenir? Comment le voyez-vous?
Partout dans le monde, nous assistons aujourd’hui à l’émergence de mouvements qui rejettent les conceptions mécanistes et extractivistes de la relation entre les humains et les autres êtres vivants. On a même dit que les religions qui connaissent la croissance la plus rapide aujourd’hui sont les croyances et les pratiques «centrées sur la Terre». Il est probable que la plupart des mouvements centrés sur la Terre soient basés en Occident. Alors que les élites des pays anciennement colonisés comme l’Inde et l’Indonésie se précipitent pour adopter les pratiques et les politiques coloniales (qui ne sont autres que le néolibéralisme débarrassé du langage fantaisiste), de nombreux jeunes Occidentaux comprennent que ces pratiques conduisent le monde – et en particulier leur génération – au désastre. Bien entendu, ce réveil doit beaucoup à l’activisme de ceux qui ont historiquement supporté le plus gros des souffrances infligées par le colonialisme européen – c’est-à-dire les peuples autochtones et noirs. Il est réconfortant de constater l’impact considérable qu’a eu le mouvement Standing Rock, par exemple. Ce qui me réconforte particulièrement, c’est que ces mouvements ne sont pas seulement étroitement politiques, ils préconisent également différentes façons de penser la relation de l’humanité à la Terre. Ils envisagent le monde non humain comme étant rempli de vitalité et d’action.
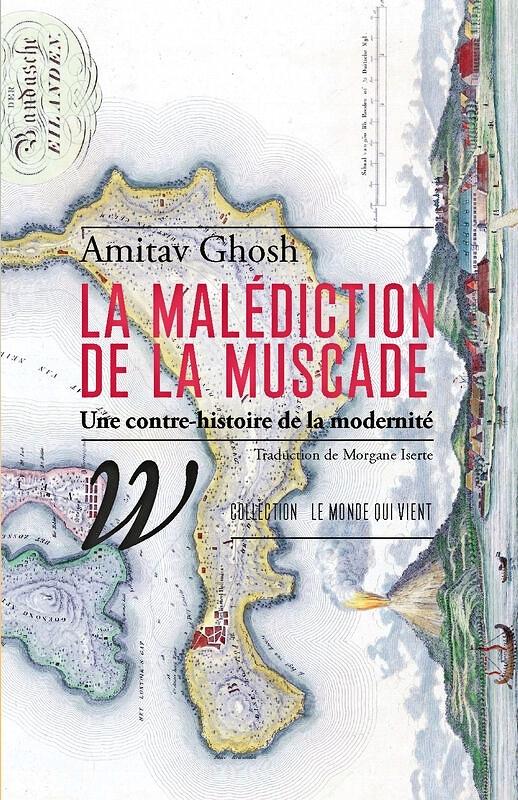
Bio express
1956
Naissance, à Calcutta, en Inde.
1990
Prix Médicis étranger pour Les Feux du Bengale (Seuil).
1999
Professeur de littérature comparée au Queens College, à New York.
2005
Professeur invité du département d’anglais à l’université Harvard.
2010
Docteur honoris causa de l’université Paris-Sorbonne.
2024
Prix Erasme pour sa contribution au thème « imaginer l’impensable ».
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici