
Jean-Noël Jeanneney : «L’histoire est un long fleuve de sang non inéluctable» (entretien)
Historien réputé, homme de médias et serviteur de l’Etat, le Français Jean-Noël Jeanneney a récemment publié le deuxième volume de ses Mémoires. En ces temps désorientés, soutient-il, l’histoire a plus que jamais un rôle majeur à jouer.
Convoquer le passé pour affronter le présent, établir des analogies entre événements historiques et actualité politique, faire résonner l’écho de l’histoire dans le présent immédiat, exhumer des auteurs et des personnages historiques oubliés pour les transformer en sources d’inspiration: c’est à ces nobles besognes que s’emploie résolument Jean-Noël Jeanneney dans Concordance des temps, émission incontournable pour les familiers de France Culture. Chaque semaine, sous la bienveillante bénédiction d’environ 500 000 auditeurs complices, l’historien le plus écouté de l’Hexagone s’empare d’une question d’actualité pour la soumettre au microscope de l’histoire. Les discours haineux irriguent les réseaux sociaux? Jean-Noël Jeanneney retrace la généalogie de ce funeste affect. L’ opposant au régime russe Alexeï Navalny est empoisonné? Un épisode est dédié au poison comme arme politique dans l’ Antiquité et au Moyen Age. Entre joyeuse érudition et exigeante vulgarisation, Jeanneney donne de la profondeur de champ à l’actualité politique, loin des rythmes effrénés du calendrier médiatique.
De plus en plus de gens ont envie de prendre du recul, de ralentir pour réfléchir. Il faut qu’on leur offre les atouts pour le faire.
«On va parler aussi un peu de mes Mémoires j’espère», glisse-t-il gentiment pendant que nous faisons connaissance dans son élégant bureau donnant sur le 22 rue de Bièvre, la demeure privée de l’ancien président François Mitterrand – dont il fut par deux fois secrétaire d’Etat. Car Jean-Noël Jeanneney n’est pas peu fier de sa dernière œuvre, le deuxième volume de ses Mémoires, Le Rocher de Süsten (1). Le premier, paru en 2020, avait déjà révélé au grand public ce que la notoriété de l’homme de radio avait jusqu’alors éclipsé: un narrateur raffiné, précis et, par-dessus tout, passionnant. Qualités que l’on retrouve dans ce deuxième volume, qui revient principalement sur ses années à la direction de Radio France et de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française.
Vous êtes un universitaire et historien de formation. Qu’est-ce qui vous a amené à devenir acteur du monde médiatique?
Tout jeune, je me suis passionné pour l’histoire. Quand j’en ai fait mon métier, j’ai estimé qu’un moyen de la renouveler était d’examiner les forces extérieures qui pèsent sur le monde politique. Je me suis beaucoup intéressé, d’une part, aux milieux d’affaires, à la manière dont ils influencent la vie publique – entre mythes et réalités – , et, d’autre part, à la façon dont les médias influencent les décisions politiques, et réciproquement. En 1987, après mon éviction de la présidence de Radio France par la droite revenue au pouvoir, j’ai publié des feuilletons d’été sous ce même titre, Concordances des temps, dans Le Monde. L’ idée était simple: je partais du principe que l’histoire alimente l’histoire, que le passé éclaire le présent, que sa connaissance fournit des réflexions sur les permanences et sur les rebonds. Les quarante articles, publiés ensuite en volume, ont connu quelque succès. J’ai été ainsi approché, des années plus tard, en 1999, par Laure Adler, alors directrice de France Culture, qui m’a proposé de décliner le concept à l’antenne.
Dans le contexte actuel, bousculé par l’immédiateté des réseaux sociaux, peut-on encore se permettre ce genre d’émissions qui prend le temps (une heure) de mettre l’actualité en perspective?
Dans L’Histoire va-t-elle plus vite ? (Gallimard, 2001), je m’interrogeais sur la réalité de cette idée de plus en plus répandue selon laquelle l’histoire s’accélérerait. A certains égards, c’est vrai: les nouvelles technologies ont changé énormément de choses. Mais bien d’autres allures demeurent plus lentes: plus les rythmes sont hachés, notamment ceux de l’actualité médiatique, plus les résistances du public s’expriment et se mettent en place, souvent en se fondant sur un socle de mentalités durables. De plus en plus de nos concitoyens ont envie de prendre du recul, de ralentir pour réfléchir. Simplement, il faut qu’on leur offre cette possibilité, qu’on leur fournisse les atouts intellectuels nécessaires. Je ne fais pas partie des gens qui, en vieillissant, clament que «c’était mieux avant». Il ne faut pas pour autant nier que le risque que nous soyons noyés par le flot de nouvelles de toutes sortes existe. Mais en ce qui me concerne, j’y vois plutôt une raison supplémentaire pour qu’un service public de l’audiovisuel soit doté des moyens de se protéger contre ce péril. Je suis loin d’être pessimiste.

Dans le premier volume de vos Mémoires, vous rappeliez l’opposition entre deux conceptions de la radio: celle où on offre à l’auditeur ce qu’il attend, et celle qui lui impose des contenus inattendus. Dans laquelle vous reconnaissez-vous?
Je me situerais entre les deux et je raconte en détail dans mon livre comment je me suis attaché, quatre ans durant, à incarner cela. Ma conviction au sujet de l’audiovisuel, et de la radio en particulier, est fondée sur l’histoire des années 1930, que j’ai beaucoup enseignée. Avec, d’un côté, les Etats-Unis au temps de la naissance des sondages. Le système était déjà régi par la seule logique du marché: on interrogeait les gens sur ce qu’ils avaient envie d’entendre et on leur proposait une offre radiophonique, même médiocre, qui correspondait à leurs attentes. L’ idée était d’abord de vendre la publicité qui accompagnait les programmes. De l’autre côté, en Angleterre, la BBC estimait qu’on devait offrir uniquement un type de contenu défini «d’en haut». L’ adhésion viendrait peu à peu. La France s’est positionnée entre les deux partis pris. Soit un secteur privé nourri par la publicité coexistant avec un secteur public vivant de la redevance: supprimer cette redevance, comme vient de le faire le président Emmanuel Macron, est une grave erreur, tant sur les plans concret que symbolique. Cela met en péril l’indépendance du secteur public de l’audiovisuel. Les dirigeants qui estimeront qu’ils ne sont pas traités sur les antennes à hauteur de leurs mérites – c’est très fréquent… – seront tentés de peser sur le contenu de l’information en utilisant l’arme financière. Ensuite se pose la question de la publicité. L’Etat étant toujours impécunieux, il est probable qu’il incite les chaînes publiques à polluer leurs antennes avec la «réclame», comme on disait autrefois, laissant ainsi se développer l’influence des annonceurs sur les contenus, suscitant la recherche d’une audience maximale à court terme. Avec le risque lourd que la différence fondamentale entre le public et le privé se dissolve.
Vous êtes un fervent défenseur du service public audiovisuel. Quelle en est votre conception?
La vocation du service public audiovisuel n’est pas de se soumettre aux sondages. Certes, il faut en tenir compte, pour ne pas s’enfermer dans je ne sais quelle thébaïde arrogante. Mais ils doivent ne peser qu’à moyen terme. Si, au bout d’un an ou deux, une émission ne rencontre pas son public, il devient légitime de la supprimer. En revanche, le décider après une semaine, parce qu’elle ne touche pas tout de suite tout le monde, c’est une faute, dans le cas du service public. Il faut défendre le principe de proposer aux auditeurs et téléspectateurs des émissions dont ils ne savent pas encore s’ils les aimeront, puisqu’ils ne les connaissent pas. Ce fut la philosophie de la «réforme Garretto» (NDLR: du nom de Jean Garretto, nommé par Jean-Noël Jeanneney à la tête des programmes de France Inter en 1983) que j’ai menée quand je dirigeais le groupe Radio France. On a perdu des auditeurs la première année mais ensuite on est remontés, peu à peu, et on a finalement dépassé Europe 1, alors notre concurrent majeur du côté du privé. Je crois ce rappel instructif.
A lire aussi | La culture historique des ados résiste
A la lecture du deuxième volume de vos Mémoires, on a l’impression que votre vie est traversée par une tension entre, d’un côté, le hasard et le déterminisme, et de l’autre, le libre arbitre et la volonté.
Je parlerais plutôt de déterminisme que de détermination, si l’on sait ce que l’on veut d’une manière ferme et durable en face de l’immédiateté d’une conjoncture largement imprévisible. Cette conviction est née de la rencontre de mon expérience personnelle et de mon métier d’historien. Quant à la part du hasard… Elle s’est concrétisée d’une manière violente dans l’épisode qui m’a inspiré le titre de mes Mémoires, Le Rocher de Süsten: revenant d’un voyage en Grèce avec deux amis, nous roulions en 2CV Citroën, dans les Alpes suisses, dans la descente du col du Süsten, lorsqu’un énorme rocher a broyé la grosse voiture juste devant nous, ôtant la vie aux cinq passagers à son bord. A une seconde près, je ne serais plus ici à vous parler… Ainsi, jeune, j’ai éprouvé de plein fouet la part de la contingence dans un itinéraire personnel. Voltaire parlait de «sa majesté le hasard». Il avait raison. Ce qui n’exclut en rien la liberté de chacun, dans l’action, à l’intérieur de ces limites imposées et à partir de diverses convictions antérieurement mûries.
La Révolution française n’est pas terminée. La faire connaître ne se limite pas à retracer un récit.
Votre expérience d’historien a aussi joué un rôle…
Pour tenter de comprendre les événements et d’y inscrire son action, il faut toujours considérer les différents rythmes de la durée dont l’entrelacs définit chaque conjoncture. Depuis les forces profondes et les mentalités durables jusqu’aux spasmes de la surface, eux-mêmes révélateurs de nombreux phénomènes qui sont au travail sous la surface (dans l’ordre politique, culturel, spirituel, etc.). Le regard peut s’aiguiser par l’exercice de l’uchronie (NDLR: récits d’événements fictifs à partir d’un point de départ historique, permettant d’imaginer ce qui se serait passé si…) qui apporte non seulement un plaisir romanesque mais également un moyen de mieux distinguer l’inévitable et l’accidentel. Les uchronies aident à restituer la diversité des possibles à chaque moment de l’histoire, contre l’illusion rétrospective d’une fatalité. Hommage encore à la liberté.
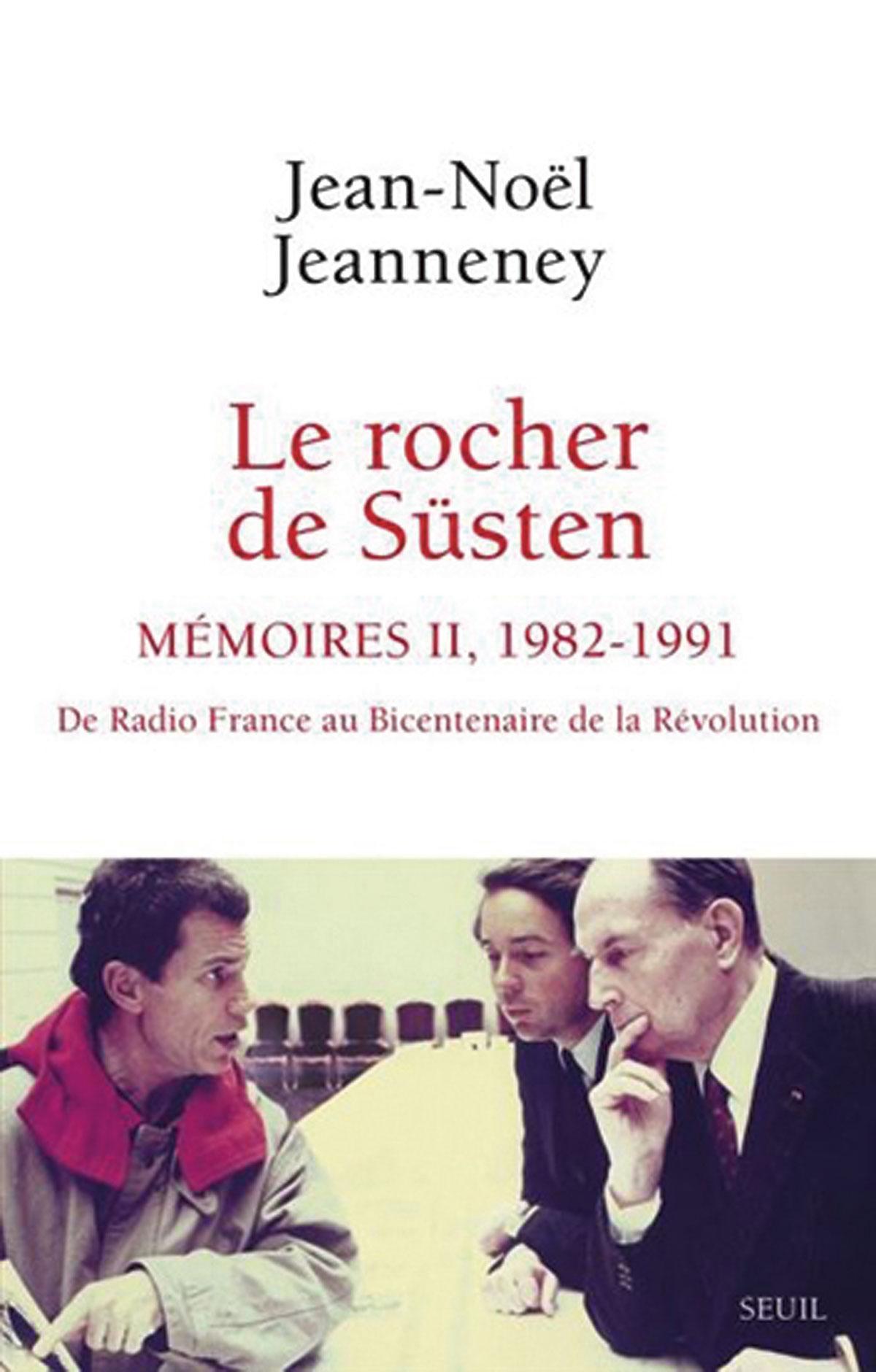
Vous avez présidé l’organisation du bicentenaire de la Révolution française. Quel devrait être aujourd’hui l’héritage de cette période de l’histoire?
Quand, au printemps 1988, j’ai reçu de François Mitterrand la responsabilité d’organiser le bicentenaire, j’avais la conviction profonde que la Révolution française appartient à tout le monde – pas seulement aux Français mais à tous ceux, dans le monde, qui souhaiteraient se saisir de cette mémoire, à toutes fins utiles – et qu’il faut porter les valeurs des Lumières, immortelles, dans l’ordre intellectuel, moral, civique et social. Un débat s’est noué autour de la question de la Terreur (NDLR: période, entre 1793 et 1794, au cours de laquelle le mouvement révolutionnaire s’est radicalisé, faisant usage d’une très grande violence). Ma position, contrairement à celles d’autres historiens, ou au cardinal Lustiger – je raconte mes rencontres avec lui, piquantes… – était qu’elle n’était pas intrinsèque à la Révolution. Il ne s’agissait pas de l’excuser, mais il fallait restituer ce moment en en rappelant les circonstances et tenir compte de la sensibilité de l’époque.
Vous estimez aussi que la Révolution française n’est pas encore terminée. Qu’entendez-vous par là?
D’un point de vue chronologique, d’un régime à l’autre, on peut dire que la Révolution se termine avec le Premier Empire. Mais il s’agit en l’occurrence d’une lecture sèche. Au moment de la mise en place de la commémoration, ma vision de cette période de l’histoire était celle de Victor Hugo qui disait à son propos: «Il y a plus de terre promise que de terrain gagné.» Nous portions la conviction que les réformes qui avaient incarné, pendant la Révolution, des valeurs universelles, avaient encore besoin d’être consolidées et développées, même si parfois elles avaient été violées par la nation même qui les avaient promues – je pense, par exemple, à la colonisation – et que la commémoration pouvait y contribuer. Le défilé-opéra organisé par Jean-Paul Goude le 14 juillet 1989 sur les Champs-Elysées, et que la télévision a diffusé tout autour de la planète, a signifié cela.
Les remises en cause que subit l’universalisme français et, plus généralement, européen vous inquiètent-elles?
Nos sociétés européennes sont de nos jours plus imprégnées par les valeurs de l’universalité que celles de 1788. Evidemment ces acquis restent fragiles. Au moment du bicentenaire, je n’imaginais pas qu’il y aurait dans un avenir proche tant de menaces inquiétantes. Ainsi, je n’aurais pas pensé que des gens, chez nous, remettraient en cause, parfois par le crime, le droit au blasphème au nom de la défense des religions et du communautarisme. Gardons-nous de jeter la laïcité dans les bras de l’extrême droite. De ce point de vue notamment, oui, la Révolution française n’est pas terminée. La faire connaître ne se limite pas à retracer un récit. C’est aussi honorer une source d’énergie qui permet d’espérer encore.
Vous vous définissez comme un «historien engagé». Quel sens cette étiquette pourrait-elle avoir aujourd’hui?
Je ne prends pas le terme dans le sens qu’on lui donnait après la Libération et dans les années 1950. Il s’agissait alors – je caricature à peine – de subordonner sa pensée à la cause qu’on avait choisie de défendre, donc consentir à des silences ou à des solidarités indus. Je pense ici à la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre, «Tout anticommuniste est un chien»: absurde et délétère pour une réflexion libre. En revanche, si on entend par engagement le choix d’un camp ou diverses formes d’intervention dans le forum, alors, oui, je suis un historien engagé. Et puis, quand j’ai accepté des responsabilités publiques, celles de Radio France et du bicentenaire, ce fut aussi une forme d’engagement, qui fut intense. Je ne me suis jamais «engagé» dans le sens où j’aurais bridé ma liberté de parole de peur que le camp auquel je me rattache s’en trouve affaibli – sauf bien sûr, dans une certaine mesure lors de ma participation à deux gouvernements sous François Mitterrand. Ce sera pour le tome III…
Quelle forme peut revêtir l’engagement de l’historien dans la conjoncture présente, plutôt imprévisible et agitée sur les plans social et international?
Je pense à la célèbre phrase de Raymond Aron qu’il aurait eue à propos du président français Valéry Giscard d’Estaing: «Le drame de Giscard, c’est qu’il ne sait pas que l’histoire est tragique.» L’ histoire est un long fleuve de sang. Notre responsabilité n’en est que plus grande. Nous ne sommes pas des prophètes et rien ne se répète jamais à l’identique. Plus que jamais, notre fonction civique doit être de réfuter le caractère inéluctable de divers enchaînements ravageurs. Le recul dans le temps, un recul le plus serein possible, doit pouvoir aider la lucidité des citoyens et des dirigeants des peuples et, qui sait, nourrir leur sagesse.
Bio express
1942 Naissance, à Grenoble, le 2 avril.
1982 Devient président-directeur de Radio France.
1992 Est nommé secrétaire d’Etat chargé de la communication sous le second septennat de François Mitterrand.
1999 Lance l’émission hebdomadaire Concordance des temps sur France Culture.
2002 Devient président de la Bibliothèque nationale de France.
2005 Se voit décerner le titre de docteur honoris causa par l’ULB.
2017 Publie Le Moment Macron (Seuil), dans lequel il analyse le momentum qui a permis au président français de «saisir sa chance».
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici