L’autrice Rose Lamy n’a pas peur de le dire haut et fort: elle vient d’un milieu «beauf». Et quoi qu’elle fasse et quelle que soit son ascension professionnelle, cette identité, plus culturelle qu’économique, lui colle à la peau. Et alors?
Issue d’un milieu populaire et élevée au milieu de nulle part, en plein centre de la France, Rose Lamy, 41 ans, a compris en se frottant plus tard à d’autres, aux études et dans les grandes villes, qu’elle était considérée comme «beauf». Aujourd’hui, elle l’assume et le revendique, tout en dénonçant, dans son ouvrage Ascendant beauf (1), un profond mépris de classe. L’autrice française ne voit pas pourquoi elle devrait cesser d’être loyale à ce qu’elle a toujours connu et toujours été. Ce n’est pas une raison pour ne pas dénoncer un système de domination culturelle sournois, qui imprime la honte au cœur de ceux qui en sont victimes, à leur corps défendant: ce n’est la faute d’aucun enfant s’il ne visite pas les musées durant les vacances ni ne lit les grands classiques. Et, au fond, ce n’est pas grave. Mais pour Rose Lamy, la figure du beauf, qui n’a pas vraiment d’équivalent en Belgique, est bien pratique: par opposition, elle permet aux autres de se distinguer, donc d’exister. Même si on est toujours, quoi qu’on en dise, le beauf de quelqu’un.
Pour vous, la catégorie dite «des beaufs» relève-t-elle plutôt d’une classe sociale particulière ou d’un groupe marqué par une absence de capital culturel et social?
Pour faire très simple, un pauvre se définit à mes yeux comme quelqu’un qui est en déficit de capital économique alors qu’un beauf est en déficit de capital culturel. Dans les deux cas, ce n’est pas de leur faute. Mais s’il est désormais acquis qu’il ne serait pas moral de blâmer le premier, on a en revanche tendance à croire que le déficit culturel est mérité: celui qui en souffre n’aurait pas fourni assez d’efforts pour apprendre à l’école. En conséquence, une certaine violence s’abat sur les beaufs. On est toujours avec eux dans un rapport de domination culturelle: on les accuse de ne pas être assez cultivés, de ne pas se transformer, de ne pas se transcender.
Historiquement, d’où vient le terme beauf?
De celui qui en a inventé le personnage au début des années 1970, le dessinateur Cabu, en référence à son beau-frère, selon ses dires. Il en a dressé un portrait-robot précis: on sait qu’il porte une moustache, on connaît son profil rondouillard, ses goûts, ses penchants sexistes et réactionnaires. Mais si l’on demandait à 30 personnes différentes de définir le beauf, personne ne fournirait la même réponse. Ses contours sont donc un peu insaisissables. Ce personnage est l’antagoniste d’un autre, Duduche, et tous deux se prennent la tête lors des repas de famille. D’autres considèrent que le terme est à rapprocher du B.O.F. -pour beurre, œuf, fromage– un acronyme qui renvoie à l’image de petits commerçants français qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont collaboré avec l’ennemi allemand.
Les beaufs, affirmez-vous, sont aussi victimes de certaines politiques publiques: ils habitent souvent loin d’un hôpital, donc sont moins bien soignés que d’autres, ou sont isolés parce que les petites gares qu’ils fréquentaient sont fermées. Tout cela relève-t-il d’une volonté de les ostraciser davantage?
C’est ce que je pense. En France, il y a déjà cette idée que tout ce qui n’est pas dans la ville, donc ce qui se trouve à la campagne ou en banlieue, est un peu suspect. Et déconsidéré. La fracture n’est pas que sociale et culturelle: elle est aussi territoriale. Traiter quelqu’un de beauf peut paraître une injure superficielle. On m’a régulièrement dit, d’ailleurs: «Faut pas le prendre mal, c’est de l’humour!».Je pense au contraire que cela participe à désensibiliser les gens au sort de ces personnes-là, souvent dominées et vivant dans des lieux qui les déclassent encore plus. En France, pays très décentralisé, fermer les services publics ou les gares dans les petits villages et les petites villes revient à abandonner ces gens à leur sort. Et cela se mesure très concrètement. A Bourges, territoire d’où je viens, des maternités sont fermées et des femmes sont mortes sur le trajet vers la seule maternité encore existante dans leur région. On est donc dans des questions de vie ou de mort. Et ce qui protège une partie de la population de s’alarmer face à cette situation, c’est cette idée qu’il s’agit de citoyens un peu secondaires, qu’on méprise parce qu’ils votent mal, parce qu’ils ne sont pas aussi intelligents que les autres. Après tout, ils n’avaient qu’à s’installer en ville…
Selon vous, les beaufs ont-ils le sentiment d’appartenir à un groupe particulier?
Je pense que, comme souvent, l’assignation vient de l’extérieur. La seule personne que j’ai vue se revendiquer comme beauf, c’est Patrick Sébastien qui, dans une vidéo, s’est présenté comme animateur de télévision, écrivain et beauf, en ajoutant: «Vous devriez essayer, c’est vachement bien!» En général, ce n’est pas un statut que l’on revendique.
Vous-même, vous considérez que vous êtes une beauf et que, quoi que vous fassiez, par exemple, aujourd’hui, être publiée, vous le restez…
Oui. Mon assignation à l’être, dure. Même si ma situation économique s’est améliorée et mon niveau culturel aussi. Mais il reste ce petit truc particulier, une différence de goûts, un écart considérable d’appréciation des choses, avec les personnes que je rencontre désormais. Quand j’essaie de comprendre l’origine de cette différence d’appréciation, par exemple à propos d’un film, je retombe presque toujours sur des références culturelles préalables qu’il fallait avoir et que je n’ai pas. Pareil avec les livres. J’ai souvent menti, entre autres quand on me demandait si j’avais lu La Distinction, de Pierre Bourdieu. J’ai vraiment essayé de lire cet ouvrage, lors de séances de 20 minutes, tous les matins. En vain. Cette référence, je ne l’ai pas. Maintenant, je préfère le dire. C’est dans ce genre de petits trucs que je perçois que je ne suis pas comme les autres. Même si je gagnais deux millions d’euros demain, je ne m’y connaîtrais quand même pas en opéra. Et il me faudrait des années pour rattraper ce retard. D’ailleurs, ce n’est pas une fin en soi.
«La femme beauf n’existe pas. Elle est la femme de… Elle n’existe qu’en creux.»
Quel sentiment en éprouvez-vous?
De la honte, intériorisée. J’ai par exemple beaucoup regardé la télévision quand j’étais enfant, notamment les émissions de Dorothée. Or j’ai entendu des gens dire qu’avec ce genre de programmes, on avait créé une génération de débiles… Même si je fréquente maintenant des milieux plus intellectuels, je continue à regarder la télévision comme avant. Ce n’est pas grave et aujourd’hui, je le dis.
On se souvient du scandale qu’avait provoqué François Hollande, alors président de la République, en évoquant les «sans-dents». D’aucuns parlent aussi des gens d’en bas. Mais paradoxalement, nombre d’élus évoquent leurs racines familiales ouvrières ou paysannes. Pourquoi?
L’ancien Premier ministre Michel Barnier évoquait en effet souvent ses racines paysannes et montagnardes. Ce faisant, il voulait jouer la partition de la méritocratie, qui lui permet de justifier qu’il a une meilleure position que les autres. Il avait donc tout intérêt à amplifier son ascension et à masquer, dans le même temps, ce qui a rendu cette ascension plus facile. La France est un pays très élitiste. J’y ai vu très peu de gens gagner les hautes sphères politiques sans être passés par les grandes écoles. Certains enfants sont programmés par leurs parents pour accomplir plus tard un parcours d’excellence dans les grandes écoles. Le mythe méritocratique –le «marche ou crève»– est très central, en France. Mais que fait-on de la majorité de la population qui ne peut pas s’inscrire là-dedans? Des millions de gens comme moi qui ont un bac +2 ou un bac technique? C’est l’absence de réponse à cette question qui crée un sentiment général de défiance de la part de ces citoyens envers le diplôme et envers la culture. Ces gens ne sont pas bêtes: ils ont bien conscience de ne pas passer les étapes, de pas être sélectionnés à l’école, de ne pas faire partie des cohortes qui quittent leur ville pour aller étudier ailleurs à l’université. Ils ne peuvent qu’intérioriser ce sentiment…
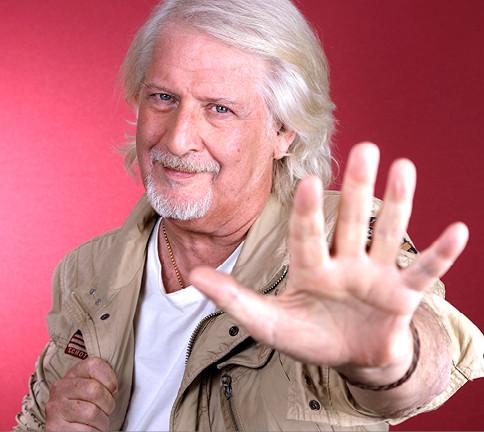
Qui se transmet de génération en génération?
Oui. Il faut plusieurs générations pour passer d’ouvrier à cadre. En France, on a accès facilement à beaucoup de lieux culturels, des musées par exemple, dont l’accès est parfois gratuit. Mais être beauf, ce n’est pas une question matérielle: c’est une question d’héritage culturel et si on ne l’a pas, il est très difficile à construire. Enfant, je ne suis allée qu’une fois au cinéma, pour voir Les Visiteurs. En famille, je n’ai pas visité les châteaux de la Loire. C’est avec l’école que j’ai visité certains lieux culturels. En vacances, j’allais à la mer ou au camping. L’été, je regardais la télévision, je roulais à vélo et j’écoutais beaucoup de musique. Ce non-capital culturel, j’en ai complètement hérité.
Travailler, voire beaucoup travailler, ne permet pourtant pas toujours d’échapper à son statut d’origine…
En effet. Le travail, présenté comme la panacée, n’en est pas une. Il faut des années pour changer de classe sociale. Et quand on vient des classes ouvrières, on hérite non seulement d’un certain capital culturel, mais aussi de corps particuliers. Or l’espérance de vie, par exemple, ne change pas lorsqu’on change de classe sociale. On garde aussi la peur de manquer. Certes, on peut avoir un meilleur confort de vie, du succès, de l’argent, mais on reste coincé quelque part entre deux classes.
«Etre beauf, ce n’est pas une question matérielle: c’est une question d’héritage culturel et si on ne l’a pas, il est très difficile à construire.»
La domination culturelle d’une certaine partie de la population vis-à-vis de l’autre se marque notamment dans la chanson, en particulier la chanson populaire, comme celle de Joe Dassin. On peut tous chanter ses titres, mais tout dépend de la manière…
Oui. C’est une nuance subtile. Comme le mépris de classe brutal et ostensible commence à être mal vu, on en voit arriver un nouveau variant sous forme de mépris culturel: on se montre ouvert à chanter Joe Dassin, mais dans un certain contexte, en soirée, quand on a trop bu, et en glissant un petit mot comme «c’est mon petit plaisir coupable». Ou en chantant de manière à discréditer les paroles. La première fois que je suis sortie en soirée dans un milieu non beauf, j’ai chanté Joe Dassin de tout cœur, en étant totalement sincère et premier degré. Et là, je me suis pris un mur. C’est par l’accumulation de ces petites violences symboliques que l’on prend conscience et que l’on intériorise le fait d’avoir mauvais goût.
Quel est l’intérêt pour le groupe «d’en haut» d’insister sur l’existence d’un groupe «d’en bas»?
Comme dans toutes les oppressions, le groupe dominant, pour pouvoir se regarder dans le miroir le soir, doit être persuadé que ceux qui ne sont pas des leurs méritent leur place. Pour cela, il faut avoir réussi à caricaturer et à déshumaniser cette frange de citoyens, jusqu’à considérer que ce qui leur arrive est de leur responsabilité. C’est pareil avec les femmes agressées dans la rue, à qui on reproche de s’y être promenées tard. Sans quoi, la violence qui s’exerce contre elles –et contre eux– serait insupportable.
Lire aussi | S’appeler Kevin, une malédiction?
Les prénoms sont-ils également représentatifs de la culture beauf?
Selon le sociologue Baptiste Coulmont, qui est spécialiste des prénoms, un prénom beauf est à consonnance américaine ou bretonne. Selon lui, on a longtemps eu un système très descendant de prénoms: les classes populaires imitaient les classes dominantes en reprenant leurs prénoms… jusqu’à ce que les classes dominantes, comme vexées, cessent de les choisir. Et optent pour de nouvelles appellations, qui les distinguent à nouveau. Mais ce qui est encore plus insupportable aux yeux des dominants, ce sont les prénoms qui naissent et meurent directement dans les classes populaires. Dans ce cas, celles-ci ne s’inspirent plus des classes supérieures mais choisissent des prénoms dans la culture pop, dans les séries ou dans des chansons. Cette autonomie, cette affirmation que manifestent les dominés fait en sorte qu’ils prennent cher dans le mépris: se soustraire ainsi à l’autorité habituelle des classes dominantes a un côté inacceptable pour ces dernières. Pour le sociologue Baptiste Coulmont, le filtre des prénoms constitue une manière acceptable de faire du mépris de classe. Faire partie de la communauté des Kevin, des Kimberley ou des Jordan dit d’ailleurs quelque chose, sans l’exprimer directement. Dans le film Le Prénom, il y a cette phrase: «Je n’ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu‘un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille!» S’appeler Myrtille, c’est d’office réussir au bac avec mention très bien…
A présent, non contente de chanter Joe Dassin, la classe dominante investit les PMU…
Oui. Parce qu’aujourd’hui, le signe qui distingue la classe dominante, c’est l’ouverture affichée vers la culture populaire et l’affirmation qu’on l’apprécie.… On voit donc des startuppers reprendre des PMU, qu’ils qualifient de lieux «authentiques». Sauf qu’ils y mettent une certaine ironie, qui n’est pas compréhensible pour tout le monde. On croise donc là des gens qui viennent au PMU pour y enregistrer leurs paris et d’autres qui s’y rendent dans un contexte de gentrification culturelle. On en revient toujours au principe de la distinction. C’est comme avec les chansons populaires, comme celles de la comédie Starmania. Que les classes dominantes se les approprient aujourd’hui, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce qui me perturbe, c’est que nous, classes dominées, disons depuis le début qu’il s’agit là de chansons de qualité. Alors qu’a-t-il fallu pour que ce qui a toujours été considéré comme beau par une partie de la population le devienne pour une autre qui, jusqu’alors, avait tendance à le mépriser? On gagnerait beaucoup de temps si on admettait juste que les choses sont belles dès le départ, ou que si elles plaisent à une partie des gens et non à nous, c’est que quelque chose nous échappe et que ce n’est pas grave, plutôt que de le considérer immédiatement comme nul.
«A part l’animateur Patrick Sébastien, je ne connais personne qui se revendique beauf.»
Les beaufs jouent-ils le rôle du bouc émissaire idéal?
J’en suis persuadée. Un «tonton raciste», dans une famille, l’est parce qu’on le désigne comme tel. Il devient ainsi le seul porteur de racisme, de sexisme, de complotisme, de bêtise. Et c’est bien pratique parce que cela nous situe dans le groupe opposé. Comme le mouvement Touche pas à mon pote, dans les années 1980. C’était une manière de dire que ceux qui soutenaient cette cause étaient au-dessus de la mêlée, et tous les autres, à côté de la plaque: toi, tu es fautif et moi, je suis complètement déconstruit. Or nous sommes tous traversés par la violence, le sexisme, le racisme, pour ne parler que de cela. Alors, on aurait tout intérêt à se mettre autour de la table et à reconnaître que nous sommes pareils, donc imparfaits, de ce point de vue, mais que nous le manifestons différemment. Qu’il y a un travail à faire là-dessus, au-delà de la prise de conscience, mais que ce n’est pas gagné parce que c’est tout un système qui nous produit tels que nous sommes. Récemment, une humoriste a posté une publication consacrée au starter pack (2) d’une beauf, imaginé par l’intelligence artificielle. On y trouve une poupée prénommée Kimberley. Elle a deux enfants, conduit une poussette, dispose d’une carte d’allocations et porte un tee-shirt sur lequel il est écrit: «J’attends le cinq du mois.» Ce post a fait des milliers de likes. Et moi, je suis désemparée.
Les classes dominées ont-elles perdu tout espoir?
Il y a en tout cas une partie de la population qui n’y croit plus. Il y a chez ces citoyens un petit truc punk, du genre «No future». Ce n’est pas un manque de conscience de leur part que l’effondrement arrive, comme on pourrait le penser. C’est juste une désillusion après avoir tout essayé, n’avoir été entendu par personne et avoir toujours été trahi. En France, lors des élections, c’est l’abstention qui sort gagnante, parmi les classes populaires, devant le Rassemblement national.
Les femmes beaufs ont-elles un statut particulier?
Elles ont un statut particulier en ce sens qu’elles n’en ont pas. Elles n’existent pas: c’est «la femme de…»: la femme de Bidochon, la femme des Deschiens, la femme Tuche. Ensuite, par définition, on ne les voit pas dans l’espace public. Elles sont construites en creux.
Certains réalisateurs font passer des castings sauvages pour trouver ceux qui camperont leurs personnages. Autrement dit, ils embauchent des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels. Est-ce une autre forme d’appropriation?
J’ai le sentiment, à ce sujet, d’une appropriation des corps des gens pour les laisser ensuite sur le carreau, une fois le film terminé. Que deviennent ceux qui ont été repérés par un réalisateur lors de castings sauvages? Je n’ai pas l’impression qu’ils continuent tous des carrières dans le cinéma. Ils sont un peu pris pour ce qu’ils sont puis jetés pour ce qu’ils sont. Je m’interroge sur le principe: ces comédiennes et comédiens repérés dans le cadre d’un casting sauvage sont-ils condamnés à jouer leur propre rôle puis à disparaître de l’écran ou peuvent-ils vraiment connaître une carrière d’acteur? Pourquoi y aurait-il des acteurs capables de jouer et d’incarner plein de personnages différents et pas eux? Peut-être parce qu’en fait, on ne leur laisse pas une place en tant qu’acteur, mais uniquement en tant représentant d’une certaine frange de la population?
Finalement, le beauf existe-t-il?
Je pense qu’il n’existe que dans le discours de ceux qui le nomment. Pour se distinguer et montrer que l’on appartient au groupe qui ne l’est pas.
(1) Ascendant beauf, par Rose Lamy, Seuil, 176 p.(2) Les starter packs sont des figurines, générées par l’intelligence artificielle, présentées, sous emballage plastique, avec des accessoires censés résumer le profil du véritable humain qui se prête à l’expérience.
Bio express
1984
Naissance en Haute-Savoie (France).
2003
Prend le pseudonyme de Rose Lamy.
2019
Crée le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui décrypte le traitement médiatique des violences sexistes.
2020
Publie Préparez-vous pour la bagarre. Défaire le discours sexiste dans les médias (JC Lattès).
2023
En bons pères de famille (JC Lattès).
2025
Ascendant beauf (Seuil).

