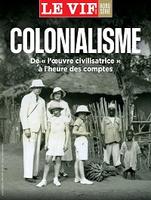Auteur de Tyrans d’Afrique, Vincent Hugeux pointe la proximité des premiers dirigeants des Etats postcoloniaux avec les anciennes puissances coloniales et le primat de la stabilité défendu par celles-ci. « Ces despotes ne sont que les rejetons monstrueux de l’aberration coloniale. »
Cet entretien réalisé par Gérald Papy est issu du hors-série de près 200 pages que Le Vif consacre à la grande histoire du colonialisme, depuis ses racines jusqu’à ses conséquences, toujours à l’oeuvre 150 ans plus tard: COLONIALISME. De « l’oeuvre civilisatrice » à l’heure des comptes. Envie d’en lire plus? Il est en vente actuellement en librairie ou via notre shop.
La fin de la colonie ne met pas fin à la colonisation. L’histoire des pays africains nouvellement indépendants dans les années 1960 le prouve. Comment ce mécanisme s’est-il mis en place? Pourquoi les premiers dirigeants de ces Etats y ont-ils consenti? Tentative de réponse avec Vincent Hugeux, journaliste et auteur de Tyrans d’Afrique.
Les dirigeants des Etats nouvellement indépendants d’Afrique prolongent-ils la domination coloniale?
C’est une perpétuation paradoxale de l’ordre colonial. Pour deux raisons. D’abord parce que la plupart des chefs d’Etat africains de l’ère de l’indépendance ont été des acteurs, militaires ou politiques, sur la scène de la puissance coloniale. Le Centrafricain Jean-Bedel Bokassa et le Togolais Gnassingbé Eyadéma ont servi loyalement l’armée française, y compris dans ses aventures coloniales en Indochine et en Algérie. L’Ougandais Idi Amin Dada a été un très zélé soldat de sa gracieuse majesté Elisabeth II. Même ceux qui ont construit leur légende sur la rupture avec le fait colonial ont un passé analogue. Le Guinéen Ahmed Sékou Touré, avant d’être l’homme qui a dit non à de Gaulle en récusant en 1958 l’offre d’association venue de Paris, a été un acteur politique et syndical sur la scène française. On pourrait citer encore les exemples de l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, du Sénégalais Léopold Sédar Senghor qui ont été parlementaires, voire ministre au sein de la république française d’avant 1960. Et enfin, il y a le cas d’école de Joseph-Désiré Mobutu qui a été très entreprenant dans les liens qu’il a tissés avec le royaume de Belgique par ses études, son aventure journalistique… Il y a une forme de continuité.
> A lire sur le sujet : Baudouin, Lumumba, Mobutu : l’histoire secrète du Congo
Ensuite, tous les chefs d’Etat de la période postcoloniale ont vécu un état de grâce consubstantiel à l’appel d’air formidable de l’indépendance, avec ses espérances et ses chimères. Il y a pu y avoir l’illusion lyrique d’une ouverture au pluralisme, à la transparence, à la démocratie. Mais très vite, une « refermeture » s’est opérée en deux étapes : l’instauration d’un parti unique, sous divers prétextes, sécuritaires par exemple. Se présentant comme l’incarnation unique de l’épopée de l’indépendance, le nouveau dirigeant s’autorise à dire : « Je suis le peuple. Le peuple, c’est moi. Quiconque émet ne serait-ce qu’une réserve, une critique, sur ma gouvernance, sur mes choix, sur mes nominations, sur mes options diplomatiques est par essence un traître, voire un comploteur. Et s’il n’y a pas de conspirateur avéré, je m’en invente. »
La deuxième phase consiste en une « restauration autoritaire », selon la formule du politologue Jean-François Bayard. Au début de la décennie 1990, trente ans après les indépendances, on assiste au cycle des conférences nationales souveraines, d’abord au Bénin avant d’essaimer sur le continent, y compris à Kinshasa, sur le mode tonitruant d’un grand jamboree démocratique. Contraints et forcés, les despotes sont obligés d’octroyer quelques concessions, parfois formelles, parfois significatives. Mais ayant senti le vent du boulet, dès qu’ils le peuvent, ils vont resserrer les boulons de l’autoritarisme. Ce sera particulièrement le cas au Congo-Kinshasa. Ayant acquis, par leur parcours estudiantin, militaire ou politique, la maîtrise des codes en vigueur dans les anciennes puissances coloniales, beaucoup de ces despotes sont passés maîtres dans l’art de les dévoyer à leur profit pour justifier l’enkystement des réflexes autoritaires.
La « refermeture » n’est-elle pas complaisamment appuyée par l’ancien pouvoir colonial?
N’oublions pas que l’indépendance sera souvent plus formelle que réelle. L’emprise militaire se perpétue, via des accords de coopération qui, au fond, délèguent l’essentiel de la gestion sécuritaire à l’ex-puissance coloniale. Des impératifs économiques conduisent aussi au contrôle des ressources naturelles par les anciens colons, pour en garantir l’approvisionnement. Je me souviens de cet ancien ministre du Niger qui, vingt-cinq ans après les indépendances, me disait : » Sachez que j’ignore la quantité de minerais d’uranium qui sont extraits de ma terre et qui sont exportés vers la France. » Le contrôle postindépendance par l’ancienne puissance coloniale a aussi une vocation diplomatique. La France a considéré, explicitement ou pas, que ses anciennes colonies lui assuraient une « réserve de voix » dans les débats à l’Organisation des Nations unies, y compris quand il s’agissait de statuer sur l’Irak ou sur les Balkans.
Au « C’est lui ou le chaos », j’oppose l’alternative « C’est lui et le chaos ». C’est hélas ce que nous enseigne l’histoire récente du continent.
La complaisance de l’ancienne puissance coloniale à l’égard de l’Etat indépendant qui se transforme en dictature est donc bien réelle?
Complaisance oui, et très souvent active en vertu de cet aphorisme qui est, à mon avis, une ineptie : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. » Combien de fois, lorsque j’énonçais des critiques sur la performance de tel ou tel despote africain en matière de droits de l’homme, ai-je vu et entendu un conseiller élyséen, un ambassadeur ou un diplomate aguerri lever les yeux au ciel, soupirer à fendre l’âme et dire : » On sait très bien tout cela. Mais c’est lui ou le chaos. En face, il n’y a personne. Les opposants sont des aventuriers. » Le primat obsessionnel de la stabilité a conduit à cette complaisance active. Au » C’est lui ou le chaos « , j’oppose l’alternative » C’est lui et le chaos « . C’est hélas ce que nous enseigne l’histoire récente du continent.

Aujourd’hui, la lutte contre le djihadisme n’a-t-elle pas pris la place, et ne prendra-t-elle pas de plus en plus la place de ce qu’était le combat contre le communisme à l’époque des indépendances?
Oui. C’est la raison pour laquelle, dans plusieurs des portraits de tyrans que je dresse, je rappelle les données géopolitiques de la guerre froide comme facteur décisif dans certaines alliances, fractures et mansuétudes. Il faut inscrire cette continuité historique dans un contexte géopolitique plus large avec le primat souvent aveugle de ce que l’on appelle, par commodité de langage, la realpolitik. Mais il arrive que la realpolitik soit irréaliste. C’est ce que l’on mesure trop peu aujourd’hui dans la plupart des exécutifs occidentaux : cette obstination de la realpolitik creuse entre les pays occidentaux et les sociétés civiles africaines, notamment dans les jeunes générations, un fossé de plus en plus abyssal. Le message de la stabilité à tout prix devient parfaitement inaudible et incompréhensible.
Mobutu Sese Seko est-il l’archétype du chef d’Etat qui a su se rendre intouchable, notamment parce qu’il était le garant de l’unité du Congo et le meilleur rempart contre l’expansion communiste?
Il apparaît comme tel dans les télégrammes diplomatiques et parfois même dans des déclarations officielles américaines ou européennes. Il est effectivement l’archétype du rempart résolu et réputé fiable contre la contagion communiste. Et puis, n’oublions pas son pedigree. On est revenu récemment et à bon droit sur les circonstances de la liquidation de Patrice Lubumba (NDLR : le premier Premier ministre du Congo, assassiné en 1961). Il est établi maintenant, témoignages et documents à l’appui, que tout cela s’est fait avec le concours des services belges, américains et français, pour ne citer que ceux-là. Mobutu est perçu, non sans raison, comme » notre homme à Kinshasa « . Mais comme c’est un politique subtil et retors, il joue sur les deux tableaux. Il est à la fois l’agent actif et loyal des puissances qui l’ont aidé à monter sur le » trône « . Et il va, tardivement, invoquer un retour à l’authenticité africaine pour se conférer une légitimité » autochtone » auprès du peuple congolais et des Etats voisins. Mais cela ne peut absolument pas occulter la genèse de son accession au pouvoir et la complicité confirmée des puissances occidentales.

Le cas unique du Guinéen Ahmed Sékou Touré ne démontre-t-il pas a contrario qu’il n’y avait pas d’alternative à la coopération avec l’ancienne puissance coloniale pour les chefs d’Etat de l’indépendance?
Au fond, est-ce que Sékou Touré illustre une forme de malédiction ou de déterminisme historique? Son exemple condamne-t-il ces chefs d’Etat à une alternative funeste : la soumission ou la fracture ? Il est exact que la France a été très mauvaise perdante. On connaît l’orgueil de Charles de Gaulle qui a conçu une immense amertume à l’endroit du président guinéen après le rejet de son offre d’association. Par la suite, les services français ont activement participé à plusieurs tentatives de déstabilisation, qu’il s’agisse d’une tentative de putsch avec l’aval du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ou d’une opération visant à noyer le pays nouvellement souverain sur des tombereaux de faux billets pour déstabiliser l’économie. Clairement, Ahmed Sékou Touré a des circonstances atténuantes. Il a tenu bon. Et, ensuite, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, de 1974 à 1981, la France a bien dû pactiser avec celui-ci. Mais ce contexte n’absout en rien Ahmed Sékou Touré de sa propre dérive dictatoriale. Alors même qu’il était révéré en Guinée, en Afrique et même aux Etats-Unis au sein de la communauté afro-américaine, comme l’incarnation de celui qui s’oppose à la brutalité de l’ordre colonial, il s’est engouffré dans une sorte de fuite en avant tyrannique invraisemblable. Citer le nom du camp Boiro devant n’importe quel Guinéen de plus de 45 ans, vous lui glacez l’échine. Le camp Boiro était ce mouroir assorti d’un centre de tortures où des centaines d’opposants réels ou fantasmés ont été suppliciés et assassinés.
Cette obstination de la realpolitik creuse entre les pays occidentaux et les sociétés civiles africaines, notamment dans les jeunes générations, un fossé de plus en plus abyssal.
Peut-on établir une distinction entre le traitement franco-belge et le traitement anglo-saxon de la période postcoloniale?
Les traitements ont été formellement différents. Mais la trajectoire d’un Robert Mugabe au Zimbabwe ou d’un Idi Amin Dada en Ouganda invalide à mon sens une thèse largement répandue selon laquelle le modèle de décolonisation anglo-saxon aurait été plus performant que l’antimodèle franco-belge, à l’aune de l’enracinement de pratiques démocratiques. Non. C’est peut-être intellectuellement attrayant. Mais cela ne résiste pas à l’analyse. Robert Mugabe a été la figure mes sianique de l’indépendance de l’ex-Rhodésie du Sud puis le fossoyeur de sa propre nation. Et il a eu, lui aussi, des relations extrêmement ambiguës avec la Couronne britannique et avec tel ou tel Premier ministre. Le constat est le même pour un Mugabe, un Amin Dada, un Mobutu ou un Bokassa. Ces despotes ne sont au fond que les rejetons monstrueux de l’aberration coloniale. Que celle-ci se décline dans la langue de Shakespeare ou dans celle de Molière ne change pas grand-chose à l’affaire.
Que dit de l’Afrique d’aujourd’hui le fait que l’ancien président tchadien Hissène Habré (1982 – 1990) est à ce jour le seul potentat du continent à avoir été jugé par un tribunal africain?
Espérons qu’il ne soit pas le dernier. Car d’autres mériteraient de figurer dans ce box. D’abord, cela tord le cou à un autre fantasme essentialiste occidental qui voudrait que l’Afrique n’est pas capable de juger ses propres despotes. Des chambres africaines extraordinaires, pour reprendre leur nom officiel, siégeant à Dakar, la ville où il avait trouvé refuge, ont condamné en 2016 Hissène Habré à la prison à perpétuité. Un jugement qui s’inscrit dans le contexte de la faillite de la justice internationale version Cour pénale internationale de La Haye, théâtre d’une succession de désastres symboliques et juridiques. J’ai vu dans la conduite par une cour africaine du procès d’un des tyrans les plus abjects de l’Afrique postcoloniale, dans son verdict et dans le respect de la peine infligée, un véritable gage d’espérance et une mauvaise nouvelle pour ceux qui, par occidentalo-centrisme, nous expliquent dans un même souffle que l’Afrique ne peut juger ses tyrans pas plus qu’elle ne peut accueillir les oeuvres d’art pillées lors des aventures coloniales.