
Sophie Galabru : «Une famille qui accepte la désunion a plus de chances de réussir» (entretien)

«L’idée de famille est devenue, à mes yeux, profondément équivoque. Dès l’enfance, je m’étais mis en tête de l’honorer autrement mieux que ne l’avaient fait mes parents et mes grands-parents. J’énonçais, pour moi-même, des formules d’exhortation contre le péril de la séparation et de l’absence, mais aussi contre les dangers de l’autoritarisme et de l’exploitation menant à exiger des enfants l’amour, voire la dévotion. Je me répétais que “je saurais créer un lieu libre et épanouissant pour mes enfants”.» Ainsi commence, sur un mode intime, l’essai de la philosophe Sophie Galabru, Faire famille (1), pour «mieux comprendre les liens familiaux et mieux les vivre». Son étude sera donc nourrie de son expérience personnelle, elle qui est la petite-fille de l’acteur Michel Galabru et la fille d’un autre comédien, Jean Galabru. Derrière la vie sous les projecteurs, surgissent les tourments des tensions, de l’absence, de la séparation… Pas simple de faire famille. Une expérience paradoxale qui consiste à «accueillir pour apprendre à quitter, (à) se réunir en acceptant la séparation». Faire famille aide à y parvenir.
La conversation et le partage de visions du monde, même conflictuelles, sont fondamentaux pour créer du lien.
«Pour qu’une famille perdure, elle doit offrir à ses membres de la liberté comme du lien, de la différence et de la ressemblance», écrivez-vous. Est-ce le principal défi pour «faire famille»?
J’identifie cette tension comme principale et cruciale. La famille est une zone de turbulences. Elle est prise dans une double injonction qui peut paraître contradictoire: créer du commun et faire face à la revendication individualiste d’exister pour soi. Tout groupe social est confronté à la difficulté d’articuler des individualités à du commun. Mais c’est encore plus le cas avec la famille par la cohabitation et l’intimité géographique qu’elle implique souvent. L’injonction contradictoire vaut aussi pour les parents qui sont censés accueillir, soigner, aimer leur enfant pour l’amener à l’émancipation et au départ. C’est susceptible de générer beaucoup de tiraillements chez eux, qui peuvent osciller entre mouvements fusionnels, mises à distance… mais aussi chez les enfants qui peuvent naviguer entre loyauté, rejet, distinction tout en se culpabilisant de s’émanciper.

Vous avez une formule étonnante qui est de dire que «la famille ne triomphe qu’en échouant: une famille admirable est peut-être celle qui accepte de manquer l’idéal de cohésion afin que ses membres soient véritablement accueillis, reconnus et aimés»…
Une famille qui confond l’union avec l’uniformité, qui est crispée sur des schémas et des hiérarchies a, à mon avis, peu de chances de traverser les évolutions dans le temps et de perdurer. Une famille qui accepte la désunion, et donc la séparation, l’émancipation, la liberté, parfois la dissidence… a plus de chances de réussir, au sens de tenir et de créer une véritable intimité entre les êtres.
Est-ce à dire que les liens familiaux resteront immuables malgré ces difficultés?
Cela signifie que l’amour familial réside dans l’acceptation de conflits, de divergences, d’éloignements, d’émancipations, bref dans la capacité à accepter la liberté des autres. C’est cela qui permettra, quand il y aura des désaccords ou des départs du foyer, que la famille reste quand même un groupe uni par des liens de solidarité, de compréhension et de respect.
La montée de l’individualisme complique-t-elle la volonté de faire famille?
Oui. La revendication individuelle d’exister pour soi-même et d’avoir d’autres identités liées à son travail, à des activités, complexifie la démarche de faire famille. Mais je trouve que c’est plutôt un bien. Je ne suis absolument pas effrayée par la montée de l’individualisme. Ce qui est alarmant, c’est la tentative d’étouffer les êtres au nom d’un groupe dont on ne voit pas forcément la valeur réelle à part celle d’être un collectif. Le groupe ne tire pas sa valeur du fait qu’il est un groupe. Il la tire du fait de respecter les êtres qui le composent et de partager certaines valeurs véritablement humaines.
La famille demeure-t-elle une institution dans nos sociétés européennes?
Elle demeure une institution dans la mesure où le droit et l’Etat la reconnaissent comme telle et prescrivent des droits et des obligations. L’Etat favorise encore le modèle familialiste par une politique d’aides, d’allocations familiales, d’encouragements, d’incitations à la procréation et la mise en couple. A cette aune, elle reste une institution importante et normative.
Quelle définition donneriez-vous de la famille?
La famille est une institution qui a pour principale mission l’accueil d’êtres vulnérables dont elle a la responsabilité. Une responsabilité qui peut se décliner dans le fait de prendre soin, nourrir, sécuriser, soutenir, éduquer, amener à l’autonomie quand il s’agit d’enfants.
Est-il important que des actes fassent vivre la famille?
Le plus court chemin pour être en famille est de vivre sous le même toit, ce qui n’a pas toujours été le cas. Le concept apparaît au XVIIIe siècle, s’accentue dans la période romantique et encore plus au XXe siècle. Mais ce n’est pas la seule façon de faire famille. Une fois qu’existent des éloignements géographiques, ce qui peut faire perdurer ce lien, c’est l’exigence de la qualité relationnelle, la capacité de se faire confiance, la possibilité de se confier, ou de partager des activités ensemble. La verbalisation, la conversation et le partage de visions du monde, même conflictuelles, sont fondamentaux pour créer du lien.
Est-ce ce qui manque souvent à un certain nombre de familles?
Oui. Leurs missions nourricière et d’éducation peuvent faire perdre de vue aux parents qu’ils peuvent être aussi des guides «spirituels», ou en tout cas des interlocuteurs avec lesquels converser, échanger et décrypter le monde. L’oublier peut laisser les parents démunis quand les enfants sont autonomes et devenus adultes. S’ils ne sont plus parents nourriciers ou donneurs d’ordre, il peut leur arriver de ne plus savoir sur quel pied danser ou quel rôle occuper. Mais, à mon sens, il serait injuste de considérer que l’enfant n’est pas apte à entendre, à converser, à comprendre alors qu’il a une intelligence tout aussi importante que celle d’un adulte, mais simplement différente.
De plus en plus, l’enfant ne peut-il pas lui-même apprendre des choses à ses parents?
Les enfants n’ont pas nécessairement le bagage pour transmettre des choses à leurs parents. Mais ils ont de quoi les questionner, les aider à élucider des zones d’ombre ou à mettre au jour des troubles qu’ils ressentent. Les enfants sont d’une extrême disponibilité pour leurs parents, dont ils ont besoin. Ils perçoivent facilement les troubles, les malaises. Ils se posent des questions. Ils font montre d’une empathie supérieure. Parfois, ils partagent des visions qui peuvent être intéressantes. Ils apprennent à leur parents à être parents. Ils ont beaucoup de choses à communiquer si on les prend au sérieux.
Vous expliquez que l’enfant peut aider à trouver une solution à un litige, gardé secret, entre parents.
La psychanalyse et la psychologie clinique nous révèlent en effet que beaucoup d’enfants ressentent, en creux de silences, de mensonges, d’angoisses ou d’épisodes de tristesse de leurs parents, qu’un secret s’est constitué autour d’un événement souvent traumatique et violent, ni verbalisé ni accepté, qui suscite de la honte. Par conséquent, ils peuvent – je l’ai vécu dans ma propre famille – somatiser et développer des pathologies afin de manifester un mal-être. Evidemment, tout cela n’est pas conscient.
Lire aussi | Les 6 clés pour avoir une famille heureuse
«La famille de sang ne détient aucun don spécial ou inné pour l’amour», selon vous. L’amour familial ne va donc pas nécessairement de soi?
Le fait de procréer induit des obligations et des responsabilités qui sont presque de type social et politique. Elever un enfant, c’est élever un être qui prendra une place dans la société, qui entretiendra des relations, qui fera des choix éthiques ou pas, qui répercutera de la violence ou pas, selon, justement, la façon dont il aura été aimé, dont il aura été éduqué à certaines valeurs. C’est une mission cruciale. Mais elle n’a rien à voir avec le sang. C’est une mission que certains assument en adoptant ou en étant famille d’accueil. Donc, beaucoup d’adultes peuvent assurer ces missions sans avoir des liens de sang avec les enfants. Dans une vision très radicale, Platon et Socrate estimaient qu’on pouvait délier les liens de sang, et que l’important était que des adultes s’occupent bien des enfants.
Pourquoi les successions sont-elles souvent des moments compliqués pour l’harmonie des familles?
Les deuils réveillent des regrets, des remords, des questionnements refoulés, ou la frustration de ne pas avoir été aimé d’une manière assez bienveillante ou compréhensive. Toutes choses que l’on n’a pas osé évoquer du vivant de ses parents. Parfois, ils cristallisent aussi des rivalités entre frères et sœurs. Les parents – c’est un sujet encore tabou – ont pu avoir des préférences ou se sentir plus proches d’un enfant plutôt que d’un autre. Un sentiment qu’ils ont pu exprimer cruellement dans des partages inégaux d’affection comme de biens. Les successions, tous les cabinets notariés l’observent, sont des moments de grande crise qui, en plus, surviennent dans une période critique au plan psychologique. On met enfin sur la table ce que l’on n’osait pas dire… et c’est une source de tensions.

Si elles existent, le devoir des parents n’est-il pas de cacher ces préférences?
Idéalement, oui. Mais il arrive que l’on n’y parvienne pas. L’injonction à l’amour est toujours une fausse route. On ne peut jamais forcer quelqu’un à nous aimer. C’est un combat perdu. En revanche, on peut s’obliger à respecter l’autre et à défendre les valeurs d’équité, d’égalité et de justice. En tant que parent, on peut en effet s’efforcer de ne pas désavantager un enfant et de ne pas montrer ses éventuelles préférences, d’autant qu’elles peuvent varier dans le temps. Pour autant, certains n’y arrivent pas parce que, souvent, ces préférences se développent pour de mauvaises raisons, narcissiques notamment. Ceux-là auront envie de privilégier l’enfant qui leur ressemble, qui ne les critique pas, qui les flatte non pas parce que la relation est belle et authentique mais parce qu’elle est narcissiquement désirable. Cet enfant-là ne crée pas de difficultés. Le parent autoritaire a une préférence pour lui. Et il a envie de le faire sentir aux autres. En ce sens, la préférence est aussi l’envers d’une punition contre les autres enfants. D’où l’intérêt, parfois, pour ces parents, de faire connaître cette préférence.
La vie ensemble déteint sur les êtres. Psychologiquement aussi, on transmet parfois sans s’en rendre compte.
La famille est un lieu où les faits d’abus sexuels sont les plus répandus. Comment l’expliquer?
Les abus sexuels ont d’abord lieu dans la famille et dans le cercle de ses proches. Je pense que cela résulte du fait que ces familles ne cherchent pas à être des lieux d’accueil chaleureux et qu’elles ne sont donc pas des refuges. Ce sont des foyers envahis et saturés par des problèmes d’abus de pouvoir. En effet, le crime sexuel dans ce cadre-là a à voir avec la domination plus qu’avec la sexualité. C’est-à-dire le désir de contrôler, de s’approprier, de dominer un être. Ce désir passe par le corps. Ces familles sont avant tout des groupes sociaux très hiérarchisés dominés par des figures tutélaires, tyranniques, qui ont besoin de s’emparer du corps de certains êtres, surtout les plus vulnérables.
Ce fléau pourrait-il diminuer du fait de la prise de conscience de la masculinité toxique?
Statistiquement, il semblerait que les violences intrafamiliales et les crimes sexuels soient commis majoritairement par des hommes en raison non pas d’une faille liée à la masculinité mais d’une faille liée au patriarcat. Comme il a été le schéma dominant et qu’il hante encore inconsciemment ou consciemment les éducations, l’homme est pris dans l’idéologie de ce système qui l’«autorisait» à commettre des violences.
Faire famille implique-t-il nécessairement un travail de transmission?
Oui, qu’il s’agisse d’enfant procréé ou adopté. D’abord, il y a une transmission génétique. C’est un fait. Mais il y a aussi une transmission d’habitudes, par mimétisme et appariement. La vie ensemble déteint sur les êtres. Il s’agit de transmissions complètement inconscientes. Psychologiquement aussi, on transmet parfois sans s’en rendre compte. Nous avons parlé précédemment des secrets et des émotions refoulées qui émergent au moment d’un deuil. Enfin, la transmission est tout à fait consciente lorsqu’on souhaite perpétuer des valeurs, des désirs, une activité, une vocation. Tantôt, c’est une façon narcissique de vouloir se prolonger à travers son enfant, vecteur d’un désir personnel qui a été abîmé ou qui n’a pas pu se réaliser. Tantôt, c’est une façon de donner à son enfant les moyens de trouver une voie, un chemin, sachant qu’il pourra toujours se réapproprier cette transmission et la réinterpréter à sa façon.
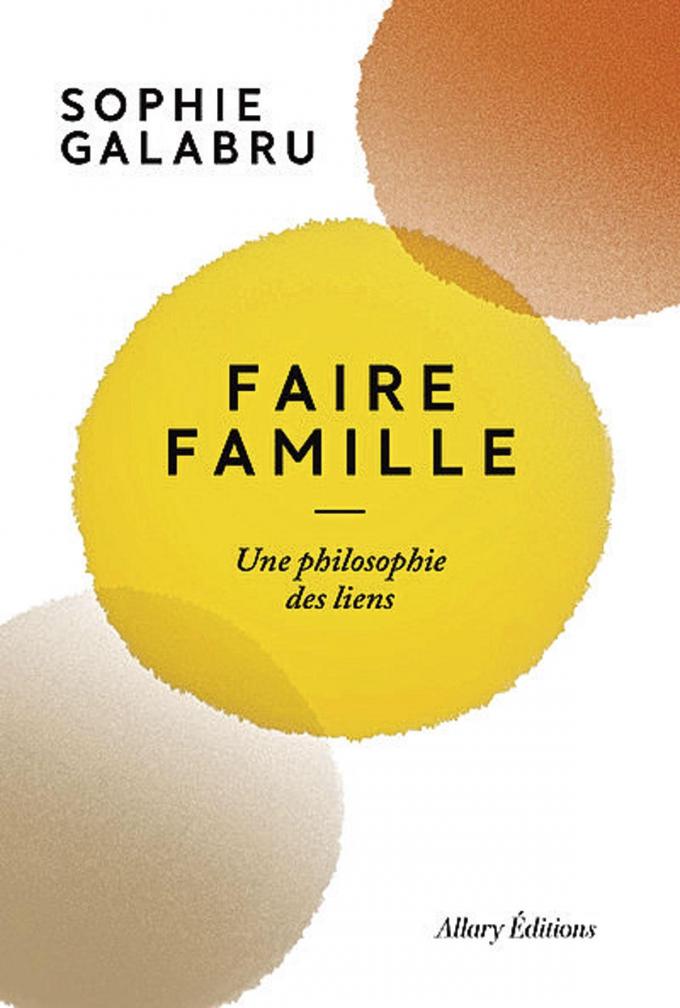
Cela explique-t-il que la famille soit toujours la base de notre identité?
Il y a eu un basculement dans l’histoire. Jusqu’à la période romantique, en tout cas en France et en Europe, on cherche à «faire lignée». La fonction première de la famille est de faire des enfants. Des enfants qui seront des supports. Ils sont soit des «agents économiques» pour faire vivre surtout les familles les plus pauvres, soit les dépositaires d’un nom et d’un patrimoine. Aujourd’hui, la transmission de patrimoine est toujours importante, surtout dans les familles aisées. Mais on a pris conscience aussi que la transmission se joue sur de nombreux autres aspects, existentiels, affectifs, psychologiques… Par le passé, la transmission était aussi immatérielle, au-delà de sa dimension matérielle. Mais on a beaucoup plus de lucidité sur cette transmission inconsciente et immatérielle aujourd’hui.
Votre grand-père paternel et votre père étaient comédiens. A propos du théâtre, vous dites qu’il «était à la fois un terreau familial et un empêcheur de faire famille: entravant la proximité et la présence, il était pourtant, indéniablement, notre lien et notre langage». En avez-vous souffert?
Oui. Un exemple. Mon grand-père étant une personnalité publique, il était souvent accaparé par toutes sortes de personnes désireuses de travailler avec lui ou simplement de l’approcher. Il avait, en outre, du mal à cloisonner sa vie professionnelle et sa vie familiale. Cela pouvait donc induire qu’un déjeuner prévu en famille ou à deux se retrouve soudainement transformé en un déjeuner de travail. Des gens complètement inconnus s’incrustaient à ces moments-là, ce qui était assez déstabilisant. Et puis, la vie de tournée théâtrale impliquait une absence immense. Aussi, quand mon père nous a annoncé, à ma mère et à moi – j’avais 8 ans –, qu’il allait devenir comédien, j’ai tout de suite compris ce que cela signifiait. Une désertion du domicile. J’en ai été extrêmement affectée. J’ai compris que j’allais perdre mon père. Ensuite, il a divorcé. Mais de toute façon, il aurait été absent.
Est-il difficile de faire famille sans un minimum de présence?
L’absence prolongée, régulière, déstabilise tout de même un foyer, je pense. Mon père était pianiste à l’origine. Le théâtre n’était pas sa première passion. Il s’est lancé dans cette voie pour se rapprocher de son propre père dont il avait été séparé par le théâtre, et par le divorce et le remariage de mon grand-père.
Auriez-vous pu aussi suivre la même voie pour vous rapprocher de votre père?
Je l’ai fait. J’étais très réticente à l’idée de faire du théâtre, très effrayée par ce milieu et cette vie. Mais à un moment, j’ai quand même franchi le pas en suivant le cours animé par mon père et mon grand-père, pour les comprendre, être proche d’eux.
Dans les dernières pages de votre livre, vous écrivez que «la famille “dirige” au sens théâtral du terme, c’est-à-dire qu’elle “indique” un style de vie, elle “désigne” une représentation du monde, elle “fait signe” vers des désirs, elle “porte” des valeurs». Etes-vous réconciliée avec le théâtre?
Bien sûr, parce que quand on devient adulte et qu’on développe son propre chemin, ses propres passions, on finit par comprendre. On ne regarde plus ses parents par le prisme de son regard d’enfant. On les regarde comme des individus qui ont une vie, indépendamment de la nôtre. Ce ne sont pas que des parents. Grandir, c’est comprendre cela. Le théâtre m’a alors semblé comme une richesse, une passion dont je pouvais appréhender l’attrait, et un élément constitutif de ma famille paternelle. M’y intéresser était une façon de décrypter leur sensibilité. Ce faisant, je ne pouvais qu’y adhérer.
(1) Faire famille. Une philosophie des liens, par Sophie Galabru, éd. Allary, 242 p.
Bio express
1990 Naissance, à Clichy.
2013 Publie un livre d’entretien avec son grand-père, le comédien Michel Galabru, Tout est comédie: abécédaire du théâtre et autres fantaisies (Le Cherche Midi).
Début des années 2020 Professeure de philosophie à l’université Paris-1 Sorbonne.
2022 Publie Le Visage de nos colères (Flammarion) pour lequel elle reçoit le Prix lycéen du livre de philosophie.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici