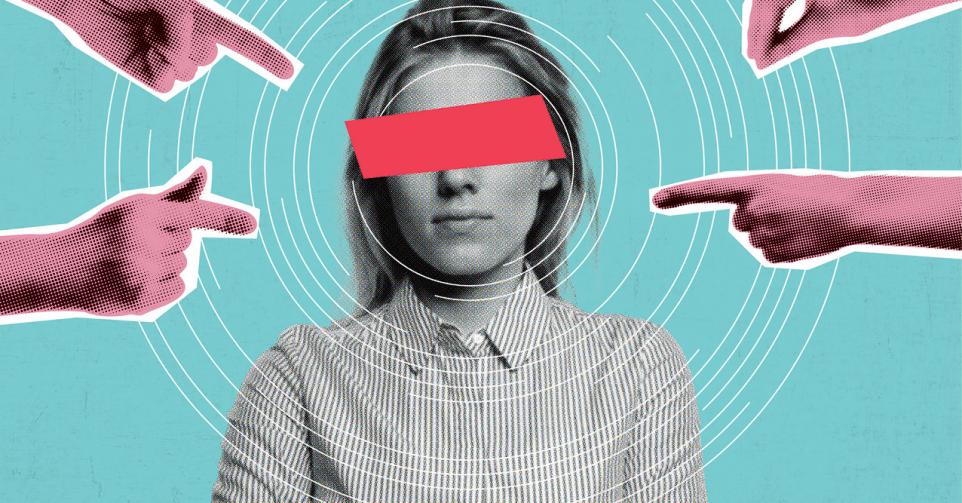Apprendre à poser ses limites sans rompre le lien, à se protéger sans disparaître. Une ressource précieuse, mais qui soulève une question décisive: la self-défense psychologique suffit-elle, à elle seule, à réparer ce que les structures continuent de déliter? Témoignages et décryptage.
A 31 ans, Yanis aurait pu cocher toutes les cases d’une réussite tranquille: CDI dans une grande boîte tech parisienne, équipe jeune, salaire confortable et des open spaces baignés de lumière qui donnent sur la Seine. Mais derrière le vernis lisse du bien-être en entreprise, il raconte une autre réalité. Celle des petites humiliations, symboliques, presque invisibles, des remarques «passives-agressives» glissées entre deux réunions, des réunions où l’on vous coupe systématiquement la parole, des e-mails où l’on vous «met en copie» pour mieux vous exposer. «J’ai tenu comme ça deux ans, raconte-t-il. Au début je me disais que je me faisais des films. Mais au bout d’un moment, on se sent pris dans une forme d’usure lente.» Ce n’était pas du harcèlement frontal, reconnaît-il. Juste un climat. Une ambiance générale. Des collègues qui s’approprient son travail. Un manager qui l’infantilise. Des remarques ironiques sur son nom, parfois sur ses origines, jamais vraiment directes. «Je n’arrivais pas à poser des mots dessus. C’était diffus. Mais ça finissait par me coller à la peau.»
Yanis n’a pas claqué la porte. Il n’a pas non plus tout envoyé valser dans une crise éclatante. Il a simplement décidé de se protéger autrement. Un article découvert par hasard évoquait le concept de «self-défense mentale», une formule qui résonne tout à coup comme une évidence. «Là, je me suis dit: peut-être que le problème, ce n’est pas moi. Peut-être qu’il faut que j’apprenne à me protéger autrement.»
Depuis, il a lu, il s’est formé, il a appris à nommer. Et surtout, insiste-t-il, il ne joue plus au jeu de la séduction permanente. «Comprendre que certaines attitudes étaient manipulatoires, que je n’étais pas fou, ça m’a sauvé», poursuit-il. Il est toujours dans la même entreprise, mais ne se laisse plus happer. «Je ne cherche plus à plaire à tout le monde. Je pose mes limites, même si c’est parfois inconfortable. C’est ça que j’appelle aujourd’hui de la « défense ». Pas fuir. Pas riposter. Juste se protéger sans s’effacer.»
Se défendre, sans sombrer
Bien que le concept de self-défense psychologique ne fasse pas encore l’objet d’études quantitatives spécifiques, les données disponibles sur les violences psychologiques au travail et dans la sphère conjugale soulignent l’importance de développer des stratégies de protection mentale. Selon une enquête de l’Organisation internationale du travail (OIT), 17,9% des salariés, hommes et femmes, déclarent avoir été victimes de violences ou de harcèlement psychologiques au cours de leur vie professionnelle. En Belgique, 9,5% des travailleurs ont été confrontés à du harcèlement moral de manière hebdomadaire au cours des six derniers mois, selon une étude menée en 2024 par Idewe, un service externe de prévention et de protection au travail. Par ailleurs, 42,1% des femmes en Wallonie et 44,4% à Bruxelles ont déclaré avoir subi du harcèlement sexuel au travail au moins une fois au cours de leur vie professionnelle, rapporte Iweps, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique. Ces chiffres, bien qu’alarmants, ne capturent pas toujours la nature insidieuse de ces violences, souvent invisibles et difficiles à quantifier.
Dans ce paysage chiffré, froid mais éloquent, se pose la question de la manière de se défendre sans sombrer. C’est là qu’intervient, suggèrent des experts, la notion, encore méconnue, de self-défense psychologique, non pas une fuite, mais une manière d’habiter la relation sans s’effacer.
Le parcours de Yanis résonne avec les analyses de Jérôme Palazzolo, psychologue et auteur du Petit Traité de self-défense psychologique. Selon lui, les conflits professionnels ne naissent pas nécessairement de violences visibles ou de grandes confrontations, mais bien souvent d’un enchaînement de maladresses, de rigidités et d’aveuglements: «En milieu professionnel, il est courant de voir plusieurs erreurs lorsqu’on est confronté à une situation conflictuelle.» Et d’énumérer: «Evitement du conflit (ignorer ou éviter le problème dans l’espoir qu’il se résolve tout seul peut souvent aggraver la situation à long terme). Réaction émotionnelle (répondre de manière impulsivement émotionnelle plutôt que de prendre du recul pour évaluer la situation objectivement). Manque de communication (ne pas communiquer clairement ses préoccupations ou ne pas écouter activement l’autre partie peut mener à des malentendus et à une escalade du conflit). Refus de compromis (adopter une position rigide sans être disposé à trouver un terrain d’entente peut rendre la résolution impossible). Utilisation de pouvoir ou d’autorité (abuser de son autorité pour imposer une solution plutôt que de rechercher un consensus peut créer du ressentiment et compromettre les relations futures).»
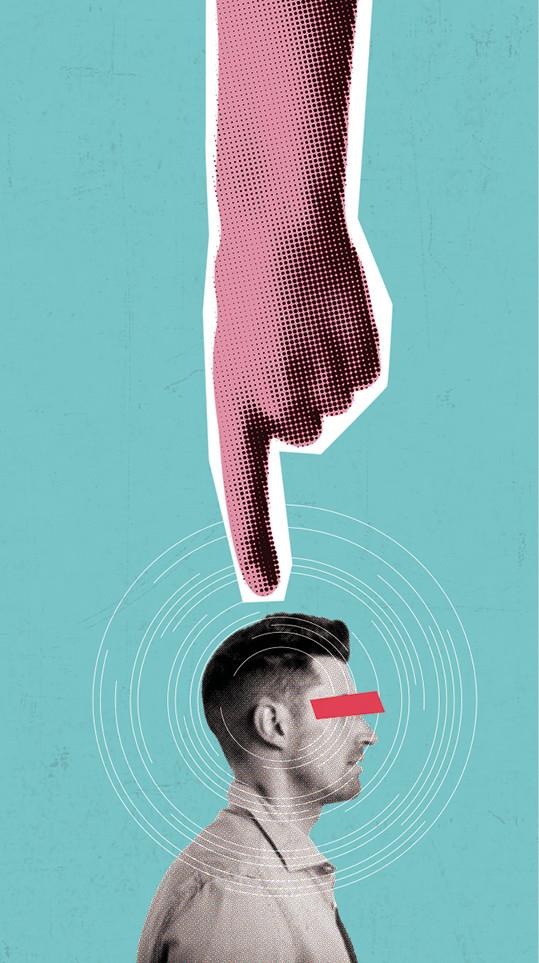
Ce que Yanis a peu à peu compris, c’est précisément ce piège des comportements délétères mal identifiés, que dans une atmosphère conflictuelle (parfois toxique), le silence n’est pas neutre. Et que, faute de pouvoir changer son environnement, il devait apprendre à se positionner.
Mais ce cheminement personnel, aussi courageux soit-il, ne doit pas faire oublier les racines plus profondes de ce que vit Yanis. Car la souffrance au travail n’est pas toujours une affaire d’individus inadaptés ou hypersensibles. C’est, plus largement, le symptôme d’un effritement du lien social dans les organisations modernes. Le sociologue Tanguy Mousserion, spécialiste du monde du travail, le rappelle: «La recrudescence des violences psychologiques dans les milieux professionnels n’est pas un phénomène contextuel: elle témoigne d’un dérèglement profond dans la manière dont les organisations structurent le lien social au travail. La souffrance ne naît pas toujours d’actes brutaux ou spectaculaires, mais de pratiques managériales insidieuses, de réorganisations permanentes, d’une pression normative diffuse qui pousse chacun à faire ‘‘plus’’ avec ‘‘moins’’, dans un climat de défiance ou de compétition latente.»
En d’autres termes, Yanis ne fait pas seulement face à un chef autoritaire ou à des collègues indélicats. Il évolue dans un système où les règles du jeu sont floues et où les exigences de performance sont omniprésentes sans être toujours définies.
Dans ce climat d’instabilité, la self-défense psychologique n’apparaît plus comme une simple coquetterie ou une lubie de développement personnel, mais comme une nécessité vitale. Comme une manière de ne pas sombrer dans la passivité, tout en évitant l’affrontement ou la conflictualité systématique. C’est là peut-être sa force: permettre à chacun de retrouver un peu de prise, un peu de respiration, sans forcément changer d’entreprise ou de métier.
9,5%
des travailleurs ont été confrontés à du harcèlement moral de manière hebdomadaire au cours des six derniers mois, en Belgique.
Rompre l’isolement
Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Car ce que l’on qualifie aujourd’hui de violence psychologique est rarement spectaculaire. Elle ne laisse ni bleus ni cris, mais fonctionne à bas bruit. Pour le sociologue Tanguy Mousserion, «la première stratégie, sans doute la plus difficile, consiste à nommer ce qui est en train de se jouer. Ce qui rend la violence psychologique si destructrice, c’est justement son caractère insidieux, sa capacité à se déguiser en exigence professionnelle ou en « humour ».» C’est pourquoi il insiste sur l’importance de se construire un récit cohérent: «Il faut documenter les faits, tenir un journal, conserver les échanges écrits: cela permet de reconstruire un récit cohérent face à une violence qui fragmente et déstabilise.» Mais sortir de l’isolement est tout aussi fondamental. «Il est également essentiel de rompre l’isolement: parler à des collègues, consulter la médecine du travail, solliciter les représentants du personnel. Reprendre pied dans le collectif est une forme de résistance.» Parfois, ajoute-t-il, la meilleure décision consiste à faire un pas de côté. «En dernier recours, il faut parfois accepter qu’un retrait temporaire (arrêt, changement de poste) puisse être une forme de sauvegarde de soi.»
Mais les violences psychologiques ne s’arrêtent pas aux frontières du bureau. Si elles prennent parfois la forme d’un climat délétère en entreprise, elles peuvent aussi se glisser au creux de la vie intime, dans des relations conjugales où la domination se distille sans cris ni coups. A 29 ans, Elise parle doucement de son expérience, comme si chaque mot devait d’abord être filtré par la mémoire avant de s’autoriser à exister. Cette retenue, elle l’a peaufinée durant les années passées auprès de R., son ex-compagnon. Pas de cris, pas de coups. Mais un lent effritement de soi. «Il ne me frappait pas. Il n’a jamais crié en mode « je te crie dessus pour t’intimider ». Mais il me dégradait par petites touches, sournoisement.» Le piège, dans ce type de relation, c’est qu’il n’y a pas de scène spectaculaire, rien à photographier, à documenter. Juste une ambiance. Une oppression larvée: on ne voit rien, mais on finit par suffoquer. «J’ai commencé à me dire que c’était moi, le problème. Je passais des heures à relire nos textos pour comprendre ce que j’avais mal dit.»
Cette lente mise à distance du réel est l’un des signes caractéristiques des violences psychologiques conjugales. L’espace mental de la victime est colonisé par le doute, le silence, l’injonction à la justification. Elise s’isole, décline les dîners familiaux, cesse de répondre aux appels des amis. Ce n’est qu’en entendant, presque par hasard, le terme de «self-défense psychologique» prononcé lors d’une formation qu’un premier sursaut s’opère. Comme un mot de passe qui ravive la conscience. Elle engage une thérapie. Pas pour dénoncer. Pas pour accuser. Mais pour reprendre pied. «Le simple fait de pouvoir dire « je ne suis pas d’accord, je me retire« , c’était une victoire, minuscule certes, mais une petite victoire qui permet de respirer un peu; ça fait partie d’un panel de petits gestes de self-défense psychologique à mobiliser.»
«Ce qui rend la violence psychologique si destructrice, c’est son caractère insidieux, sa capacité à se déguiser en exigence professionnelle ou en ‘‘humour’’.»
Stop, Look and Listen
Pour Jérôme Palazzolo, ce type de cheminement, encore trop méconnu, est pourtant fondamental. «Dans un contexte personnel comme une dispute conjugale ou des tensions familiales, il est crucial de désamorcer le conflit sans l’éviter», insiste-t-il. Des stratégies simples permettent parfois de rompre le cercle toxique: «Rester calme et réguler ses émotions; écouter activement et valider les émotions; éviter les accusations et le blâme; prendre du recul et relativiser; trouver un compromis sans céder sur l’essentiel; proposer une pause si nécessaire; introduire une touche d’humour ou d’affection; conclure positivement.» Autant de gestes en apparence élémentaires, mais leur portée réelle ne se mesure qu’à l’aune de leur mise en œuvre, précisément lorsque l’environnement relationnel devient incertain, chargé, voire hostile. C’est alors que leur simplicité devient exigence.
C’est précisément ce que permet, selon lui, la méthode «Stop, Look and Listen». Un enchaînement en trois temps: «Stop (arrêter), avant de réagir sous le coup de l’émotion; Look (observer), prendre du recul et observez la situation avec objectivité; Listen (écouter activement), qui consiste à laisser l’autre s’exprimer sans interruption. Reformulez alors ses propos pour montrer que vous avez compris», résume-t-il. Elise, sans le savoir, a mis en œuvre certains de ces principes. Apprendre à suspendre le réflexe défensif, à nommer sans s’accuser, à observer sans se soumettre: autant d’étapes vers une reconquête de soi.

Ces gestes de résistance intime, si modestes soient-ils, dessinent une éthique du soin de soi dans des environnements parfois inconfortables. Mais ils ne sauraient constituer une réponse suffisante si, dans le même temps, rien ne bouge autour. Car la self-défense psychologique, aussi précieuse soit-elle, ne peut devenir un substitut à une responsabilité collective. Elle n’a pas vocation, les experts du monde du travail y insistent, à masquer les carences systémiques, ni à exonérer les structures de leur part dans la violence ordinaire. Il ne s’agit pas de faire peser sur les seuls individus la charge de leur propre protection, comme si chacun devait apprendre à se défendre, seul, face à un monde déréglé. Pour que ces pratiques soient pleinement opérantes, encore faut-il que l’environnement suive: que les cadres managériaux évoluent, que le Code du travail soit appliqué et renforcé, que les soutiens institutionnels soient accessibles, visibles, effectifs.
En somme, apprendre à poser des limites est une ressource. Mais faire respecter ces limites demeure une exigence collective. La véritable écologie de la santé psychique ne se joue pas seulement à l’intérieur des crânes: elle suppose un espace commun où les règles du jeu sont lisibles, les violences nommées, et les solidarités restaurées.