Guerre, pandémie, crise écologique, tensions sur les ressources énergétiques… Face à notre monde désorienté, soutient le philosophe Michaël Foessel, nous ne devons pas renoncer au plaisir et à la jouissance.
Quartier rouge. Le plaisir et la gauche (1). Le titre du dernier essai de Michaël Foessel sonne comme une fausse note dans la partition tragique qui rythme notre quotidien ces derniers temps. D’aucuns jugeraient anachronique, sinon insupportablement indécent, de composer une ode célébrant le plaisir et la jouissance dans un monde incertain et menacé, plus que jamais, par les destructions écologique et, désormais, nucléaire. Qu’ils se détrompent: « Même dans l’enfer, tout n’est pas l’enfer« , tempère le philosophe français. Et de faire remarquer que « les contextes les plus traumatiques sont aussi ceux qui suscitent des capacités de résistance inouïes ». Rire, danser, chanter sont autant de répliques qui bravent la crise et prouvent que « la logique mortifère de la guerre n’a pas gagné sur toute la ligne ».
Les contextes les plus traumatiques sont aussi ceux qui suscitent des capacités de résistance inouïes.
On aurait tort de croire que cette lecture verse dans l’optimisme béat. Non, Michaël Foessel n’est ni crédule ni post-soixante-huitard obstiné. Bien qu’il revendique n’avoir pas renoncé à l’esprit du célèbre slogan « jouir sans entraves », il admet que le temps des sociétés d’abondance est révolu. Le plaisir doit s’adapter aux injonctions vitales du réchauffement climatique et de la crise géopolitique déclenchée par la guerre en Ukraine, reconnaît-il.
Bio express
- 1974: Naissance, à Thionville, dans le nord-est de la France, le 24 octobre.
- 1997: Agrégé de philosophie.
- 2002: Docteur en philosophie à l’université de Rouen.
- 2013: Succède à Alain Finkielkraut en tant que professeur de philosophie à l’Ecole polytechnique.
- 2017: Se fait connaître du grand public avec la publication de La Nuit. Vivre sans témoin, (éd. Autrement).
La publication de votre livre intervient entre deux crises majeures: une pandémie et une tension géopolitique d’une gravité inédite. Comment peut-on articuler le plaisir à ce contexte qui, a priori, ne s’y prête pas?
Ces deux crises nous ramènent à ce qu’il y a de tragique dans l’histoire, au fait que nous demeurons tous confrontés à la possibilité du pire – maladie, violence, mort. Mais ce pire concerne nos corps et nos émotions: que modifie un virus dans nos rapports charnels aux autres? Comment la peur de la guerre nous force-t-elle à remettre en cause notre confort et nos habitudes? Même lorsque le plaisir semble superflu en raison de la gravité du moment, il demeure un enjeu politique. Pourquoi désirer la paix ou la fin d’une épidémie sinon parce que les crises nous privent de la possibilité de vivre librement? Dans des situations extrêmes, la peur n’ est pas forcément la meilleure conseillère. Pour résister à ce qui nous afflige, le plaisir demeure un allié précieux: il indique que l’angoisse n’est pas un destin.
Il semble que le désir de vivre et de jouir est encore plus intense en période de crise ou de guerre. On pense aux bals clandestins sous l’Occupation ou, plus récemment, aux Ukrainiens trinquant et sympathisant dans les abris souterrains.
On a tort d’opposer le plaisir au tragique ou au sérieux. Les contextes les plus traumatiques sont aussi ceux qui suscitent des capacités de résistance inouïes. On s’étonne de voir des militaires ou des civils assaillis par les bombes s’ adonner à des fêtes ou rire du malheur dont ils sont victimes. Mais c’est là une manière de résister à la fatalité qui n’a rien d’un divertissement vain. Il s’agit toujours de se convaincre que, même dans l’enfer, tout n’est pas l’enfer. Une guerre abominable offre parfois l’occasion de solidarités inédites. Du jour au lendemain, des inconnus sont confrontés aux mêmes enjeux vitaux. Pour éviter les bombes, ils se retrouvent dans des caves où la peur domine jusqu’à ce que certains, souvent des enfants, décident de jouer, de rire, parfois de danser malgré la gravité de l’heure. Cela ne change pas grand-chose au destin de la guerre. Mais cela montre que la logique mortifère de la guerre n’a pas gagné sur toute la ligne. Le plaisir partagé dans des circonstances tragiques est déjà une victoire sur la mort, une manière de se convaincre que l’occupant n’a pas triomphé dans sa volonté d’imposer la terreur.

Plus qu’une distraction ou un divertissement, vous hissez le plaisir au rang d' »objet politique ». En quoi l’est-il?
On a trop tendance à ne voir dans nos plaisirs qu’une manière de nous divertir des contraintes du monde social, par exemple de notre travail. Or, même les plaisirs les plus simples sont d’abord vécus dans le temps libre de la vie ; en ce sens, ils sont liés à la liberté, donc à la politique. Les plaisirs partagés, ceux que je privilégie dans ce livre, sont des premières victoires contre la tristesse sociale. Ils démontrent que les citoyens possèdent plus d’un seul corps: les ouvriers ne sont pas condamnés qu’à travailler, les femmes à n’être que des mères, les pauvres à subir leur misère. Rien ne montre mieux le caractère politique du plaisir que les occupations d’usines de 1936: pour la première fois, les salariés ont ri, dansé, chanté sur leur lieu de travail. Par là, ils ont montré que la souffrance n’était pas un destin. On retrouve ce genre d’allégresse dans la plupart des mobilisations politiques.
Dans l’imaginaire collectif, le plaisir et la jouissance restent intimement liés aux conjonctures d’abondance. Or, la crise environnementale et les tensions géopolitiques récentes nous conduisent plutôt vers une conjoncture d’économies de la rareté…
Il est vrai que l’on ne peut plus reprendre le « jouir sans entraves » de 1968 sans reconnaître que certaines entraves, certaines limites, sont désormais dictées par la nature elle-même. On sait bien à quelles crises mènent des désirs infinis qui portent sur une planète finie. Faut-il pour autant renoncer à toute idée d’abondance? Il faut d’abord s’entendre sur le terme: tous n’ont pas profité de la même manière de l’abondance que l’on associe aux Trente Glorieuses. On ne peut pas se contenter de dire aux plus pauvres, qui n’ont jamais été invités à la fête, que la fête est finie. Ensuite, si l’écologie veut cesser d’être perçue comme punitive, il me semble que, plutôt que de renoncer à l’idée d’abondance, elle devrait la redéfinir. Il faut rompre avec l’idée que les plaisirs réclament une abondance quantitative, définie par le nombre d’objets que l’on possède. Il existe une abondance qualitative, liée par exemple au partage de ce qui est beau, qui n’est pas une prédation de la nature. Les plaisirs que l’on partage ne sont pas forcément pris aux autres ou à la planète, ils impliquent plutôt d’inventer des rapports nouveaux avec eux.
Auriez-vous quelques exemples concrets?
Je pense aux plaisirs qui reposent sur la contemplation des choses plutôt que sur leur appropriation. La nature est abondante en paysages qui la rapprochent d’une oeuvre d’art, pourquoi faudrait-il réserver les plaisirs esthétiques à ceux qui ont les moyens de se les offrir? On sait bien que le tourisme est dangereux pour la planète, mais pas le voyage. Autre exemple: substituer aux plaisirs consuméristes des plaisirs ludiques. Il n’est pas nécessaire de consommer les choses pour profiter d’elles, on peut tout aussi bien les recycler: les fêtes les plus réussies sont souvent improvisées avec des bouts de chandelle. Les enfants s’y entendent pour jouer avec un rien, pourquoi ne pas essayer d’en faire autant à l’âge adulte? La sobriété peut être heureuse, ce qui la distingue de l’austérité.

Le plaisir et la jouissance restent également associés à l’imaginaire du consumérisme individualiste. Comment peut-on les dissocier et penser des formes de plaisir plus « émancipatrices »?
Une des forces du capitalisme contemporain est d’avoir réduit plaisir et consommation jusqu’à donner l’illusion d’une démocratisation de la joie. Ainsi, pendant les soldes, même des marques prestigieuses apparaissent relativement abordables: le plaisir se situe moins dans l’usage que l’on fait des choses que dans le fait de les posséder. Les plaisirs liés à la consommation ne me semblent pas forcément coupables, mais il est clair qu’ils renforcent l’ordre social et ses hiérarchies économiques. Cela ne doit pas faire oublier que certains plaisirs sont non seulement liés à la gratuité, mais la réclament. Les plaisirs érotiques peuvent certes être, eux aussi, « marchandisés », mais ils sont plus intenses (et pas seulement plus moraux) lorsqu’ils reposent sur un partage égalitaire. De la même manière, un plaisir alimentaire n’est pas uniquement composé des aliments que je consomme, il augmente avec le partage de repas où la nourriture est offerte à d’autres. Les corps deviennent joyeux quand ils cessent de n’être que consommateurs. Il est possible, le temps d’une fête, d’une étreinte ou d’un repas, d’échapper à la logique concurrentielle du marché. On ne juge pas seulement d’un plaisir selon le critère de la performance, on se réjouit plutôt de ce qui nous est offert ou de ce que l’on peut offrir.
Le problème politique n’est pas de jouir ou pas dans un monde injuste, mais de se demander comment rendre ce monde plus juste.
Dans votre livre, vous fustigez la posture qui consiste à refuser de « jouir dans un monde injuste », dominé par l’explosion des inégalités, le réchauffement climatique ou le déclin démocratique. Que reprochez-vous à ce parti pris moral?
Justement le fait qu’il n’est que moral. D’un point de vue éthique, il vaut évidemment mieux entretenir un rapport critique avec ses propres plaisirs que de revendiquer le droit de jouir de tout, quel qu’en soit le prix pour les autres. Il est légitime de ressentir de la honte dans le fait de porter des habits fabriqués par des enfants à l’autre bout de la planète ou de se gorger de luxe au milieu de la misère. Mais d’un point de vue politique, la question est de savoir quoi faire de cette honte. L’individu peut, et parfois doit, s’abstenir de vivre des plaisirs qui renforcent les inégalités. Mais la politique se situe à l’échelon collectif: elle n’est pas orientée vers le bien (comme la morale), mais vers le juste. Il me semble donc que le problème politique n’est pas de jouir ou pas dans un monde injuste, mais de se demander comment rendre ce monde plus juste. Non pas tellement changer sa vie pour se rendre pur, mais transformer la société pour la rendre habitable.
« Le plaisir n’attend pas », insistez-vous. Qu’entendez-vous par là?
On dit du plaisir qu’on le prend là où on le trouve. D’où le fait que cette émotion apparaît parfois suspecte: on le « prend » aux autres, et dans une société inégalitaire. J’ai essayé de répondre à cette critique du plaisir en montrant que ce sentiment tire précisément sa valeur de son impatience. Contrairement au désir qui porte sur l’avenir – « j’imagine un monde meilleur » – , le plaisir se vit ici et maintenant, il est réel ou il n’est pas. C’est par là qu’il participe de la transformation du monde: si nous pouvons vivre des allégresses dans un monde injuste, c’est que l’injustice n’ est pas un destin. Ceux qui renvoient toujours à demain l’amélioration du sort des plus pauvres se méfient de l’impatience du plaisir, et ils ont raison!
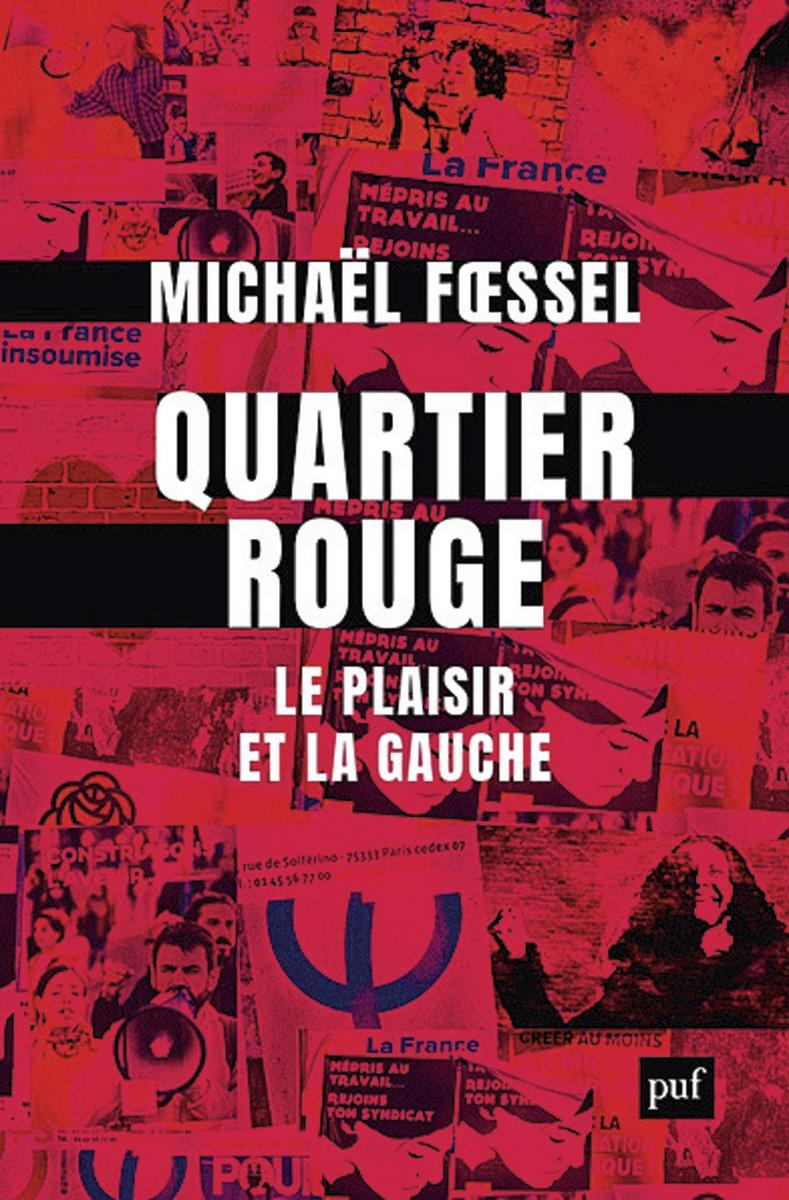
Vous soulignez la panne des imaginaires désirables. Comment peut-on bâtir aujourd’hui l’imaginaire d’un futur désirable?
En s’appuyant sur ce qui, dans la tristesse actuelle, échappe à la tristesse. Les utopies ne sont intéressantes que lorsqu’elles sont concrètes, c’est-à-dire lorsqu’elles reposent sur des expériences. Pour désirer un monde débarrassé du racisme, on peut miser sur l’imaginaire de l’égalité mais aussi sur les expériences où des individus d’origines ethniques différentes partagent des plaisirs communs. La peur favorise des imaginaires de la séparation alors que les plaisirs partagés démontrent que l’égalité peut être heureuse. On dit souvent des imaginaires de gauche qu’ils sont en panne. Pourtant, la majorité des gens continue à soutenir les mesures sociales de type égalitaire (baisse du temps de travail, départ à la retraite plus jeune, fiscalité plus équitable, etc.). C’est plutôt le réel qui, aujourd’hui, manque à la gauche: comment convaincre que son imaginaire peut transformer le monde? Or, le plaisir est le sentiment d’un réel heureux, une plénitude qui marque déjà une victoire sur l’organisation sociale de la tristesse.
Dans Après la fin du monde (Seuil, 2012), vous portiez un jugement sévère sur la « rhétorique catastrophiste ». A l’aune du contexte actuel où la menace nucléaire n’est plus une abstraction et la catastrophe climatique se précise, amenderiez-vous votre jugement d’alors?
J’ai moins remis en cause l’idée de catastrophe que le catastrophisme. Par là, j’entends la tendance de certains mouvements et de certains penseurs à n’envisager l’avenir, la nouveauté ou les événements que sous l’angle du pire. Il ne s’agit pas de nier les dangers inédits qui nous menacent, mais de se préparer à les affronter d’une manière démocratique. La logique catastrophique est celle de l’absence d’alternatives: ou bien on bifurque (sur le climat) ou c’est la fin du monde. Or, il y a plusieurs manières de bifurquer, et certaines sont autoritaires. Je ne doute pas que le gouvernement chinois parviendra à réduire la production de carbone de son peuple, mais à quel prix? Le catastrophisme, le sentiment de l’urgence permanente sont favorables aux états d’exception, on a encore pu le vérifier en France au cours de la crise sanitaire. Pour autant, tous les moyens ne sont pas bons pour « sauver le monde », en particulier ceux qui impliquent de renoncer aux libertés.
D’une manière générale, comment peut-on penser et vivre le plaisir dans un monde incertain et de plus en plus angoissant?
Peut-être en distinguant l’incertain et l’angoissant. Le plaisir est toujours lié à une rencontre: avec un corps, une musique, un aliment, un paysage… A ce titre, il est d’autant plus intense qu’il est imprévu et que l’on peut s’y abandonner sans crainte. Rien n’est plus hostile au plaisir que l’impératif du contrôle permanent qui nous pousse à envisager les autres et le monde sous l’angle de la menace. Mais c’est l’angoisse qui nous amène à désirer le contrôle, un refus a priori de l’altérité. Pour y répondre, il faut bien sûr essayer de réorienter l’avenir de manière à ce qu’il soit moins menaçant, mais on peut également tenter de vivre le présent hors de la terreur. Après tout, les périodes millénaristes où dominait la peur de la fin du monde se sont accompagnées de fêtes et d’une explosion anarchique de l’érotisme. Je ne pense pas que nous nous trouvons à la veille de l’apocalypse. Mais si c’est le cas, il y a peut-être mieux à faire que de se terrer dans nos solitudes en se nourrissant de quinoa.
