Grande voix de la cause animale, le philosophe australien Peter Singer fascine autant qu’il irrite. A 77 ans, il n’a pas dit son dernier mot et est plus incisif que jamais.
Icône, pionnier, éclaireur, s’enthousiasment ses plus fervents partisans. Idéologue, utopiste, gourou, leur rétorquent ses détracteurs. Peter Singer fascine et irrite à force égale. Reconnu comme la grande voix de la cause animale, adulé par les mouvements antispécistes à travers le monde, ce philosophe australien a introduit et initié des générations successives à l’antispécisme. Moqué dans les années 1970 pour ses thèses jugées fantaisistes sur les droits des animaux, Peter Singer est aujourd’hui un intellectuel à l’aura internationale, professeur à la mythique université de Princeton où il est titulaire de la prestigieuse chaire éthique.
Son livre La Libération animale, paru pour la première fois en 1975, est l’un des ouvrages les plus influents du XXe siècle, élevé par les mouvement de jeunes au rang d’Evangile. A 77 ans, Peter Singer n’a pas dit son dernier mot. Plus incisif que jamais, il revient avec une nouvelle édition, définitive, de La Libération animale (1), augmentée d’une généreuse préface de Yuval Noah Harari, historien et professeur d’histoire à l’université hébraïque de Jérusalem et auteur du best-seller Sapiens: une brève histoire de l’humanité. Peter Singer y insiste sur l’impact, éthique et environnemental, de nos choix alimentaires et de l’industrie animale sur l’équilibre climatique. Cet entretien fut aussi l’occasion de répondre à toutes les objections qui lui sont opposées.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la cause animale dès les années 1970?
A l’époque, le sujet était déprécié. On en parlait peu dans le débat public et, contrairement à aujourd’hui, il était quasi inimaginable qu’un parti politique fasse de la cause animale son combat majeur. Or, il se trouve que, par hasard, à l’université d’Oxford, un camarade végétarien m’a proposé de lire Animal machines, de l’Anglaise Ruth Harrison, paru en 1964. Ce fut un véritable choc. J’y ai découvert que la condition animale est tout à fait différente de ce que j’imaginais. En général, quand on pense aux animaux, on pense aux champs, aux espaces verts à ciel ouvert. Sauf que la réalité est tout autre. La plupart des animaux d’élevage sont enfermés dans des établissements surpeuplés, dans des conditions atroces.
Yuval Noah Harari, dans la préface de cette nouvelle édition, souligne le contexte indifférent, voire hostile, à la cause animale dans lequel vous avez publié votre ouvrage à l’origine.
Honnêtement, même si l’accueil fut hostile, je m’attendais à plus d’adversité. Les réactions furent plutôt mitigées. Je me souviens que le New York Times avait consacré une chronique positive à l’ouvrage. Même chose pour The Village Voice, journal très influent à l’époque. En revanche, plusieurs critiques ont jugé mon propos déplacé, avec un certain mépris. Le mot «ridicule» revenait souvent (il rit). Ce qui est frappant, c’est que les critiques les plus virulentes ne provenaient pas, pour la majorité, de la presse conservatrice. Nombre de titres de gauche, progressistes, avaient attaqué mon argumentaire. On retrouvait souvent la fameuse critique, toujours d’actualité, selon laquelle le combat pour la cause animale est une question bourgeoise et sociétale qui détourne l’attention du véritable combat de la lutte des classes.
A peu près un demi-siècle plus tard, vous décidez de rééditer Animal Liberation. Pourquoi? Qu’est-ce qui a changé depuis la parution de la première édition?
J’ai ajouté très peu d’éléments à ma réflexion. Or, le monde a profondément changé depuis. Plusieurs personnes ont pris conscience de l’enjeu de la cause animale, de son importance pour l’équilibre environnemental et de son lien avec la cause climatique. Tout est lié, en réalité. Aussi, les mouvements pour la cause animale n’existaient pas encore à l’époque. Avec cette nouvelle édition, je veux aussi m’adresser à la nouvelle génération, fer de lance des mouvements écologistes et animalistes, qui fait un travail remarquable de conscientisation. Je souhaite que le livre reste d’actualité dans les années à venir. J’ai aussi élargi mon champ d’observation en dépassant le monde occidental; ainsi, je me suis penché sur le cas de la Chine, aujourd’hui l’un des plus grands acteurs de l’élevage animal. Enfin, il fallait répondre à quelques objections qui me sont souvent faites.
Justement, on vous reproche régulièrement de comparer souffrances animale et humaine, de les mettre sur un pied d’égalité, voire, dans certain cas, d’estimer la souffrance animale plus importante.
Le philosophe anglais du XVIIIe siècle Jeremy Bentham avait cette belle formule: «Chacun compte pour un, et aucun ne compte pour plus qu’un.» Or, pour les spécistes, ce «chacun» est exclusif aux êtres humains. Dans une éthique antispéciste, le «chacun» doit être élargi à toutes les composantes vivantes et sensibles de la nature. L’élément fondamental reste la prise en considération des intérêts de l’être, indépendamment de sa race, de son sexe ou de son espèce. Mais depuis l’histoire de la Création décrite dans la Bible, l’homme s’est érigé en maître de la nature et a dominé toutes ses composantes vivantes, avec les conséquences environnementales qu’on connaît aujourd’hui. Le spécisme est un préjugé en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce contre ceux des membres d’autres espèces. Donc pour revenir à votre question, oui, je pense qu’on doit considérer sur un pied d’égalité les animaux et les êtres humains, n’en déplaise aux spécistes (rire).
Le problème de la conception spéciste est qu’elle refuse d’englober les animaux dans le mot “autres”.»
Dans le livre, vous allez plus loin. Vous écrivez que dans certains cas, la souffrance animale peut prévaloir sur la souffrance humaine…
Dans certains cas, oui. Je prends l’exemple du bébé Theresa, né avec une anencéphalie, en 1992 en Floride. Cette pathologie se caractérise par l’absence d’une grande partie du cerveau. Les enfants anencéphales ne deviennent jamais conscients. Pour venir en aide à d’autres enfants, la mère de Theresa, Laura Campo, a proposé de faire don des organes de sa fille. Les médecins ont refusé. Elle a porté l’affaire devant la justice et là encore, la juge a rejeté sa demande. La petite Theresa est morte quelques jours plus tard, sans avoir pu sauver d’autres enfants. Pourtant, les mêmes personnes qui affirment qu’il aurait été mal de la tuer n’auraient eu aucune objection à prélever le cœur d’un porc, d’un babouin ou de n’importe quel autre animal en bonne santé et pleinement conscient, si cela avait permis de sauver une vie humaine. Cette position repose uniquement sur des présupposés religieux estimant qu’une âme est immortelle ou créée à l’image de Dieu, alors que ce n’est pas le cas pour les animaux, ils n’ont pas d’âme et n’ont pas été créés à l’image de Dieu. Dans une société laïque, ce genre d’argument n’a pas sa place. Il ne repose sur aucun fondement raisonnable ou rationnel. Nous sommes ainsi, une fois de plus, devant une croyance spéciste.
Vous soulignez que l’intérêt de l’être doit être l’unique boussole. Dans le livre, vous insistez aussi sur la souffrance…
En réalité, les deux sont intimement liés, car la capacité de souffrir et de jouir constitue une condition préalable à l’existence de tels intérêts, une condition qui doit être remplie avant qu’on puisse même parler d’intérêts. La capacité de souffrir et de jouir est non seulement nécessaire mais aussi suffisante pour que nous puissions avancer qu’un être jouit d’intérêts. Si un être souffre, il ne peut y avoir de justification morale au refus de prendre cette souffrance en considération. Seule une conception spéciste peut défendre cela. Et quelle que soit la nature de l’être, le principe d’égalité exige que sa souffrance soit prise en compte. Bien entendu, si un être n’est pas capable de souffrir ou d’éprouver du plaisir ou du bonheur, il n’y a rien à prendre en compte. La limite de la sensibilité constitue donc la seule limite défendable pour la prise en compte des intérêts d’autrui. Et scientifiquement, il a été établi que les animaux jouissent de ces qualités. Mais certains considèrent les animaux humains supérieurs. De telles affirmations, qui font la distinction entre un «eux» et un «nous», ont déjà servi à justifier le refus d’accorder une égale considération aux intérêts des autres.
Faites-vous allusion au parallèle que vous établissez entre spécisme, racisme et sexisme?
En effet. Les racistes refusent de reconnaître l’égalité de tous les êtres humains en accordant plus de valeur aux intérêts des membres de leur «race»; les sexistes font de même par rapport au genre. Aujourd’hui, avec le recul, l’avancée de la science, les drames du XXe siècle et les grands mouvements d’émancipation, nous sommes capables de reconnaître que ces prétendues justifications de racisme et de sexisme sont des idéologies infondées qui n’ont été acceptées que parce qu’elles servaient les intérêts du groupe dominant. Je pense qu’il faut raisonner de la même manière avec la question de l’espèce car, aujourd’hui, les spécistes permettent aux intérêts de leur espèce de prévaloir sur les intérêts des membres d’autres espèces. Dans chaque cas, un groupe dominant juge inférieurs ceux qui ne font pas partie de ce groupe, à seule fin de justifier l’utilisation qu’il en fait.
On pourrait vous objecter que les animaux se mangent et se tuent entre eux et dans ce cas, pourquoi l’être humain se priverait-il de les exploiter si, bien entendu, il observe une éthique rigoureuse?
Il y a une grande différence entre les deux. D’abord, je note qu’il est curieux de voir les humains, qui se considèrent tellement au-dessus des autres animaux, ne pas hésiter à soutenir leurs préférences alimentaires à l’aide d’un argument impliquant que nous prenions les autres animaux comme inspiration morale. Maintenant sur le fond, si les êtres humains peuvent vivre sans tuer, certains animaux n’ont d’autre choix que de tuer s’ils veulent se nourrir et survivre. Certes, on peut trouver des animaux qui n’ont pas besoin de viande pour vivre mais qui en consomment occasionnellement, comme les chimpanzés par exemple. Mais cela ne justifie en rien l’idée qu’il serait moralement défendable pour nous, être humains, de faire pareil. Enfin, j’ajoute cette différence fondamentale que les animaux ne sont pas en mesure d’envisager d’autres options, ou de réfléchir moralement aux avantages et aux inconvénients qu’il y a à tuer pour se nourrir: ils se contentent de le faire. Nous pouvons regretter que le monde soit ainsi fait, mais il n’y a aucun sens à tenir les animaux non humains pour responsables ou coupables de ce qu’ils font.

Si on pousse plus loin votre raisonnement sur l’égalité des vivants, on peut l’étendre aux plantes, vu qu’elles réagissent aux stimuli et que certains chercheurs émettent l’hypothèse de leur sensibilité.
Les plantes n’ont pas de système nerveux conduisant à un cerveau central, mais elles échangent bien différents types de signaux électriques et chimiques. La réaction de la dionée attrape-mouche à un insecte qui atterrit dans son piège est bien connue et étudiée, mais il y a beaucoup d’autres façons dont les plantes réagissent aux stimuli. Cependant, les plantes n’ont aucune conscience. Pour cette nouvelle édition, je me suis penché sur la littérature scientifique sur le sujet. Aucune étude n’établit que les plantes seraient dotées d’une sensibilité ou d’une conscience. Par conséquent, elles ne répondent pas au critère de sensibilité.
Lire aussi | Comment l’amour nous distingue des autres singes
Des observateurs ont remarqué que les pionniers de la cause animale –Henry Spira, Isaac Bashevis Singer, vous et beaucoup d’autres– sont d’ascendance juive, souvent de déportés de la Seconde Guerre mondiale. Cette lecture vous semble-t-elle pertinente?
C’est intéressant comme remarque. Mais franchement, je ne sais pas. La question mérite réflexion. Il faut noter aussi que les défenseurs du bien-être animal sont plus divers que ça. C’est vrai qu’Isaac Bashevis a insisté sur cette analyse, ce qui a provoqué des débats animés. Personnellement, en effet, une partie de la famille fut déportée et a subi les atrocités du nazisme. Lequel est un régime par essence dominateur. Peut-être cela a-t-il provoqué chez nous une forme de sensibilité contre les questions de domination, qu’on retrouve dans le spécisme. Mais il m’est difficile de répondre directement à cette question. Je vais y réfléchir.
D’aucuns refusent cette égalité antispéciste au nom de la liberté. La liberté de manger de la viande, celle de pratiquer la chasse, ou autre. Cet argument est-il audible pour vous?
Non, je ne le pense pas. On ne peut pas invoquer la liberté dans ce contexte pour toutes les raisons que j’ai expliquées par rapport à l’intérêt et à la souffrance des êtres vivants, abstraction faite de leur espèce. Et comme le veut le célèbre adage, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Or, le problème de la conception spéciste est qu’elle refuse d’englober les animaux dans le mot «autres».
Dans le livre, vous insistez sur l’importance de l’«altruisme efficace». De quoi s’agit-il?
La formule et l’idée remontent à la première décennie de notre siècle. On la doit à Toby Ord et Will MacAskill, deux étudiants en philosophie de l’université d’Oxford, qui ont écrit sur les meilleures façons de faire le bien. Leur travail a lancé un mouvement désormais connu sous ce nom d’«altruisme efficace». Ses adeptes ont pour but de faire du monde un endroit plus vivable, et pour cela, ils ont recours à la raison et aux preuves pour découvrir comment le faire de la façon la plus efficace possible. Pour la plupart des altruistes efficaces, réduire la souffrance animale est une façon importante de faire le bien. L’altruisme efficace peut aussi être un choix de carrière. Par exemple, si des jeunes d’aujourd’hui veulent en changer, ils peuvent penser aux carrières qui sont le plus susceptibles d’avoir un effet sur la réduction de la souffrance animale.
Quel regard portez-vous sur les mouvements antispécistes actuels, que ce soit le travail associatif ou les actions militantes «coup de poing»?
Le travail associatif contribue énormément à la prise de conscience citoyenne. Je pense notamment aux vidéos diffusées par l’association L214 et qui montrent les conditions de vie des animaux dans les élevages et durant leurs transport et abattage. Elles ont provoqué beaucoup de débat. Plusieurs personnes ont changé leur comportement depuis. Tout simplement parce qu’elles ignoraient tout de ces conditions d’élevage des animaux. Maintenant, si l’on aborde les actions militantes, tout dépend de quoi on parle. Je soutiens bien entendu ces actions, y compris celle de désobéissance civile, pour peu qu’elles restent pacifiques et non violentes. La seule limite, c’est la violence. Tout simplement parce que la violence appelle la violence. Et l’on entre ainsi dans une spirale infernale.
«Toucher au portefeuille est un outil à ne pas négliger pour améliorer la condition animale.»
Selon vous, l’amélioration de la condition animale doit-elle davantage reposer sur les initiatives individuelles que sur l’échelle structurelle et politique?
Les deux sont importants. La cause animale doit marcher sur ces deux pieds. Du point de vue individuel, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas être fataliste. Par exemple, les actions de boycott peuvent considérablement influencer l’industrie de l’élevage. Toucher au portefeuille est un outil très efficace qu’il ne faut pas négliger. Et cela passe par l’action individuelle. Mais c’est vrai que les changements opérés par les politiques sont aussi déterminants. Pour prendre un exemple que vous connaissez bien en Belgique, je pense à l’associations Gaia, qui a pu obtenir des avancées majeures pour le bien-être animal.
Votre livre n’a été traduit en français qu’en 1993. Que révèle cette parution tardive du monde francophone à la cause animale?
Il est vrai que le livre a été traduit en allemand, en néerlandais, en espagnol et d’autres langues avant d’être traduit en français. Je pense que ce n’est pas un hasard, surtout à l’époque, dans les années 1970. Je pense que cela révèle quelque chose de profond du rapport qu’entretiennent les Français avec la gastronomie et leur culture culinaire. Il y a en effet indéniablement une sorte de fierté de la cuisine française. Ils considéraient un plat sans viande comme une insulte (rire). Et je ne parle même pas d’être vegan. Rien que l’idée d’être végétarien leur paraît insupportable. Mais je pense que cela a changé aujourd’hui. J’en veux pour preuve que cette nouvelle édition a été traduite en premier lieu en français.
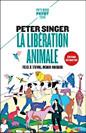
Bio express
1946
Naissance, à Melbourne (Australie).
1960
Obtient un master en philosophie morale à l’université de Melbourne.
1973
Publie Democracy and Disobedience (Clarendon Press).
1975
Première édition d’Animal Liberation (Random House),
1993
Traduction en français d’Animal Liberation (La Libération animale, Grasset).
2004
Désigné «Humaniste de l’année» par le Conseil des sociétés humanistes australiennes.
