Dans son nouvel essai qui fait l’éloge de l’erreur et de l’ignorance, Gianrico Carofiglio plaide une évidence oubliée: toute connaissance naît du doute, toute action mûrit par essais et corrections.
Icône populaire du polar italien et figure notoire du débat public, ancien magistrat engagé contre le crime organisé puis parlementaire à Rome, Gianrico Carofiglio n’a rien d’un théoricien hors‑sol. Son nouvel essai, Eloge de l’erreur et de l’ignorance (1), renverse le culte contemporain de la perfection pour plaider une évidence oubliée: toute connaissance naît du doute, toute action mûrit par essais et corrections. A l’heure où l’on confond performance et infaillibilité (des réseaux sociaux à la vie politique, de l’école à l’entreprise), Carofiglio démonte l’illusion dangereuse de l’«impeccable»: elle fabrique arrogance, aveuglement et, parfois, dérive autoritaire. Son livre tombe juste, dans une société travaillée par la post-vérité et la peur de l’échec, où l’on apprend trop souvent à «avoir raison» plutôt qu’à apprendre de ses erreurs. Dans cet entretien, l’auteur insiste sur un point: l’erreur n’est pas un accident honteux, mais une ressource, un entraînement de lucidité qui va de la chute maîtrisée des arts martiaux à l’éthique critique du philosophe des sciences Karl Popper. En filigrane, se dessine une thèse simple et exigeante: reconnaître ses limites n’affaiblit pas, cela rend plus juste, plus créatif, plus démocrate. Et, peut‑être, plus aimable envers les autres comme envers soi‑même.
Pourquoi consacrer un livre entier à l’erreur et à l’ignorance?
J’ai voulu écrire ce livre en réaction à l’obsession contemporaine pour le contrôle, la performance et l’infaillibilité. Nous vivons dans une culture qui nie la valeur de l’incertitude, alors même que toute connaissance naît du doute et de l’erreur. Mon expérience de magistrat et de parlementaire m’a montré combien cette illusion d’infaillibilité est dangereuse: elle produit arrogance, aveuglement, dérive autoritaire. En réalité, nous passons la plus grande partie de notre vie à nous tromper. Ce n’est pas un accident, mais la manière même dont nous sommes au monde et dont nous apprenons à le connaître.
Cela renvoie à ce que vous appelez «l’illusion d’infaillibilité»…
Je pense que la distinction véritable entre les personnes n’est pas entre celles qui commettent des erreurs et celles qui n’en commettent pas, car tout le monde se trompe, mais entre celles, la majorité, qui par orgueil ou par peur de l’ego refusent de reconnaître leurs erreurs, et celles qui savent les assumer, en tirer des leçons, progresser. En renversant le regard, j’ai voulu montrer que l’erreur et l’ignorance consciente ne sont pas des faiblesses mais des ressources. Reconnaître nos limites, c’est ouvrir la voie à la curiosité, à l’apprentissage, à la démocratie. Ce livre est une invitation à relire l’échec comme un instrument d’émancipation.
Les arts martiaux enseignent d’abord à tomber, écrivez‑vous. Comment cette métaphore éclaire‑t‑elle notre rapport à l’échec, individuel et collectif?
Dans les arts martiaux, on apprend avant tout à tomber. Ce geste, apparemment simple, est en réalité une métaphore puissante: il signifie que l’échec fait partie de l’expérience, qu’il ne doit pas être nié mais intégré. Tomber correctement, c’est limiter les dégâts, se relever plus vite et transformer la chute en apprentissage. Dans nos vies individuelles, comme dans les sociétés, l’échec est inévitable. La véritable question est donc: savons‑nous en tirer des leçons?
Justement, comment y répondez‑vous?
Une communauté qui accepte de «tomber» ensemble, qui reconnaît ses erreurs sans honte, devient plus résiliente, davantage capable d’affronter l’incertitude et de se transformer. Refuser la chute, c’est s’exposer à la fracture. Et il y a une beauté particulière dans cette discipline de la chute: on y découvre que l’élégance du mouvement n’est pas dans la victoire, mais dans la manière de se relever, de transformer l’erreur en force. C’est un peu la sagesse contenue dans le mythe d’Antée: chaque fois qu’il était jeté à terre, au lieu de s’affaiblir, il reprenait des forces au contact de la terre qui l’avait engendré. De la même façon, tomber peut devenir une manière de retrouver son énergie vitale.
Vous convoquez Socrate et Confucius: «Savoir qu’on ne sait pas.» Est‑ce une posture encore possible à l’ère des certitudes affichées, notamment sur les réseaux sociaux?
Socrate et Confucius nous rappellent que la vraie sagesse commence quand on reconnaît son ignorance. Aujourd’hui, cette posture paraît presque subversive: les réseaux sociaux récompensent la certitude, l’affirmation péremptoire, la mise en scène d’une autorité sans faille. Pourtant, c’est précisément dans ce contexte que l’attitude socratique redevient vitale. Dire «je ne sais pas» n’est pas une faiblesse, mais une forme de courage intellectuel. Cela signifie que l’on est prêt à écouter, à apprendre, à réviser ses positions. A l’ère des vérités instantanées et des opinions irréversibles, réhabiliter ce doute méthodique est une condition pour préserver l’esprit critique et, en fin de compte, la liberté de pensée. C’est aussi un geste d’humanité: reconnaître publiquement que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin des autres et de leur savoir, c’est faire acte de modestie et ouvrir la voie à un dialogue véritable. Il faut ajouter que la culture de la performance et de la peur de l’erreur produit de véritables catastrophes éducatives. Beaucoup de jeunes, souvent parmi les plus doués, deviennent dépendants à la gratification du «tu as été brillant», de la bonne réponse donnée au bon moment. Progressivement, cette dépendance les paralyse: la peur de se tromper les rend incapables d’explorer, de risquer, de créer. Ainsi, au lieu de déployer leurs talents, ils les gaspillent, prisonniers d’une idée fausse de la perfection.

Vous citez Karl Popper: «Notre savoir progresse grâce à nos erreurs.» Pourquoi cette éthique critique est‑elle si difficile à faire vivre en politique?
Popper a montré que la science progresse par essais, erreurs et rectifications. La politique devrait suivre la même logique, mais elle s’y refuse souvent. Pourquoi? Parce que reconnaître une erreur est perçu comme une faiblesse électorale. Les dirigeants préfèrent donner l’image de la certitude, même au prix de l’aveuglement. Or, une démocratie mature devrait valoriser la capacité d’un responsable à corriger ses positions. L’éthique critique que Popper propose suppose humilité et réversibilité, alors que la politique contemporaine se nourrit d’arrogance et de slogans définitifs. Ce divorce entre science et politique fragilise nos institutions et nous prive d’un apprentissage collectif essentiel. Mais il y a plus: lorsque la politique érige l’infaillibilité en règle, elle transmet à toute la société un modèle éducatif pervers. Elle enseigne, implicitement, que se tromper est honteux, que changer d’avis est une faute. Ce message pénètre les écoles, les familles, la culture commune. Nous payons alors un prix très élevé: au lieu d’apprendre à reconnaître et corriger nos erreurs, nous apprenons à les cacher, à les nier et à répéter les mêmes fautes sans jamais progresser.
Vous écrivez que «les erreurs nous rendent aimables» et même plus intéressants.
Je m’inspire de Goethe: l’erreur nous rend humains, elle révèle nos fragilités et crée une proximité avec les autres. On aime davantage une personne qui assume ses limites qu’une figure glacée d’infaillibilité. Mais il y a plus: les erreurs nous rendent aimables avec nous‑mêmes. Elles nous réconcilient avec notre imperfection, nous rappellent que nous n’avons pas besoin d’être parfaits pour avoir de la valeur, pour être dignes d’estime et d’affection. Cette réconciliation intérieure est essentielle: sans elle, nous vivons dans la peur constante de l’échec. La psychologie du perfectionnisme nous montre ses effets destructeurs: derrière l’obsession de la performance se cachent souvent anxiété, inhibition, incapacité à explorer et à créer. Pourtant, notre société valorise l’image lisse, la façade de l’infaillibilité. Dans la politique, dans l’entreprise, montrer ses erreurs est perçu comme un risque mortel. Cette culture de la perfection apparente produit une distance avec la réalité et avec les citoyens. En cachant nos erreurs, nous perdons la possibilité de les transformer en ressources. En les assumant, au contraire, nous gagnons en authenticité, en crédibilité et même en autorité morale.
Vous reprenez à Keats l’idée de «capacité négative», ce talent à rester dans l’incertitude et le doute. Cela peut sembler paralysant. Peut‑on fonder une action politique sur l’incertitude assumée?
La «capacité négative» décrite par Keats n’est pas une paralysie, mais une ouverture: accepter l’incertitude pour rester disponible aux possibles. En politique, cela peut sembler paradoxal. Pourtant, les grandes réformes naissent rarement de certitudes rigides. Elles émergent de la capacité à écouter, à tester, à rectifier. Une action politique fondée sur l’incertitude assumée n’est pas indécision, mais pragmatisme: elle refuse les dogmes, préfère l’expérimentation, s’adapte aux faits nouveaux. Dans un monde complexe et changeant, cette attitude est la seule capable de prévenir le fanatisme et de maintenir vivante la démocratie. Les sociétés qui acceptent l’incertitude sont aussi celles qui favorisent la créativité et l’innovation: elles comprennent que le doute n’est pas l’ennemi de l’action, mais son allié le plus sûr.
Vous proposez d’intégrer une «dimension probabiliste» à nos croyances. Comment éviter que ce relativisme ne soit perçu comme une faiblesse ou une indécision?
Introduire une dimension probabiliste signifie admettre que nos convictions ne sont jamais absolues, mais toujours susceptibles de révision. Cela ne veut pas dire que tout se vaut: ce n’est pas du relativisme mou, mais une rigueur intellectuelle comparable à celle des sciences. Un scientifique n’affirme pas une vérité éternelle, il avance une hypothèse robuste «jusqu’à preuve du contraire». De la même manière, le citoyen ou le responsable politique peut défendre une position forte tout en reconnaissant sa part de fragilité. Loin de la faiblesse, cette conscience des limites constitue une force: elle protège du dogmatisme et ouvre la voie à l’apprentissage collectif.
Dans un chapitre saisissant, vous passez en revue les prédictions ratées d’experts célèbres, d’Einstein à Chaplin. Pourquoi les «meilleurs» se trompent‑ils si souvent?
Même les plus grands se trompent, car la complexité du réel dépasse toujours nos modèles. Einstein refusait l’idée d’un univers en expansion, Chaplin affirmait que le cinéma n’avait aucun avenir. Ces erreurs ne diminuent pas leur génie, elles rappellent simplement que personne n’est à l’abri de ses propres limites. Souvent, plus on sait, plus on risque de croire que notre savoir suffit. Mais la réalité échappe toujours à nos schémas. Les erreurs des meilleurs sont ainsi des leçons d’humilité: elles montrent que la connaissance avance non pas malgré les erreurs, mais grâce à elles.
«De nombreux jeunes dépendants à la gratification ont peur de se tromper ce qui les rend incapables d’explorer, de risquer, de créer.»
Vous distinguez la «pensée convergente», autoritaire et fermée, de la «pensée divergente» qui admet la pluralité des réponses. C’est-à-dire?
La pensée convergente cherche une seule réponse, claire et définitive. Elle rassure parce qu’elle élimine le doute, mais elle conduit souvent à l’autoritarisme et à la stérilité intellectuelle. La pensée divergente, au contraire, accepte l’idée qu’il puisse exister plusieurs solutions à un même problème. Elle valorise la créativité, l’ouverture, la démocratie. Dans la vie publique comme dans l’éducation, favoriser la pensée divergente signifie préparer des citoyens capables d’affronter la complexité sans se réfugier dans des certitudes simplistes. Entre l’obsession de l’unique réponse et le chaos relativiste, c’est cette pluralité raisonnée qui constitue la véritable force des sociétés libres.
Vous défendez l’idée d’«ignorance consciente», à rebours de l’ignorance présomptueuse ou populiste. De quoi s’agit‑il?
L’«ignorance consciente», c’est une attitude de lucidité: reconnaître nos limites, nos zones d’ombre, et les assumer. Elle s’oppose à deux dérives. L’ignorance présomptueuse, qui croit détenir la vérité et refuse toute remise en question. Et l’ignorance populiste, qui transforme le rejet du savoir en fierté et en instrument de manipulation. L’ignorance consciente n’est ni résignation ni dévalorisation de soi: c’est la condition pour apprendre, écouter, dialoguer. Elle nous rend plus prudents dans nos jugements, mais aussi plus ouverts à la complexité et à l’altérité.
Qu’est‑ce que cela signifie dans la pratique?
Dans la pratique, l’ignorance consciente signifie adopter une posture d’humilité active. Concrètement, cela veut dire: douter de ses certitudes, vérifier ses sources, être prêt à corriger son opinion. Cela signifie aussi écouter vraiment l’autre, même lorsqu’il contredit nos convictions. Dans la vie quotidienne, c’est admettre que l’on peut s’être trompé avec ses proches. En politique, c’est réviser un programme quand les faits changent. A l’école, c’est apprendre aux élèves que l’erreur fait partie du processus d’apprentissage. Loin de paralyser l’action, cette conscience libère l’esprit: elle nous autorise à chercher, à expérimenter, à progresser ensemble.
Vous racontez comment Mike Tyson résumait la fragilité des plans à travers sa célèbre formule: «Tout le monde a un plan, jusqu’à ce qu’il prenne un coup de poing.» Qu’avez‑vous appris, comme magistrat puis comme parlementaire, de cette leçon d’improvisation?
Cette phrase de Mike Tyson exprime une vérité universelle: les plans les mieux conçus se brisent au contact du réel. Comme magistrat, j’ai appris que les dossiers ne se déroulaient jamais comme prévu, qu’il fallait écouter, s’adapter, parfois improviser. En politique, l’expérience fut similaire: un projet de loi, une stratégie parlementaire peuvent être bouleversés par un événement imprévu. Dans ces situations, la rigidité est fatale. Ce qui compte, c’est la capacité d’improviser sans perdre le cap, de transformer le coup reçu en opportunité de révision. L’art de gouverner, comme la justice, exige donc lucidité, souplesse et courage. Mais cette leçon vaut aussi pour la vie ordinaire: chacun de nous fait des plans, puis le réel intervient, inattendu et parfois brutal. Savoir improviser devient alors une compétence existentielle.

Vous développez le concept d’«outre‑intention», ces effets imprévus plus vastes que l’objectif initial. Est‑ce le secret des grandes découvertes scientifiques, mais aussi des grandes réformes politiques?
L’«outre‑intention» désigne ces effets qui dépassent le but recherché. Dans la science, de nombreuses découvertes sont nées d’un hasard fécond: le Viagra, par exemple, est l’un des cas les plus célèbres. En politique, il arrive qu’une réforme produise des changements bien plus larges que prévu. Ce concept nous rappelle que nous ne maîtrisons jamais totalement les conséquences de nos actes. Mais c’est précisément cette part d’imprévu qui ouvre la voie aux vraies innovations, à condition de savoir les accueillir au lieu de les craindre.
«Reconnaître nos limites, c’est ouvrir la voie à la curiosité, à l’apprentissage, à la démocratie.»
Vous consacrez un chapitre à la «chance», entre Machiavel et Michael Sandel. Quel rôle lui donnez‑vous dans la réussite individuelle et collective?
La chance pèse beaucoup plus qu’on ne le croit. Machiavel parlait de la «fortuna», force indomptable qu’il fallait canaliser; Sandel, lui, critique l’illusion de tout devoir au seul mérite. Reconnaître le rôle du hasard, ce n’est pas nier l’effort, mais refuser l’orgueil de ceux qui s’attribuent tout. Une rencontre, une circonstance, un contexte historique peuvent changer un destin personnel ou collectif. La vraie justice exige d’intégrer ce facteur: non pour céder au fatalisme, mais pour cultiver plus d’humilité, de solidarité et de sens de la responsabilité.
Vous notez que les sociétés qui refusent l’incertitude stagnent, tandis que celles qui acceptent le doute progressent. Quel diagnostic portez‑vous sur l’Europe contemporaine?
L’Europe vit une tension permanente entre prudence et paralysie. D’un côté, ses institutions ont permis une stabilité historique sans précédent; de l’autre, cette même prudence se transforme parfois en immobilisme. Face aux crises, économiques, migratoires, climatiques, l’Europe hésite, discute longuement, cherche un consensus qui arrive souvent trop tard. Pourtant, son avenir dépendra de sa capacité à accepter l’incertitude comme moteur: expérimenter des solutions, corriger rapidement les erreurs, avancer malgré le risque. Refuser le doute, c’est se condamner à la stagnation. L’assumer, au contraire, pourrait rendre à l’Europe la vitalité démocratique qu’elle semble avoir perdue. Pour cela, il faut réhabiliter la confiance dans la discussion, dans l’erreur corrigée, dans l’audace réformiste. Sans cette culture du risque réfléchi, l’Europe se condamne à n’être qu’un musée de ses propres gloires passées.
Enfin, que diriez‑vous à un citoyen désabusé: pourquoi réapprendre à valoriser l’erreur et l’ignorance consciente est‑il vital pour nos démocraties?
Je dirais d’abord que la démocratie n’est pas un système d’infaillibilité, mais un régime qui vit de sa capacité à corriger ses erreurs. C’est sa force et sa fragilité. Réapprendre à valoriser l’erreur, c’est refuser le cynisme qui nourrit les populismes: l’idée que «tous se trompent donc rien ne vaut». Au contraire, l’erreur assumée est la preuve que nous cherchons, que nous avançons. L’ignorance consciente, elle, nous protège des dogmes et des illusions autoritaires. Pour un citoyen désabusé, comprendre cela peut redonner confiance: nos institutions ne seront jamais parfaites, mais elles peuvent apprendre, comme nous, de leurs propres limites. Et il y a une dimension presque libératrice dans cette perspective: nous n’avons pas besoin de croire à une perfection impossible, mais de cultiver un processus collectif d’essais, d’erreurs et de corrections. C’est ainsi que les démocraties restent vivantes, et que les citoyens peuvent se sentir acteurs d’un projet commun.
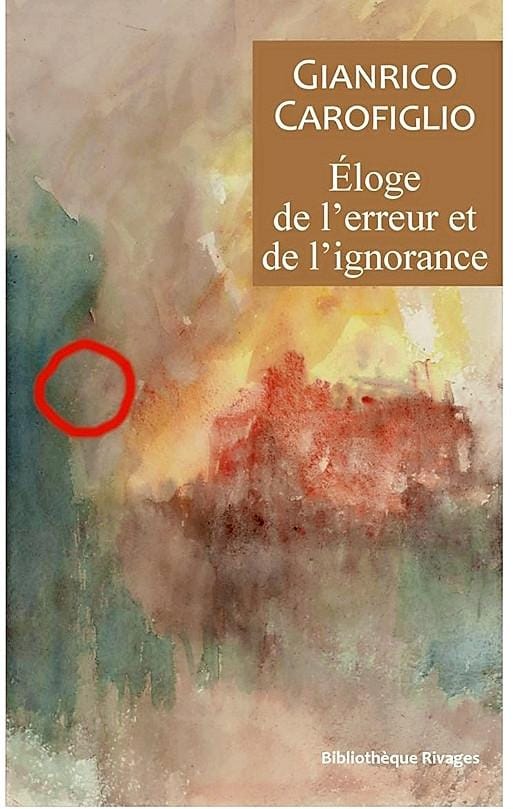
Bio express
1961
Naissance à Bari (Italie).
1983
Diplôme en droit à l’université de Bari.
1986-2007
Procureur de la République italienne.
2007-2008
Consultant auprès de la commission parlementaire anti-mafia.
2008-2013
Sénateur.
2002-2025
Romancier, essayiste et professeur.
