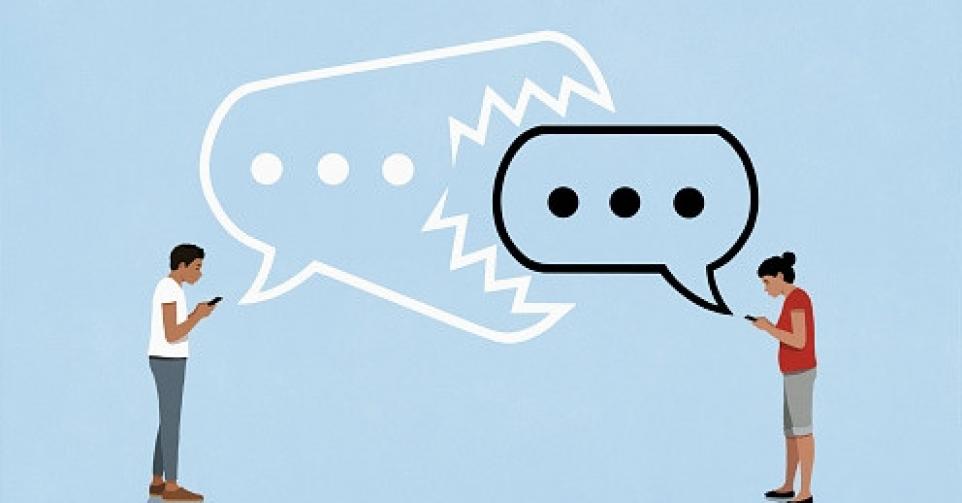De plus en plus d’hommes se confient à leurs amies, sœurs ou collègues pour évacuer leur trop-plein émotionnel. Ces femmes deviennent, souvent malgré elles, leurs confidentes attitrées. Derrière ce déséquilibre discret se dessine un phénomène nouveau, nommé dans le monde anglo-saxon, le mankeeping.
Clara n’en peut plus. Paul, son meilleur ami, coach sportif, vient encore de l’appeler pour «vider son sac». Une énième soirée à refaire sa journée éprouvante, à dérouler ses doutes, ses colères, ses angoisses. «J’ai l’impression d’être sa psy, pas son amie», confie-t-elle, mi-lassée, mi-coupable. Paul, lui, semble soulagé: depuis des mois, il rentre du travail chargé de tensions qu’il ne parvient à décharger qu’en les confiant à Clara. Cette dernière compatit, l’interrompt rarement, opine avec douceur aux monologues anxieux de son ami. Quasi chaque soir au téléphone, le scénario se répète: Paul extériorise son stress, Clara accueille tout, console, rassure, et tait son propre épuisement. Elle l’apprécie, bien sûr, «mais je n’en peux plus d’encaisser toutes ses angoisses», avoue-t-elle d’une voix blanche.
Clara ne le sait que trop: sans elle, Paul n’a personne à qui parler aussi librement. Certes, il a des amis, une sœur, des collègues de confiance. Mais se livrer vraiment? Très peu pour lui. Il ne veut pas «embêter» ses potes avec ses états d’âme, dit-il, et encore moins aborder ses doutes avec son propre frère. Clara est devenue son unique exutoire émotionnel, un rôle dont l’amie à l’oreille attentive se serait bien passée. Pourtant, elle n’ose pas le lui reprocher frontalement. A 30 ans à peine, la jeune femme s’est comme résignée à porter ce fardeau invisible. Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS, spécialiste du féminin, du masculin, de la famille, décrit le contexte qui façonne ces confidences sélectives: «L’idéal viril est encore très prégnant. Virilité et vulnérabilité ne riment pas ensemble. Ce n’est que récemment, à l’échelle de l’histoire de la société, que les hommes ont aspiré à se définir comme des hommes sensibles. Mais ils ne le font qu’avec certaines personnes, car cela les rend vulnérables. Les jeunes ne sont pas enclins à le faire car il leur faut s’affirmer, être forts, compétitifs, performants. Les plus âgés qui n’ont plus rien à prouver sont plus enclins à le faire. Des études que j’ai analysées le montrent bien.»
Dans le cas de Clara, si Paul la choisit, c’est aussi que l’expression d’une fragilité reste perçue comme coûteuse pour un homme. Ce scénario, de plus en plus de femmes le vivent à leurs dépens. Les Anglo-Saxons lui ont même donné un nom: le mankeeping. Ce néologisme désigne le travail émotionnel assumé par de nombreuses femmes afin de répondre aux besoins affectifs de proches masculins. Autrement dit, le mankeeping décrit cette tendance masculine à se reposer presque exclusivement sur les femmes de son entourage –amies, sœurs, collègues, compagnes– pour alléger un trop-plein émotionnel qui ne peut être exprimé nulle part ailleurs. Dans le détail, la sociologue met au jour l’engrenage qui entretient cette asymétrie: «Que les hommes se confient auprès des femmes va avec la conception duale par rapport à la culture féminine, à savoir que les femmes sont sensibles, émotives, communicatives… Les hommes sont alors enclins à se confier quand ils ont besoin d’aide. C’est une preuve de confiance. En retour, eux auront du mal à recevoir les confidences des femmes et à les aider. Leur capacité à comprendre le domaine du privé, de l’intime est limitée.»
Depuis l’enfance, les petites filles sont encouragées à faire preuve d’empathie et d’attention aux autres, tandis que les petits garçons entendent qu’«un homme, un vrai, ne se plaint pas». Devenus adultes, ces hommes peu loquaces finissent par chercher refuge auprès de celles qui, elles, ont appris à écouter. Clara, confidente malgré elle, est de celles-là.
Les hommes n’ont que récemment aspiré à se définir comme des hommes sensibles.
La charge affective invisible
Nombre de femmes partagent cette expérience d’une charge émotionnelle inégale, diffuse et rarement reconnue. Dans le couple hétérosexuel traditionnel, c’est encore la femme qui endosse le rôle de pilier psychologique. Qu’il s’agisse d’apaiser les chagrins, de tempérer les colères ou de redonner confiance, elle sert d’infatigable soutien moral, souvent sans même que cela soit explicitement formulé. Ce fardeau est d’autant plus lourd qu’il passe pour «normal», presque naturel. On valorise l’écoute et la douceur des femmes, on salue leur intuition émotionnelle, sans réaliser qu’en creux s’installe une attente univoque: madame doit encaisser. «Cela devient une norme douce… et pourtant terriblement violente», estime la psychologue sociale et thérapeute de couple Céline Bercion à propos de cette abnégation féminine intériorisée.
Les chiffres, eux, permettent de prendre la mesure du phénomène. Dans de nombreuses études, les hommes avouent ne compter que sur leur compagne pour se confier. Par exemple, un sondage réalisé par l’American Perspectives Survey, cité par Psychology Today, a révélé que seuls 20% des hommes sollicitent un ami proche lorsqu’ils veulent discuter d’un problème personnel. En somme, de nombreux hommes n’ont personne d’autre que leur partenaire vers qui se tourner pour ouvrir leur cœur.
Pourquoi un tel écart? Les femmes, en règle générale, peuvent s’appuyer sur des amitiés profondes, une famille proche, tout un filet de sécurité affective tissé au fil du temps. Quand survient une épreuve, elles activent ce réseau: on console une amie en détresse, on déjeune avec sa sœur pour parler cœur, on appelle sa mère en quête de soutien… Les hommes, eux, sont rarement entourés d’un cercle aussi intime et solidaire. «Les hommes ont tendance à centraliser leur besoin de soutien émotionnel autour de leur partenaire, contrairement aux femmes qui s’appuient sur un réseau émotionnel social plus étendu et diversifié», confirment plusieurs sources convergentes.
De l’avis des experts, cela tient à la socialisation différenciée des deux sexes. La sociologue résume ce verrou d’apprentissage dès l’enfance et ses effets à l’âge adulte: «Pour un homme, demander de l’aide est signe de faiblesse. Les hommes qui font des tentatives de suicide ne se ratent pas, car ils ne veulent pas montrer leur défaillance. Les hommes ne se confient pas aux copains, contrairement aux femmes avec leurs copines.» En effet, apprendre à écouter, à comprendre les émotions et, de manière plus large, prendre soin de l’autre reste souvent associé au féminin. A l’inverse, on attend d’un garçon qu’il sache encaisser sans broncher. Résultat? «Dans l’inconscient collectif hétérosexuel, il est encore largement admis que la femme est la variable d’ajustement du lien. La femme est celle qui sent, ajuste, répare… Même sans demande explicite, elle porte ce que l’autre ne nomme pas», souligne Céline Bercion. Cette inégale répartition des rôles affectifs, longtemps passée sous silence, commence tout juste à être documentée et questionnée.
Seuls 20% des hommes sollicitent un ami proche lorsqu’ils veulent discuter d’un problème personnel.
Le poids du silence masculin
Si les femmes en souffrent, la situation n’est guère plus enviable pour les hommes, pris au piège de leur propre silence. «On enseigne aux hommes que les sentiments sont féminins», déplore Clara. Ainsi, beaucoup n’osent pas exprimer leurs peines ou leurs peurs auprès de leurs pairs masculins, de peur de paraître faibles ou «pas virils». «On n’apprend pas aux hommes à écouter, à essayer de réparer les choses. Ils ne peuvent pas pleurer, seulement se fâcher.» Lorsqu’un homme va mal, ses amis ne disposent pas forcément des codes pour accueillir sa vulnérabilité. Faute d’espace de confiance entre mâles, les confidences entre hommes restent l’exception, ce qui ne signifie pas que le besoin n’existe pas.
Dans l’entourage de Clara, le constat se vérifie. Thibault, son frère aîné, est lui aussi adepte du «tout à ma sœur». A 35 ans, ce jeune père divorcé compte pourtant de nombreux copains de longue date, mais il ne se sentirait «ni compris ni en confiance» pour aborder ses états d’âme avec eux. «Avec mes potes, je ne peux pas parler de mes faiblesses. J’aurais l’impression d’être ridicule», confie-t-il. Alors, quand le moral flanche, Thibault décroche son téléphone et appelle… sa sœur, Clara. Soir après soir, la jeune femme endosse le rôle de secours émotionnel familial. Elle écoute son grand frère ressasser sa séparation, ses difficultés de père célibataire, son anxiété face à l’avenir, pendant que lui, prudent, n’a presque rien dévoilé de ces tourments à son meilleur ami. «Mon meilleur copain est au courant de ma dépression, mais on n’en parle pas. Entre nous, on fait comme si de rien n’était», admet Thibault. A défaut de pouvoir montrer sa tristesse à ses amis, il la déverse auprès de sa sœur. Celle-ci, par loyauté, l’épaule du mieux qu’elle peut… au risque de se laisser envahir.
Du côté des hommes, une lente évolution est en cours. Les initiatives se multiplient pour briser le tabou de la vulnérabilité masculine. Aux Etats-Unis, des groupes de soutien entre hommes connaissent un succès grandissant depuis quelques années: rassemblés en petits cercles confidentiels, ils y apprennent à exprimer leurs peines et leurs doutes sans crainte du jugement. De tels espaces existent également en Europe: ateliers de parole pour jeunes pères, groupes de discussion en ligne sur la santé mentale masculine, cafés «papa» pour échanger sur les difficultés du quotidien… En Belgique, par exemple, le «Café des papas» du CHU Saint-Pierre (une fois par mois) réunit des futurs pères et jeunes pères autour de questions très concrètes; ces ateliers sont animés par un professionnel partenaire de l’ONE, l’Office de la naissance et de l’enfance. En France, «Les Pâtes au beurre», réseau de lieux de soutien à la parentalité, garantit un accueil gratuit, anonyme, assuré par des cliniciens… autant de lieux où la solidarité émotionnelle entre hommes commence timidement à se frayer un chemin. Parallèlement, la gent masculine recourt de plus en plus aux professionnels: la fréquentation des psychologues par des patients de sexe masculin a augmenté ces dernières années (même si les hommes ne représentent encore qu’une minorité des consultations). En France, par exemple, selon les données publiées par Doctolib, relayées par le site médical Univadis (septembre 2024), les consultations d’hommes auprès d’un psychologue ont augmenté de 29% en un an. Selon les spécialistes, la honte autour de la «thérapie» tend à s’estomper chez la jeune génération, plus sensibilisée aux enjeux de santé mentale.
Dans un couple, deux amis ou une fratrie, se soutenir mutuellement, alternativement, est la clé d’une relation plus riche et plus équilibrée. A terme, c’est tout l’enjeu: que chacun, homme ou femme, puisse trouver une oreille attentive sans pour autant en devenir prisonnier. Partager ses émotions, oui. S’y noyer à deux, non.
Faute d’espace de confiance entre mâles, les confidences entre hommes restent l’exception.