«La surprise sourit tranquillement, comme une impératrice», et Valérie Zenatti sait pourquoi. Romancière multiprimée, scénariste, elle consacre à ce mot en apparence léger un essai vif et profond, La Surprise. Une innocence renouvelée (1).
A rebours d’une époque saturée d’algorithmes, d’alertes et de breaking news où l’on prétend tout prévoir, Valérie Zenatti fait de la surprise une épreuve de vérité: un soudain qui décentre, une vibration qui précède la pensée, un basculement qui recompose le rapport au temps, de la sidération tragique à l’émerveillement. Elle explore cette résistance intime qu’elle revendique: cultiver l’étonnement contre le formatage, accepter l’inattendu en soi, jusqu’à se surprendre à penser autre chose que ce qu’on a toujours pensé. On y croise Aristote et Jankélévitch, l’étymologie française et l’hébreu, l’amour comme «surprise absolue», ou encore l’amitié comme coup de foudre discret.
A l’heure où la surprise est devenue à la fois marchandise médiatique et matière première du chaos, instrumentalisée par les populistes, comme elle le documente dans l’essai, l’autrice en réhabilite la part souveraine: l’art humble de laisser advenir, d’improviser juste, de tenir ensemble la peur et la joie… afin de retrouver, au-delà des notifications, le battement du vivant.
Pourquoi avoir retenu le mot «surprise» comme fil conducteur de votre essai?
Le principe de la collection «Les grands mots» dans laquelle s’inscrit ce livre est de choisir un mot, et de proposer à partir de celui-ci une réflexion, une vision du monde ou de l’existence. Lorsque l’éditrice Claire Fercak m’a proposé de rejoindre cette aventure, j’ai été immédiatement en proie au ravissement et à l’affolement. Quel mot choisir? Cette proposition me mettait dans l’état embryonnaire de chaque livre, lorsque tout est ouvert, toutes les directions peuvent être prises, c’est le vertige du choix et de son corollaire: le renoncement. Au bout de quelques semaines tâtonnantes, le mot «surprise» a jailli (le projet en question en avait été une pour moi), et j’ai su que c’était «mon» mot, car la surprise contient tout ce qui m’interroge et me fascine: l’inattendu, l’émerveillement, la stupeur, la remise en question, les plus grandes joies comme les plus grands chagrins.
Le mot semble intempestif par les temps qui courent. Dans une époque saturée d’algorithmes qui cherchent à tout prévoir, cultiver la surprise est-il un acte de résistance intime?
J’aime le terme de «résistance intime» associé à la surprise. Cultiver la surprise peut sembler paradoxal, étant donné qu’elle désigne précisément ce qui nous échappe, ce à quoi l’on ne s’attend pas. On peut organiser l’inattendu pour les autres, certes, mais pour soi-même? L’exploration de cet état m’a donné quelques indices cependant, dans le rapport que la surprise entretient avec la curiosité et l’audace. C’est l’espoir d’être surpris qui nous pousse vers un livre, un film, une pièce de théâtre, une série télévisée. C’est cette soif de découverte qui anime le désir de connaissance (c’est le fameux «étonnement» évoqué par Aristote). Cultiver la surprise, c’est à la fois être attentif à celles qui «nous tombent dessus» mais aussi aller vers tout ce qui propose une autre vision que la nôtre, une autre expérience, et s’étonner d’éprouver qu’elle ajoute en nous un nouvel éprouvé, une nouvelle perception. C’est une résistance au formatage par les algorithmes que vous évoquez, et qui cherchent à nous conforter dans une vision. La plus grande surprise est peut-être de se surprendre à penser autre chose que ce que l’on a toujours pensé, à faire un choix soudain qui ne nous ressemble pas a priori. De découvrir quelque chose qui contredit nos certitudes.
Dans le même temps, nos vies contemporaines sont rythmées par les alertes, les breaking news, les catastrophes. La surprise est-elle devenue la matière première de l’actualité?
Les bonds technologiques ont modifié notre rapport à l’actualité. Je ne pense pas qu’il y a plus d’événements qu’auparavant, mais ils nous parviennent en direct, de manière diffractée, et nous submergent. Autrefois, il fallait attendre plusieurs jours avant d’avoir connaissance d’un événement qui parvenait sous forme de récit. Puis ce fut «la grand-messe du 20h», tout le monde se rassemblait pour entendre une narration du monde. L’info continue, les alertes sur les téléphones font éclater cette métabolisation, avec souvent une volonté de surenchère qui ne laisse pas le temps de penser l’événement, sans compter la surenchère des réactions. On ne prend pas le temps de la sidération, puis de son interrogation. Très souvent, face aux catastrophes, j’ai envie de poster un écran noir et de me taire, pour prendre la mesure de ce qui arrive.
Vous écrivez que «la surprise sourit tranquillement, comme une impératrice»: qu’entendez-vous par cette souveraineté du soudain?
La surprise est ce qui déjoue tous les pronostics, ce qui invalide parfois nos certitudes, ce qui nous rappelle à notre condition minuscule. En quelques secondes, ce à quoi nous avions cru peut se renverser, pour le pire comme pour le meilleur. Elle nous sort de notre torpeur, ou d’une inquiétude qui se voit soudain déviée. Elle nous rappelle à tout ce que nous ne maîtrisons pas, c’est là que réside la souveraineté du soudain.
Vous insistez sur la dimension sonore de la surprise (un cri, un gong, une sirène). Pourquoi ce lien entre surprise et vibration, presque musicale?
Je cite dans ce chapitre un livre du philosophe François Noudelmann, Penser avec les oreilles, où il s’attache à démontrer les liens entre la pensée et le son. Pourquoi une voix sera-t-elle plus persuasive qu’une autre, plus audible, plus agaçante? La question de la voix intérieure est tout aussi passionnante, cette voix à l’œuvre lorsqu’on lit ou que l’on écrit, et qui n’est audible par nul autre. En écrivant sur la surprise, il m’est apparu qu’elle est souvent un événement accompagné de sons, et que dans tous les cas, elle suscite avant tout une exclamation, y compris intérieure et donc en apparence silencieuse. Mais elle résonne alors d’autant plus fort. Cette vibration est une des toutes premières réactions à la surprise, qui précède ou accompagne la compréhension de ce qui vient de se produire, ou est en train de se produire.
Vous parlez d’«effet de surprise» comme d’une métamorphose. Pourquoi ce basculement soudain transforme-t-il aussi profondément nos existences?
Précisément parce qu’il est soudain, et souvent radical. Les écrits du philosophe Vladimir Jankélévitch qui affrontent la question du temps ont révolutionné ma perception. Il m’a fait saisir la nouveauté contenue dans chaque seconde. Mais il est impossible d’en avoir conscience en permanence, cela nous empêcherait de vivre, et pourrait nous rendre fous. Les basculements soudains nous envahissent d’une sensation tranchante: désormais, il y aura un avant et un après. On sera cette personne qui a perdu ses illusions, ou qui a gagné en confiance. Cet effet de surprise qui nous traverse donne alors la sensation d’être métamorphosé.
Cela renvoie à ce que vous écrivez dans le livre, quand vous dites que la surprise oscille entre sidération tragique (attentats, guerres, pandémies) et émerveillement (un texte, une rencontre)…
Ce mot avait d’emblée pour moi une valeur intéressante, car sa charge est aussi bien positive que négative. Dans ce livre, je tords le cou à l’idée que la surprise serait anecdotique dans nos vies, par son caractère fugace, et par le mauvais service qu’on lui a rendu en l’associant beaucoup au mot «cadeau». Or, cet état est bien plus profond, il est présent dans les moments critiques de ce qui fait nos vies: naissance, mort, amour, rupture, succès, échec. J’avais envie d’explorer toutes ces facettes pour saisir la façon dont nous nous tenons en équilibre entre l’obscurité et la clarté, et par-dessus tout sans doute, effleurer ce qui m’anime lorsque j’écris: la sensation première de rester sans voix face à certains événements, d’avoir besoin de temps pour déplier les sensations que vous évoquez. La sidération ou l’émerveillement nous ramènent à une forme d’innocence. Nous prenons conscience que nous ne savions pas grand-chose, et en réalité, nous ne saurons jamais grand-chose, mais cette prise de conscience est en elle-même un contact très puissant avec l’existence.

Vous évoquez «les opposants pacifistes» qui n’aiment pas être surpris, ou encore «les blasés» et «les complotistes». Pourquoi certains rejettent-ils viscéralement la surprise?
En se penchant sur la résistance à la surprise, on peut comprendre l’importance de cette dernière dans notre rapport à l’existence. Je brosse un portrait tendre, il me semble, des opposants pacifistes, ceux pour qui tout imprévu est source d’angoisse. Les blasés sont agaçants par l’émerveillement qu’ils refusent aux autres, c’est une forme d’arrogance un peu suspecte à mes yeux. Les trois autres catégories sont une source d’inquiétude et prouvent que le refus de la surprise a aussi à voir avec le complotisme, le déni, voire avec le désespoir.
«Les blasés sont agaçants par l’émerveillement qu’ils refusent aux autres.»
A l’inverse, vous proposez «dix commandements pour cultiver l’aptitude à la surprise». Est-ce un véritable entraînement de vie?
Je n’ai pas cette prétention, ayant renoncé moi-même à trouver le mode d’emploi de la vie. Mais disons que l’incitation à accueillir la surprise, que ce soit par l’expérience ou la pensée, m’apparaît comme une piste intéressante pour s’autoriser à mieux improviser, un peu comme le font les musiciens de jazz ou de musique arabo-andalouse. Ils saisissent la vibration de l’instant. Ils savent que personne ne dispose de la partition de sa vie.
Vous analysez comment la surprise peut être utilisée politiquement, pour déstabiliser, manipuler, saturer l’espace médiatique. Comment résister à cette instrumentalisation?
C’est Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump, qui a théorisé cette stratégie qui consiste à «inonder la zone». Le sentiment d’être submergé par des déclarations plus ahurissantes les unes que les autres n’est pas dû qu’aux nouvelles technologies, qui sont plutôt le moyen de propager cette tactique. L’état de sidération quasi permanent qui s’ensuit empêche d’organiser la riposte. Deux manières se dessinent pour résister à cette instrumentalisation: ne pas renoncer à s’informer, comprendre, s’imprégner d’analyses, et essayer d’agir politiquement. La tâche n’est pas facile, mais c’est précisément pour cela qu’on ne peut pas y renoncer. L’autre manière, plus intime, plus personnelle, plus petite en quelque sorte, revient à soustraire la surprise à cette folie chaotique qu’on ne maîtrise pas, pour vivre le monde dans le périmètre immédiat qui est le nôtre, certes restreint, mais ouvrant sur une multitude de rencontres, de découvertes et d’actions possibles. Faire taire les alertes un instant sur son téléphone, en restant en état d’alerte dans l’espace sensoriel et humain qui nous entoure, est une forme de liberté assez saine.
L’étymologie française renvoie au fait d’être «pris», l’hébreu au «soudain»: qu’apporte ce croisement linguistique à votre réflexion?
Ces deux langues m’ont offert un socle de réflexion en liant deux approches qui sont à mes yeux complémentaires, et donnent la clé qui permet de comprendre l’importance de la surprise. L’étymologie française renvoie à l’être dans sa totalité physique et corporelle. L’étymologie hébraïque renvoie à l’irruption soudaine d’un événement dans le temps. La surprise serait donc un moment où tout notre être «encaisse» un élément nouveau, dans un temps très bref. Cette définition s’applique tant au coup de foudre qu’à la mort, et à tous les moments de contact aigu avec ce qui nous fait sentir vivant, nous démolit ou nous construit. Une amie ukrainienne m’a dit que dans sa langue, être surpris signifie littéralement «être témoin d’un miracle» et j’aime également cette étymologie, qui renvoie au fait que face aux grandes surprises, la raison semble buter.
«Face aux grandes surprises, la raison semble buter.»
Vous racontez comment l’amour peut surgir comme une surprise absolue, bouleversant le temps. Est-ce la plus grande surprise qui puisse nous arriver?
La plus grande surprise est la toute première, celle que nous avons tous oubliée: notre naissance, notre tout premier contact avec le monde qui sera le cadre de notre vie. Mais la surprise de l’amour, bien consciente, est sans doute l’une des plus enivrantes, car elle entremêle la coïncidence et l’évidence, ce que l’on nomme parfois le hasard et la destinée. Elle vivifie toutes les perceptions en accordant à un être qui surgit une place centrale qu’il n’occupait pas quelques secondes auparavant. Elle rend joyeux et vibrant d’une manière littéralement folle, car elle pousse au paroxysme le rapport au temps, au manque et à la satiété. Elle a un pouvoir de transformation extrêmement impressionnant et donne un sentiment d’inédit qui est à l’œuvre à chaque instant en réalité, mais que l’on ne perçoit pas. On est amoureux, et c’est la première fois que cela arrive, même si ce n’est pas la première fois. On est persuadé que personne n’a jamais rien vécu de tel et c’est vrai en un sens. Cette unicité est à proprement parler splendide.
«La surprise de l’amour est l’une des plus enivrantes, car elle entremêle la coïncidence et l’évidence.»
En plus de l’amour, vous explorez aussi l’amitié, ce «coup de foudre» moins attendu. En quoi la surprise peut-elle être constitutive de nos liens humains, notamment amicaux?
Je pense que le mot «altérité» rejoint ici les liens humains sous la forme première d’une surprise, si l’on considère celle-ci comme la rencontre avec ce qui est au-delà de nous, et qui entre d’une certaine manière en nous. La relation amicale n’est pas une donnée première de nos vies. Elle est une découverte, et un étonnement joyeux: on s’étonne de se sentir si proche d’un étranger, d’une étrangère. Par ce contact affectif, et parfois intellectuel, on s’ouvre à d’autres récits, d’autres visions, on est parfois ébranlé dans nos préjugés ou nos craintes, c’est un enrichissement extraordinaire.
Dans un chapitre fort, vous citez Nabokov qui évoque la mort comme «la plus grande des surprises». Comment apprivoiser cette sidération ultime et la période du deuil?
La mort est un rappel choquant de l’irréversibilité du temps. Retrouver son chemin dans le temps qui continue de s’écouler est quelque chose de très intime auquel nous ne sommes jamais vraiment préparés. Certains rites peuvent être des bornes sur ce chemin, mais aussi l’invention personnelle d’un rapport à l’absence, aux traces, et à «la vie qui continue». Le mot deuil me déplaît, car il est trop corseté dans les rites religieux, dans des injonctions sociales, et dans une vulgarisation de l’expression «faire son deuil». La mort de quelqu’un, comme la rencontre amoureuse, est un événement si unique qu’il réclame que chacun trouve le sens que cela a précisément pour lui, pour elle, à ce moment de son existence.
Vous racontez aussi vos propres surprises. Pourquoi était-il important de mêler votre voix à celle de l’essai?
Je n’avais pas la prétention d’écrire un essai purement théorique, car je ne suis pas théoricienne. J’ai découvert en écrivant ce livre que la quête de la surprise est ce qui m’anime dans le mouvement qui me pousse à écrire. On trouve donc dans le tissu de ce texte des fils personnels, collectifs, des chapitres de différentes natures, des témoignages, du cinéma, de la littérature, tout ce qui constitue en quelque sorte la doublure de mon état d’écrivaine. Je me suis beaucoup amusée en composant ces variations. Le terme peut sembler inapproprié, mais il signifie étymologiquement «avoir le museau en l’air». J’ai adopté cette position curieuse, pour voir et entendre ce que la surprise avait à nous dire, en passant par le prisme de ma personne.
Si vous deviez résumer en une phrase l’enjeu vital de la surprise pour nos vies contemporaines, quelle serait-elle?
Tout peut arriver, c’est à la fois terrifiant et exaltant, tâchons de naviguer entre ces deux pôles.
(1) La Surprise. Une innocence renouvelée, par Valérie Zenatti, Autrement, 272p.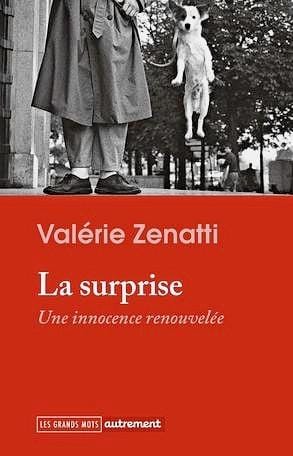
Bio express
1970
Naissance, à Nice.
2003
Publie son premier roman, Une bouteille dans la mer de Gaza (L’Ecole des loisirs).
2013
Chargée de cours à Sciences Po Paris.
2015
Prix du livre Inter pour son roman Jacob, Jacob (éd. de l’Olivier).
2018
Présidente de la commission «littératures étrangères» du Centre national du livre.
