Nos sociétés ont évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le récit postcolonial s’affiche désormais comme concurrent de celui de la Shoah, analyse le sociologue Jean De Munck (UCLouvain).
Que dit de nos sociétés la montée de l’antisémitisme et quelles en sont les causes? Décryptage avec le sociologue Jean De Munck, professeur ordinaire émérite et professeur invité à l’UCLouvain. Il a dirigé le centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS).
La vague actuelle d’antisémitisme en Europe est-elle inédite depuis la Seconde Guerre mondiale?
Ce qui est important, c’est la modification des coordonnées symboliques de l’antisémitisme. L’antisémitisme est un phénomène séculaire. Mais il évolue selon les conjonctures historiques. On doit être attentif au changement de ses motivations compte tenu de l’actualité à la fois interne à nos sociétés mais aussi géostratégiques. On se trouve, il est vrai, aujourd’hui devant une configuration inédite. Plusieurs choses sont en train de changer. D’abord, il y a la question du grand récit qui nous porte. Depuis 1945, il a été articulé en Europe à la Shoah. Le génocide d’Auschwitz était un point de référence concernant le «mal absolu» en politique. Aujourd’hui, il y a désormais le récit postcolonial dans lequel Gaza apparaît comme une figure du «mal absolu». Je ne dis pas nécessairement qu’il est en concurrence avec celui de la Shoah, mais cela peut apparaître comme tel. Cette évolution change la perception que l’on peut avoir de la position du peuple juif et des motivations de la fondation d’Israël. Par ailleurs, il n’y a plus que 10% du peuple juif qui réside en Europe contre 90% en 1939. Les Juifs sont dispersés entre Israël, les Amériques et l’Europe. Les coordonnées de l’antisémitisme ont changé aussi à travers cette mutation.
«Nous n’avons pas la capacité de saisir l’aspect religieux du conflit israélo-palestinien».
Le récit postcolonial a-t-il tendance à «surpasser» celui de la Shoah?
Il se présente faussement comme une concurrence. On rencontre des difficultés aujourd’hui à enseigner la Shoah parce que les jeunes générations, 80 ans après, vous disent: «Oui, mais Gaza ?» Evidemment, le «oui, mais» n’a aucun sens. Mais cela crée une difficulté pour percevoir ce qui est en train de se passer.
En quel sens?
Nous avons du mal à comprendre deux choses aujourd’hui à propos des Juifs. Premièrement, parce que l’Europe est un continent exceptionnellement sécularisé, c’est la dimension religieuse du problème du Moyen-Orient. Il y a une incompréhension de la position du judaïsme dans l’histoire du monothéisme. Historiquement, tant le christianisme que l’islam, qui sont des rejetons du judaïsme et sont nés après lui, ont eu une relation très ambivalente envers le judaïsme. D’un côté, le christianisme et l’islam ont cherché à inclure le judaïsme; l’Ancien Testament, par exemple, fait partie des livres sacrés du christianisme depuis l’origine. D’un autre côté, ils ont cherché à se démarquer du judaïsme. Il y a un antisémitisme chrétien et, en même temps, parfois un philosémitisme chrétien, notamment dans le monde protestant. C’est pareil du côté de l’islam. Celui-ci a une relation très ambivalente à l’égard du judaïsme. Des passages antijuifs figurent dans la tradition écrite, dans le Coran et dans les hadiths. Mais il y a aussi de l’inclusion et de la judéophilie. Musulmans et Juifs ont connu des épisodes de coexistence assez remarquables. Mais cette histoire est oubliée dans nos sociétés parce que, tout simplement, nous n’avons plus de culture religieuse. Donc, nous ne comprenons pas les acteurs extrémistes qui aujourd’hui sont motivés par la religion, le Hamas ou des colons de Cisjordanie. Nous ignorons de quoi il s’agit et nous n’avons pas la capacité de saisir cet aspect religieux du problème. Cette difficulté est due à notre position d’Européens de l’Ouest. Aux Etats-Unis en revanche, les chrétiens sionistes sont des acteurs essentiels de la scène nationale interne. Nous n’en avons pas en Europe. Ce décalage de référentiel rend la compréhension du conflit très difficile pour le jeune Européen de l’Ouest élevé dans une société séculière. Il analyse cela en matière de laïcité et il croit qu’au Moyen-Orient, on peut construire un Etat laïc.

Quelle est la deuxième donne à propos de Juifs que nous avons des difficultés à comprendre?
C’est la compréhension du caractère unique de l’histoire du peuple juif dans le sionisme. Le sionisme est-il un fait national ou un fait impérial? Telle est la question. Il y a des traces d’impérialisme dans la création de l’Etat d’Israël puisque l’Etat et le peuplement juif de Palestine ont été fortement encouragés par les Britanniques, à travers la déclaration Balfour de 1917. C’est ainsi que la création d’Israël fut vécue du côté arabe: comme un épisode de plus de la colonisation occidentale qui s’est déployée partout dans le monde. Des traces de cette propension existent encore aujourd’hui à travers des erreurs comme le projet de nommer Tony Blair à la tête d’une autorité pour gérer Gaza. L’Occident est à nouveau à la manœuvre… Gaza apparaît donc aux yeux de certains comme le dernier théâtre de la lutte anti-impérialiste commencée dans les années 1940 lorsque l’Inde et les différents pays du Sud se sont libérés de la tutelle occidentale. Or, la fondation d’Israël n’est pas un fait colonial, mais national. En fait, il faut lire le combat pour la création d’Israël comme une lutte de décolonisation. L’Etat est fondé pour libérer les Juifs du racisme des Européens. C’est une lutte d’émancipation… Fonder une nation est bien le but de Theodor Herzl et de tous les sionistes, qui ont d’ailleurs comme modèles les nationalismes d’Europe centrale. On a une difficulté à comprendre cette singularité d’Israël. C’est en reconnaissant l’Etat d’Israël et en instaurant les droits de l’homme à l’échelle européenne, notamment la liberté de religion et de culte, qu’on est sortis de l’antisémitisme en 1945-1947 en Europe. C’était notre solution. Qui est en train de trembler parce qu’elle apparaît contradictoire avec l’ambition de l’Europe post-impériale alors que la création d’Israël fut pour les Juifs un fait national et pas impérial.

«La tragédie palestinienne n’est pas que palestinienne. Elle est liée à l’histoire du nationalisme.»
Mais un projet national forgé aux dépens d’un autre peuple, le peuple palestinien?
Oui, malheureusement. Mais il faut rappeler qu’à l’époque, ce n’est pas propre à Israël. Les nettoyages ethniques sont consubstantiels à la construction de la nation. Dans les années 1920, la Turquie a évacué plus d’un million de chrétiens d’Anatolie et les Grecs ont fait de même avec les musulmans de Thrace. C’est bien sûr tout à fait condamnable. Mais au moment où en 1948, les Juifs expulsent ou amènent à quitter leur terre 800.000 Palestiniens (qui iront dans la bande de Gaza, notamment), en Europe, un million d’Allemands sont sur les routes expulsés par la Pologne et la Tchéquie, qui s’appelle alors la Tchécoslovaquie… Et les Alliés n’interviennent pas alors que les Polonais et les Tchèques font du nettoyage ethnique. La tragédie palestinienne n’est pas que palestinienne. Elle est liée à l’histoire des nations et du nationalisme.
En Europe, le remède contre l’antisémitisme qu’était la création d’un Etat a-t-il donc disparu?
Effectivement, l’existence d’Israël ne suffit plus à protéger les Juifs. Il y a eu une défaillance factuelle le 7 octobre 2023, vécue comme terrible non seulement par les Israéliens mais par tous les Juifs du monde. La vocation d’Israël comme Etat refuge a été mise à mal. Je n’ai pas l’impression que la réponse de Benjamin Netanyahou ait été adaptée du tout. Cela renvoie à la confusion qui existe aussi aujourd’hui entre sionisme et droite sioniste. Le sionisme, comme tout projet national démocratique, contenait différentes tendances politiques. Benjamin Netanyahou ne représente qu’une d’entre elles, celle de l’extrême droite. La pluralité du sionisme est aujourd’hui affectée par la victoire écrasante de la tendance d’extrême droite. Elle remonte à 1996 et à la première victoire électorale de Netanyahou. Depuis, une tendance profonde s’est ancrée dans la société israélienne qui la porte de plus en plus à droite avec un foyer politique extrêmement actif en Cisjordanie. Aujourd’hui, le sionisme est dominé par une droite qui a fait main basse sur le mouvement. Mais cela ne signifie pas que le sionisme, c’est de l’extrême droite. C’est très difficile à faire comprendre. Je lis des affirmations comme «ce qui se passe à Gaza, c’est le déploiement de l’essence du sionisme». Non, il n’y a pas d’essence du sionisme. Il y a un débat politique au sein d’Israël. Et ce débat et même parfois ce combat, pour l’instant, ont été gagnés par l’extrême droite. Le sionisme n’est pas intrinsèquement d’extrême droite, militariste, religieux… Il y a une méconnaissance de la diversité et de la singularité juives. Elle est une des explications de la confusion entre antisionisme et antisémitisme. On vit dans un monde où la perception de la réalité et des enjeux est devenue extrêmement difficile concernant ce conflit.
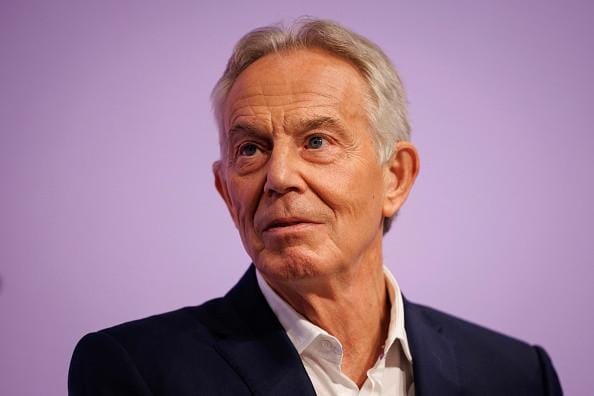
D’où la tendance à assimiler toute critique du gouvernement israélien à de l’antisémitisme?
Le pire, c’est que c’est devenu la spécialité de la propagande de Benjamin Netanyahou: semer la confusion. Le gouvernement israélien a parfaitement raison quand, avec d’autres, il dénonce l’attaque de la synagogue de Manchester comme antisémite. Mais il accuse Emmanuel Macron du même péché quand la France reconnaît la Palestine, ou le gouvernement britannique quand il limite les exportations d’armes vers Israël. Dans le premier cas, nous avons bel et bien affaire à une attaque antisémite. Dans le second, l’amalgame est totalement abusif. Macron et Starmer luttent contre l’antisémitisme avec détermination. Cela n’aide pas à la bonne compréhension des faits et des enjeux du conflit.
Entretien: G.P.

