Le sociologue français Bernard Lahire plaide pour une véritable révolution éducative et scientifique. Pour lui, il est urgent de réaffirmer la centralité du savoir face aux crises climatique, sanitaire et démocratique. Sans ce sursaut, nous risquons non seulement de savoir moins, mais surtout de vivre moins.
A l’heure où l’intelligence artificielle fascine et inquiète, où les infox prolifèrent plus vite que les démentis, où les politiques réduisent l’école à des indicateurs chiffrés, Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme. Sociologue reconnu, professeur à l’Ecole normale supérieure de Lyon, il publie Savoir ou périr, un plaidoyer vif et incisif, et insiste sur une évidence: sans savoirs, pas de survie. Ce n’est pas une métaphore mais un constat biologique et historique: l’humanité ne doit sa présence partout sur la planète qu’à sa capacité à transmettre des connaissances. De l’exemple du «Smong», ce savoir ancestral indonésien qui sauva une île entière lors du tsunami de 2004, aux dérives évaluatrices qui étouffent aujourd’hui la recherche, l’essai déploie une réflexion puissante sur l’urgence de réaffirmer la centralité du savoir face aux crises climatique, sanitaire et démocratique. Fustigeant le «cirque évaluateur» des classements Pisa ou Shanghai, défendant l’esprit frondeur des chercheurs contre les conformismes académiques, Bernard Lahire plaide pour une véritable révolution éducative et scientifique. Selon lui, sans un sursaut collectif, nous risquons non seulement de savoir moins, mais surtout de vivre moins.
Vous écrivez que, pour l’humanité, «le savoir, c’est la survie». Pouvez-vous expliciter cette formule?
C’est beaucoup plus qu’une formule. C’est une réalité fondamentale qui traverse le vivant et a été soulignée par de nombreux biologistes. Il n’y a pas de vie sans capacité d’adaptation à son environnement, souvent changeant. Et qui dit adaptation, dit capacité à prélever des informations sur l’environnement, à les mémoriser et à en tirer des conséquences pratiques pour sa survie. Le succès évolutif de notre espèce, qui explique que nous soyons présents partout sur la planète, est dû au fait que nous sommes une espèce hyperculturelle qui a pu mettre en place un enseignement explicite, faire usage d’un langage pour guider les apprentissages, de l’écriture pour stocker les savoirs et créer des institutions spécifiquement dédiées à ces processus de transmission. Sans ces savoirs, nos sociétés s’effondreraient et c’est pour cela que j’essaie de faire prendre conscience du fait que toute attaque contre les savoirs et contre l’école est une atteinte à nos possibilités de survie collective.
Dans l’ouvrage, vous illustrez votre propos par un exemple concret: vous racontez comment le savoir oral Smong a sauvé l’île de Simeulue lors du tsunami de 2004. Quels seraient, aujourd’hui, nos «smongs» scolaires à transmettre d’urgence?
Je pense qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’enseigner sans inclure les enjeux climatiques ou liés à la biodiversité. Mais on ne doit surtout pas enseigner un catéchisme vaguement écologique.
C’est-à-dire?
Nous n’avons pas besoin de morale mais de savoirs. Beaucoup de thèmes peuvent se travailler autant en français ou en mathématiques qu’en histoire-géographie, en langues, en physique-chimie ou en sciences naturelles. Plus fondamentalement encore, la complexité de nos sociétés fait que nous avons besoin d’une maîtrise de raisonnements mathématiques, de capacités à lire et à écrire des textes de natures très différentes, d’apprendre à mettre en œuvre des démarches de recherche et à développer son esprit critique devant les multiples sources d’informations. L’idée n’est pas de réduire l’école à une formation survivaliste, mais de faire comprendre que nous avons besoin de transmettre des savoirs de fond pour affronter des défis majeurs présents ou à venir.
Vous rappelez que la science est une création, mais avec un rapport privilégié à la vérité…
Quand on parle de création, on pense généralement à la littérature ou à l’art. Or, la science est une création à part entière. Elle demande de l’imagination, de la profondeur, de l’intuition, de la capacité plastique à changer de point de vue, etc. Sauf que l’objectif final est de produire des connaissances vraies sur la réalité. Une connaissance est scientifique si elle nous fournit une image correcte de ce qui se passe dans le réel (physique, chimique, biologique, psychologique ou social). Celle-ci ne cesse de gagner en pertinence au fur et à mesure des recherches empiriques qui observent, mesurent, enregistrent des éléments de la réalité, et des reformulations théoriques. Ce rapport privilégié à la vérité est la raison pour laquelle on ne peut être relativiste: tout ne se vaut pas en matière de représentation du réel.
«Nous vivons dans des sociétés qui ont une obsession évaluatrice.»
Vous dénoncez «l’inversion des priorités»: l’évaluation a pris le pas sur l’apprentissage. Que faut-il abolir ou réécrire pour remettre le système «sur ses pieds»?
Cela peut paraître surprenant, mais il faut tout simplement remettre l’apprentissage au cœur du système, de même qu’il faut remettre la recherche de la vérité au centre de l’activité scientifique. Nous vivons dans des sociétés qui ont une obsession évaluatrice. Et l’on évalue pour classer et hiérarchiser. Mais tout ce «cirque évaluateur» est totalement extérieur aux processus d’apprentissage ou aux processus de création scientifique, et fait même perdre beaucoup de temps à ceux qui apprennent comme à ceux qui créent des savoirs. Par exemple, je peux vous assurer que dans les communautés scientifiques, ceux qui correspondent le mieux aux grilles d’évaluation des institutions académiques sont loin d’être les plus féconds scientifiquement! Ils font tourner très vite des machines conceptuelles inventées par d’autres qu’eux, sont proches des réseaux de publication (revues, éditeurs) et très dociles par rapport aux demandes de l’institution, mais sont fondamentalement des «casaniers», pour reprendre le terme du mathématicien Alexandre Grothendieck, qui les opposaient aux «bâtisseurs». Ils ne créent rien, alors que c’est normalement ce qu’on attend d’eux.

Vous critiquez aussi les programmes de classement (Pisa, Shanghai et autres). Que leur reprochez-vous?
Je leur reproche de ne servir à rien du point de vue des processus réels d’apprentissage et de recherche. Croyez-vous que ces classements ont un effet positif sur les élèves ou les chercheurs? En revanche, ils ont produit et continuent de produire des effets négatifs. Par exemple, les classements type Shanghai ont conduit les universités françaises à se rassembler au sein d’énormes entités. Beaucoup d’énergie et de temps précieux ont été perdus et continuent de se perdre dans ces opérations qui relèvent de la stratégie politico-militaire bien plus que d’une stratégie scientifique. Tous les regroupements (de laboratoires ou d’établissements d’enseignement supérieur) ont eu lieu à marche forcée. Ça n’a strictement aucun intérêt du point de vue de la dynamique scientifique. N’importe quel chercheur digne de ce nom vous le confirmera.
Vous référant au physicien Feynman et aux mathématiciens Grothendieck et Perelman, vous opposez la joie de découvrir aux honneurs. Faut-il repenser les prix académiques et la culture du palmarès? Par quoi les remplacer?
Faut-il absolument des prix ou des honneurs? Richard Feynman disait qu’une réussite scientifique se mesure à son niveau de fécondité. Le plaisir de découvrir et de constater que ses découvertes sont utiles à d’autres: voilà la véritable reconnaissance pour les savants. Donner beaucoup de reconnaissances à certains (le capital va au capital…), c’est en enlever à la grande majorité. Si on maintient des reconnaissances, il faudrait tout d’abord qu’elles ne s’accompagnent d’aucun privilège personnel (argent ou prime, par exemple) et qu’elles soient autant collectives qu’individuelles. Sauf exception, même les œuvres les plus individuelles n’ont été possibles que grâce à l’aide de nombreuses autres personnes, impliquées à des degrés différents dans le processus de découverte ou de résolution d’un problème. Ces personnes sont souvent remerciées dans les ouvrages (rarement dans les articles) mais jamais mises à l’honneur.
Vous semblez valoriser «l’esprit rétif» contre le conformisme académique. Comment protéger institutionnellement les «frondeurs» dans le monde scientifique et académique, sans pour autant dériver vers l’arbitraire?
Tout cela part d’un pur constat d’histoire ou de sociologie des sciences. Pour être un très bon chercheur, il faut savoir dire non, refuser les choses faciles ou stupides, résister aux injonctions institutionnelles qui détournent des objectifs de recherche, prendre le risque de suivre des chemins que tout le monde vous déconseille de prendre, ne pas se laisser impressionner par les traditions en place, les dogmatismes, les menaces ou les tentatives d’intimidation. Si vous êtes trop dociles et que vous obtempérez ou rentrez dans le rang à la moindre remarque, vous pourrez devenir dans le meilleur des cas un professionnel de bonne qualité, mais jamais un chercheur au sens plein du terme. Si les institutions n’ont pas l’intelligence de protéger les outsiders, les marginaux, les déplacés ou les décalés, alors elles se privent de forces de renouvellement considérables.
Vous montrez que la «libido sciendi» de l’enfant, cette pulsion de savoir, s’érode à l’entrée à l’école. Quelles pratiques pédagogiques concrètes préserveraient la curiosité au lieu de la tarir?
Des études très sérieuses montrent que l’école a tendance à réduire le nombre de questions que se posent les enfants. On sait qu’ils sont des êtres curieux par nature: ils explorent leur environnement dès qu’ils sont en mesure de le faire et prolongent leur désir de découvrir en posant des centaines de questions durant les premières années de leur vie. A l’école, la situation change: il faut nécessairement une discipline collective et cela tend à réduire la place de chacun dans le groupe. Mais quand vous ajoutez à cela la peur de l’évaluation et des mauvaises notes et les programmes surchargés qui forcent à survoler les choses, cela a tendance à placer les élèves en position plus passive qu’active. Je ne dis pas qu’il faut jeter les programmes à la poubelle, mais si on ne s’appuie pas sur la curiosité, le désir de savoir, la capacité d’émerveillement ou les questionnements des enfants, le processus d’apprentissage ne peut se mettre en place.
Vous montrez que la curiosité infantile est socialement inégalement entretenue. Quelles politiques ciblées réduiraient ces écarts de libido sciendi entre milieux sociaux?
Il faut des politiques compensatrices ambitieuses dans tous les domaines: donner plus, d’attention, de temps, de soutien, d’aide, à ceux qui ont le moins. C’est vrai dans tous les domaines qui favorisent les bonnes scolarités: jeux pédagogiques, pratiques langagières, accès aux livres, aide aux devoirs, pratiques culturelles, conseils aux parents, etc. Cela demanderait des effectifs de classe extrêmement réduits pour les élèves les plus en difficulté. Dans les grands groupes, chaque enfant a en définitive très peu d’interactions avec l’enseignant, et à cela s’ajoute le fait que les bons élèves ont tendance à monopoliser les prises de parole. Les enseignants s’appuient beaucoup sur eux pour faire avancer leur cours, au détriment de ceux qui sont moins rapides, plus dispersés ou plus mutiques.
Dans l’esprit de Marc Bloch, vous appelez à une «révolution de l’enseignement». Si l’on vous confiait le prochain «plan de rentrée», quelles réformes cardinales imposeriez-vous?
La première serait d’augmenter très fortement les moyens alloués à l’école (jusqu’à l’université) et à la recherche, avec une politique de recrutement massif d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de chercheurs. Le contraire des politiques mortifères actuelles qui sabrent dans ces secteurs vitaux. La seconde réforme serait de redonner du temps à tout le monde: temps d’apprentissage pour les élèves, temps d’enseignement pour les enseignants, temps de recherche pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs dont les charges pédagogiques et administratives n’ont cessé de s’alourdir. Cette deuxième priorité implique, côté enseignement, un sérieux allègement des programmes scolaires pour pouvoir consacrer plus de temps aux questions abordées et arrêter le bachotage permanent; et côté recherche, une augmentation significative de la masse des personnels d’accompagnement de la recherche et une baisse de la pression à publier qui pousse à multiplier les «petites contributions» au détriment des grandes questions de fond. La troisième réforme consisterait à remettre le système scolaire-universitaire sur ses pieds en arrêtant de faire de l’évaluation l’objectif numéro un: on évalue pour pouvoir classer, hiérarchiser, trier (et reléguer) les élèves et les établissements, alors que l’évaluation devrait être un simple moyen annexe pour s’assurer que les apprentissages se sont bien passés. Tout le système actuel est piloté par l’évaluation, et l’apprentissage est organisé en vue de satisfaire aux exigences des évaluations. On marche sur la tête.
A l’heure des IA génératives, comment faire de celles-ci un levier salutaire dans la recherche et le monde académique?
Ce sont des instruments formidables qui peuvent, si on sait correctement s’en servir, accompagner les processus de création scientifique en permettant aux chercheurs de se concentrer sur des choses que ne savent pas faire les IA. Les grandes révolutions culturelles ont jusque-là beaucoup concerné des questions d’externalisation, d’accumulation-stockage-stabilisation des savoirs (l’écriture, l’imprimerie ou le stockage des savoirs sur des disques durs). Mais depuis l’existence de logiciels de traitements de données qualitatives ou quantitatives, ce sont des opérations cognitives sur des données qui peuvent être réalisées par les ordinateurs. L’IA générative constitue une avancée majeure en matière de mise en lien de savoirs très différents et de mise en discours de ces mises en lien. Dans l’état actuel, il faut se méfier par exemple des fausses citations fournies par l’IA, mais celle-ci peut être un moyen de tester des intuitions, de suivre certaines pistes (toujours à vérifier) qui demanderaient des heures ou des jours de travail. Pourquoi se priver de cela? Evidemment, si on se contente de demander à l’IA de pondre un texte, le résultat est, au mieux d’apparence correcte mais sans grand intérêt, au pire une sorte de rhétorique totalement dépourvue de fond. Il va donc falloir dompter ces IA, et apprendre aux élèves à s’en servir dans leur parcours d’apprentissage.
«Si les institutions n’ont pas l’intelligence de protéger les outsiders, alors elles se privent de forces de renouvellement considérables.»
Peut-on établir un lien entre la crise écologique majeure et l’affaiblissement de la création scientifique?
Il y a un lien dans le sens où tout coup porté à la connaissance scientifique, comme cherche à le faire Donald Trump aux Etats-Unis ou comme le font plus silencieusement tous les pays qui diminuent les budgets de la recherche, est un affaiblissement de nos moyens de défense et de survie. C’est par l’intelligence scientifique des écosystèmes, des phénomènes climatiques, des virus et des effets délétères de l’utilisation de certains pesticides, de polluants, de plastiques ou des énergies fossiles que nous parviendrons à inventer des modes de production et de consommation moins dangereux pour notre santé, pour la biodiversité, et du point de vue des conditions climatiques. Cela implique toutes les sciences: des sciences de la matière et de la vie aux sciences sociales.
Enfin, si un étudiant ou élève vous demandait «à quoi sert-il d’apprendre?», que lui répondriez-vous pour lui faire sentir que savoir ou périr n’est pas une métaphore mais une condition de notre avenir commun?
Je lui expliquerai qu’à l’échelle individuelle, il est toujours préférable pour mener sa barque le mieux possible de ne pas être ignorant dans de nombreux domaines. Prendre conscience de l’importance des effets de ce que l’on boit ou de ce que l’on mange, de ce que l’on consomme dans tous les domaines, de l’incidence de ses modes de transport, comprendre le fonctionnement du monde social, garder son esprit critique par rapport aux fausses informations qui circulent et aux idéologies politiques qui prospèrent sur des mensonges, être suffisamment armé culturellement pour s’approprier des informations médicales, juridiques, techniques, c’est devenir non seulement un citoyen éclairé mais une personne qui augmente son espérance de vie.
Si l’on élargit du plan individuel à l’échelle collective: qu’apporte l’élévation du niveau de connaissances à la survie des sociétés?
Plus le niveau général de connaissance augmente, plus cela nous donne une chance collective de trouver des solutions à des problèmes qui engagent la survie de nos sociétés, et, dans certains cas, de notre espèce. Car les innovations reposent souvent sur de très nombreux acteurs, et pas que sur des individus «géniaux» ou «inventifs». Par exemple, le biomimétisme qui se développe aujourd’hui essaie de trouver dans la nature des mécanismes ou des processus qui sont à la fois efficaces, durables et faiblement destructeurs des écosystèmes. Or, il suppose souvent la collaboration de praticiens (comme des cultivateurs ou des éleveurs), d’ingénieurs, de biologistes, d’éthologues ou d’écologues, de chimistes, de physiciens et de chercheurs en sciences sociales.
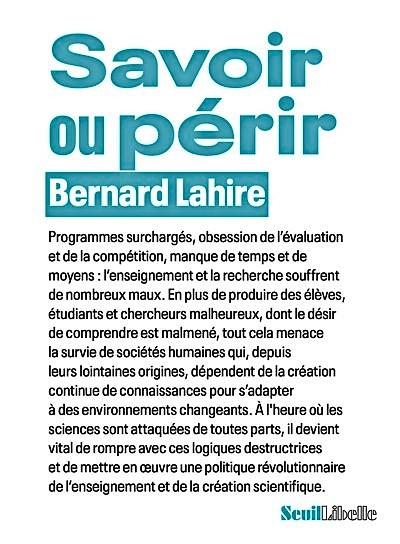
Bio express
1963
Naissance, à Lyon.
1990
Soutient sa thèse en sociologie.
1994
Professeur de sociologie à l’université Lumière Lyon 2.
2000
Professeur de sociologie à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
2003-2010
Directeur du Groupe de recherche sur la socialisation.
2011-2018
Directeur-adjoint du Centre Max Weber.
2020
Directeur de recherche au CNRS.
