L’auteur suisse, devenu star en 2012 avec La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, évoque son dernier roman, une Enigme, tirée à près d’un demi-million d’exemplaires. Le sommet d’une vague de thrillers à la lecture facile qui divisent les critiques mais affolent les compteurs. Sa conception de l’écrivain de fiction ? » Etre loin de la réalité, car elle tue l’imaginaire. »
» La vie est un roman dont on sait déjà comment il se termine : à la fin, le héros meurt. » L’élégant, chaleureux et étonnamment accessible Joël Dicker, alias » l’auteur-francophone-le-plus-vendu-dans-le-monde « , – titre que le Suisse de 35 ans partage, au gré de leurs sorties, avec Guillaume Musso ou Marc Lévy – ne nous en voudra pas de dévoiler ainsi une des dernières lignes de son cinquième roman. Si elle ne dit rien sur la résolution de l’intrigue, devenue l’enjeu essentiel, voire unique, de la plupart des thrillers, elle en dit sans doute long sur sa prose, brillamment simple ou tristement plate selon les points de vue.
Elle convainc en tout cas aujourd’hui des millions de lecteurs dans presque autant de langues, mais divise comme jamais les critiques qui doivent s’en emparer, et émettre un avis – de l’art ou du cochon ? Cette Enigme de la chambre 622 (1) ne déroge pas à la règle qui le poursuit depuis La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, paru il y a huit ans : Joël Dicker est autant attendu par ses lecteurs, qu’il est attendu, mais au tournant, par ses détracteurs. Un malentendu entre les tenants du verbe et les adeptes de la structure, deux courants de la littérature rarement conciliés et conciliables. » L’Ecrivain « , comme il se désigne lui-même, avec la majuscule, dans sa dernière Enigme, tente quant à lui de ne pas s’en formaliser même » si chaque critique est un crève-coeur « . Il en parle avec une étonnante franchise : » J’essaye d’être assez insensible ; quand on a un lectorat aussi large que le mien, la critique est inévitable et ne me pose pas de problème en soi. Mais j’ai bien conscience que la littérature francophone, surtout en France, et surtout à Paris, a un problème avec le succès. Chez les Anglo-Saxons, on le salue, alors qu’ici, on lui coupe la tête. Mais ça ne me rend pas triste, c’est même plutôt un beau problème ! C’est surtout dommage pour elle. »
Ce qu’on appelle cliché, ce n’est qu’une image commune qui permet d’identifier rapidement ce dont on parle.
» C’est le lecteur qui décide »
L’Enigme de la chambre 622, donc. Soit une chambre qui n’existe pas, au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses, là où l’Ecrivain, en pleine peine de coeur, vient se réfugier pour s’aérer l’esprit et faire le deuil de son mentor, le véritable Bernard de Fallois, décédé en 2018. » Il était l’homme à qui je devais tout. Mon succès et ma notoriété, c’était grâce à lui. On m’appelait l’Ecrivain, grâce à lui. On me lisait, grâce à lui. […] Il était une inspiration pour la vie, une étoile dans la nuit. » Mais une jolie dame apparaît et interpelle le jeune et bel écrivain : pourquoi n’y a-t-il pas de chambre 622 ? Ou plutôt, pourquoi le Palace de Verbier tente-t-il d’oublier le meurtre qui s’y est produit des années auparavant ? Démarrent alors deux mystérieuses intrigues : l’une se déroulant avant le meurtre et mettant en scène de possibles criminels en col blanc, lancés dans une course rocambolesque à la présidence d’une grande banque privée genevoise ; l’autre revenant aux temps présents, et aux découvertes de notre duo, entre deux considérations sur l’écriture d’un roman : qui a tué qui, et comment, dans la chambre 622 ? Un indice : ce n’est pas le Colonel Moutarde avec le chandelier, et même si dans le principe et surtout la mécanique, cette Enigme tient effectivement plus du jeu de Cluedo que du concours de prose originale. Chez Dicker, le thriller old school et inoffensif, devenu easy reading, ne se prive jamais d’un bon lieu commun : les silences sont » gênants « , les ambiances » tamisées « , les paysages » somptueux » et les salons » feutrés « . Mais Joël l’auteur assume.
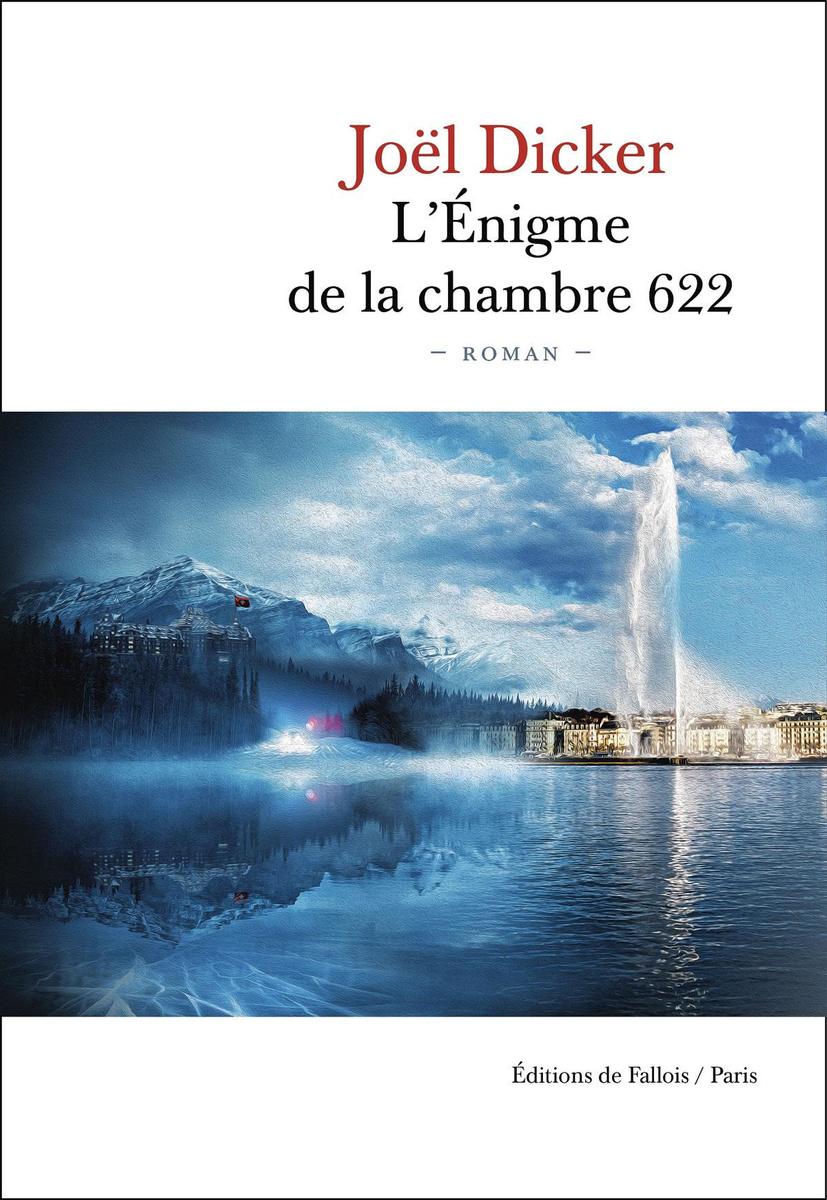
» Mon but, c’est bien évidemment d’être lu, et si possible apprécié, par le plus grand nombre. Et ce qu’on appelle cliché, ce n’est qu’une image commune qui permet d’identifier rapidement ce dont on parle « , explique-t-il. » Ma conception de l’écrivain de fiction, et je comprends qu’on ne la partage pas, c’est qu’il doit être loin de la réalité. Je fais très peu de recherches, j’en ai un peu peur, car la réalité tue l’imaginaire. J’ai écrit pendant des années avant d’être considéré, j’ai dû longtemps lutter avant d’être publié : étais-je moins écrivain que je ne le suis aujourd’hui ? J’ai longtemps souffert de ce manque de légitimité, puis le succès m’a permis de me trouver une identité, de m’affirmer comme écrivain. Et c’est ma conviction, que je répète souvent, y compris dans mes livres : c’est aux lecteurs que revient le pouvoir. C’est toujours lui qui décide. Et les attentes d’un lecteur, c’est parfois difficile à combler. Ce qui serait dangereux pour moi, c’est de changer ma façon d’écrire, sous cette pression. » Et de conclure : » Je n’ai pas de problème avec la critique, sauf quand on attaque la personne. Quand on s’en prend à moi plutôt qu’à mes livres, c’est très différent. » Une allusion même pas voilée à un récent article désobligeant du quotidien Le Monde, lequel décortiquait la manière dont ce sont justement les réseaux de son mentor et éditeur, Bernard de Fallois, qui ont fait le succès, il y a huit ans, de son Harry Quebert sorti de nulle part. Créant ainsi le malentendu, et le malaise encore impardonné aujourd’hui : un grand succès populaire, volontairement » accessible « , était pour la première fois couvert de récompenses, élu Grand Prix du roman de l’Académie française et même nommé pour le Goncourt et le Renaudot ! Une gifle pour les tenants d’une littérature très française, qui tient le Verbe en haute estime. Alors que dans le thriller, et les romans de Dicker, le truc qui compte, c’est la structure.
Un mystère qui se construit au fil du récit et dont la dernière brique n’arrive qu’avec la dernière page.
L’image, puis le texte
La réussite et l’intérêt de L’Enigme de la chambre 622 est en effet moins syntaxique que narrative. A la manière de beaucoup d’auteurs anglo-saxons et d’une génération d’écrivains nourrie au moins autant en images qu’en textes ( lire l’encadré), le romanesque très cinématographique de Dicker s’exprime avant tout dans la mécanique de ses récits : à plusieurs niveaux de temporalité, différents narrateurs et points de vue sur l’histoire, des jeux de mise en abyme mêlant réalité, fantasme de lecteur, considération d’auteur et pure fiction… On retrouve ici tout ce qui fit le succès de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, et qui se voulait déjà un hommage appuyé » aux grands romans américains « . Peu importe que les dialogues soient ceux d’un dimanche midi en famille ou que les personnages semblent aussi crédibles que des militants de Gaia se lançant dans le commerce de la viande : toute l’énergie de » l’Ecrivain » et beaucoup de son talent sont mis au service d’un mystère, qui se construit au fil du récit et dont la dernière brique n’arrive qu’avec la dernière page. Une vision de l’écriture, et surtout du thriller, tournée vers le divertissement, l’efficacité et un page turning dont le rythme ne doit pas être perturbé par un vocabulaire trop compliqué ou une conjugaison trop rare. Une méthode qui, elle aussi, explique beaucoup de son formidable succès populaire. Et une formule derrière laquelle tous les éditeurs courent désormais, même en se pinçant le nez (en privé).
(1) L’Enigme de la chambre 622, par Joël Dicker, éd. de Fallois, 574 p.
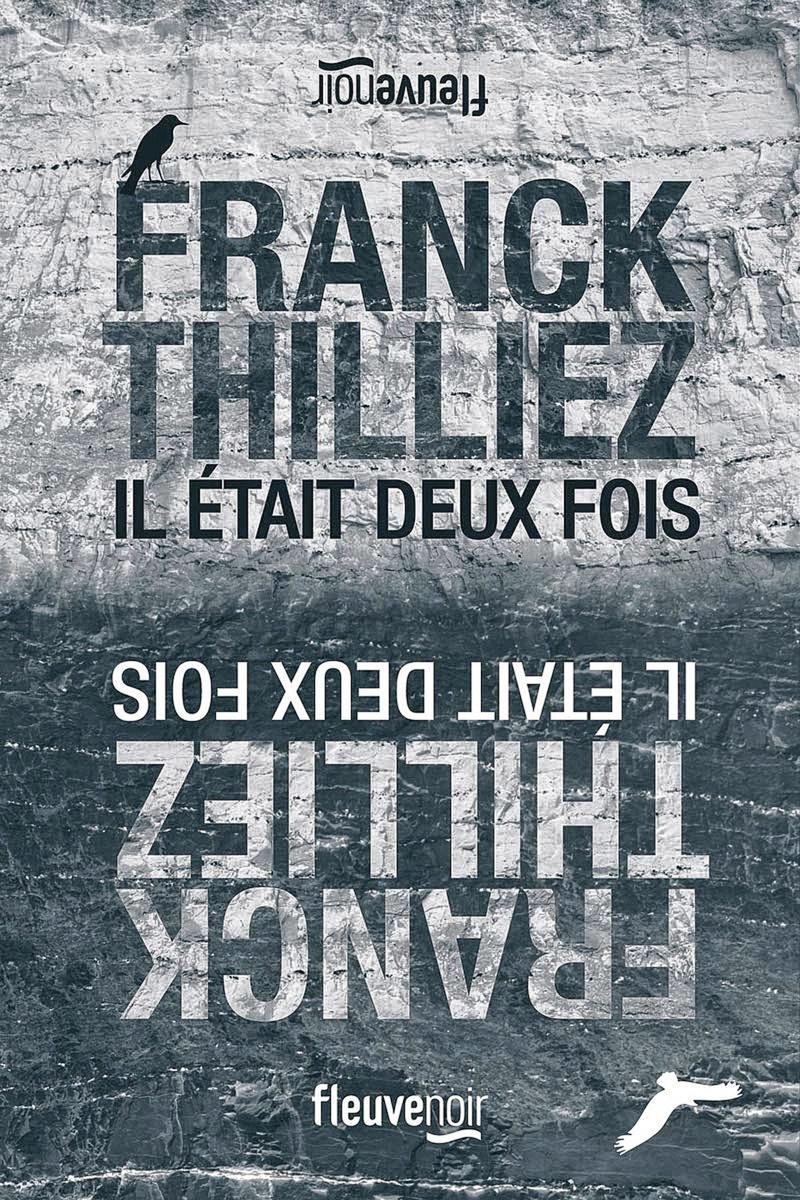
Thrillers de l’été : les cinq prétendants
Il était deux fois
par Franck Thilliez, Fleuve Noir.
Comptant parmi les dix auteurs les plus lus de France, Franck Thilliez mise cette fois sur une amnésie psychogène atypique pour accrocher ses lecteurs : en 2008, un lieutenant de gendarmerie, en pleine enquête sur la disparition de sa propre fille, s’endort… et se réveille douze ans plus tard, ayant tout oublié des douze dernières années.
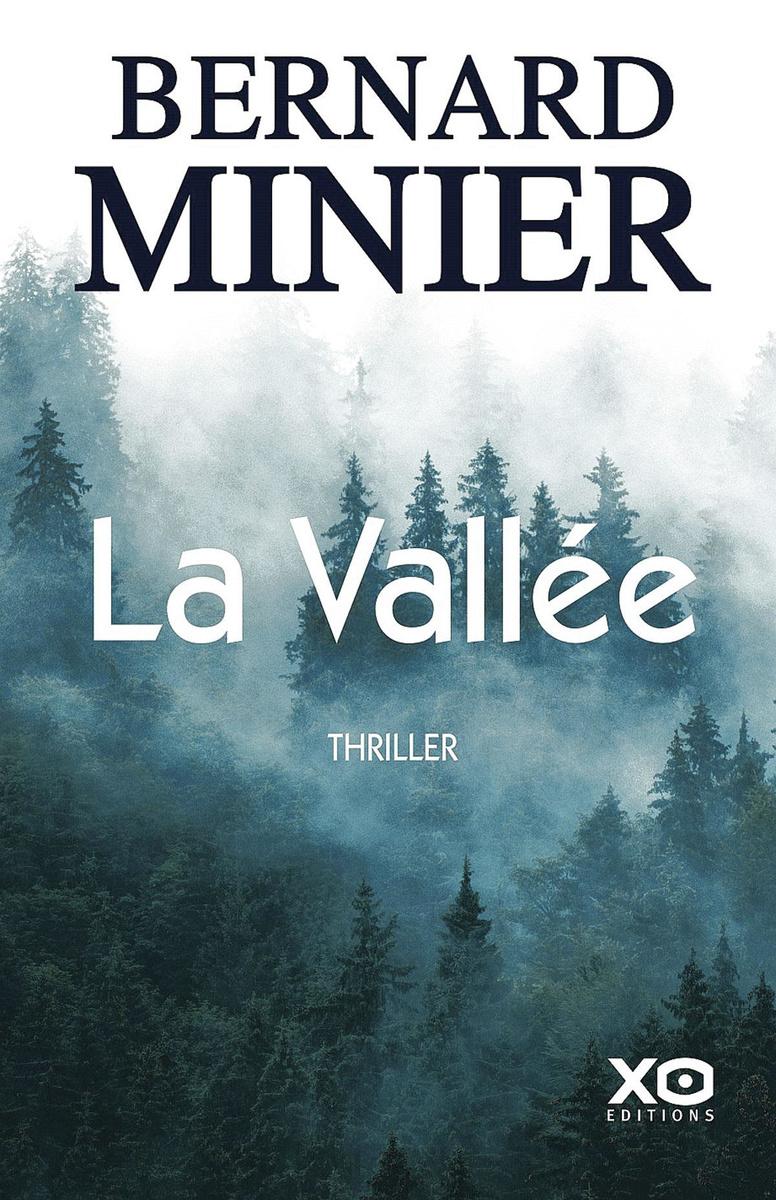
La Vallée
par Bernard Minier, XO Editions.
Le huitième thriller de Bernard Minier, dont la notoriété est internationale, est aussi le sixième à mettre en scène son enquêteur Martin Servaz. Un appel au secours au milieu de la nuit, une vallée coupée du monde, une abbaye pleine de secrets, une forêt mystérieuse, une série de meurtres épouvantables… Tout est prêt pour écouler rapidement les 130 000 premiers exemplaires de cette Vallée infernale.
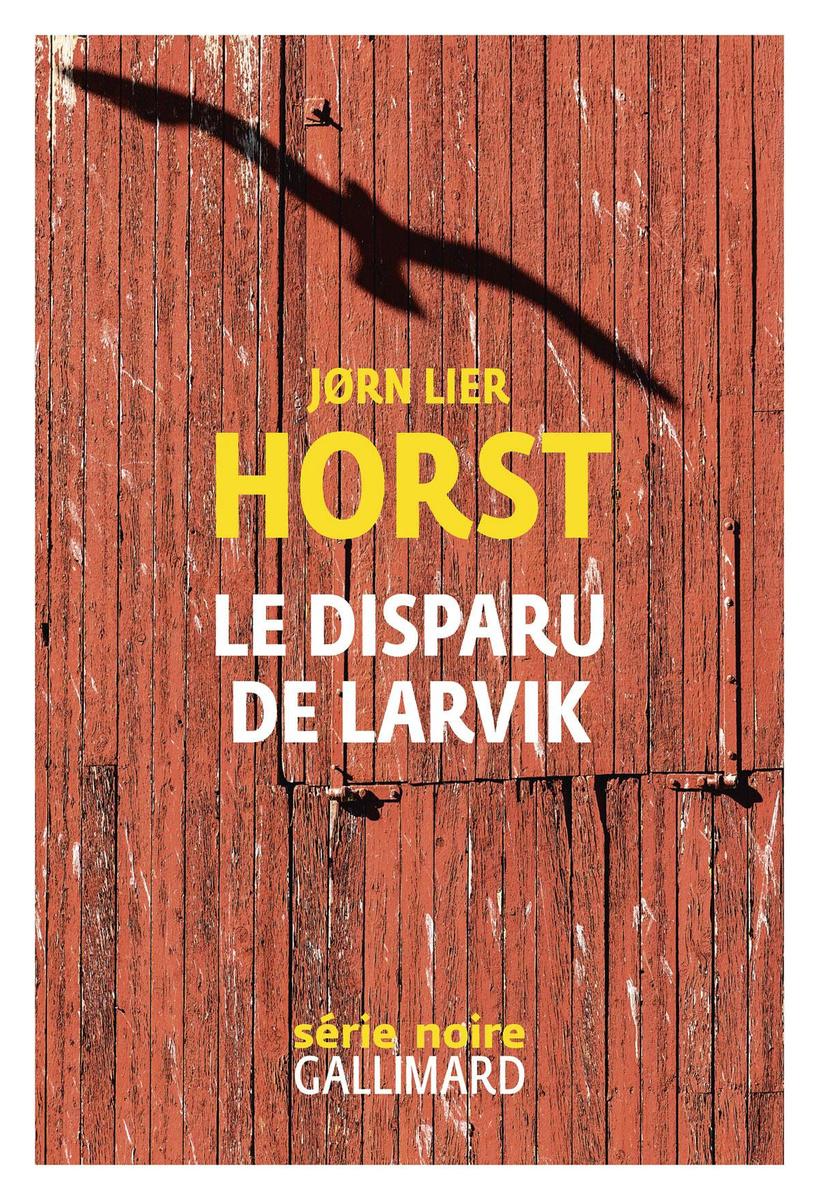
Le disparu de Larvik
par Jorn Lier Horst, Série Noire.
Le polar scandinave tient parfois du » simple » thriller, lui aussi à gros succès : ainsi les livres de Jorn Lier Horst, ex-inspecteur norvégien, plus à l’aise avec les procédures policières qu’avec les envolées syntaxiques, qui ont fait de lui le deuxième auteur le plus vendu de Norvège. La Série Noire aimerait bien faire de même en France, avec ce quatrième tome des enquêtes de William Wisting, au potentiel très bankable.
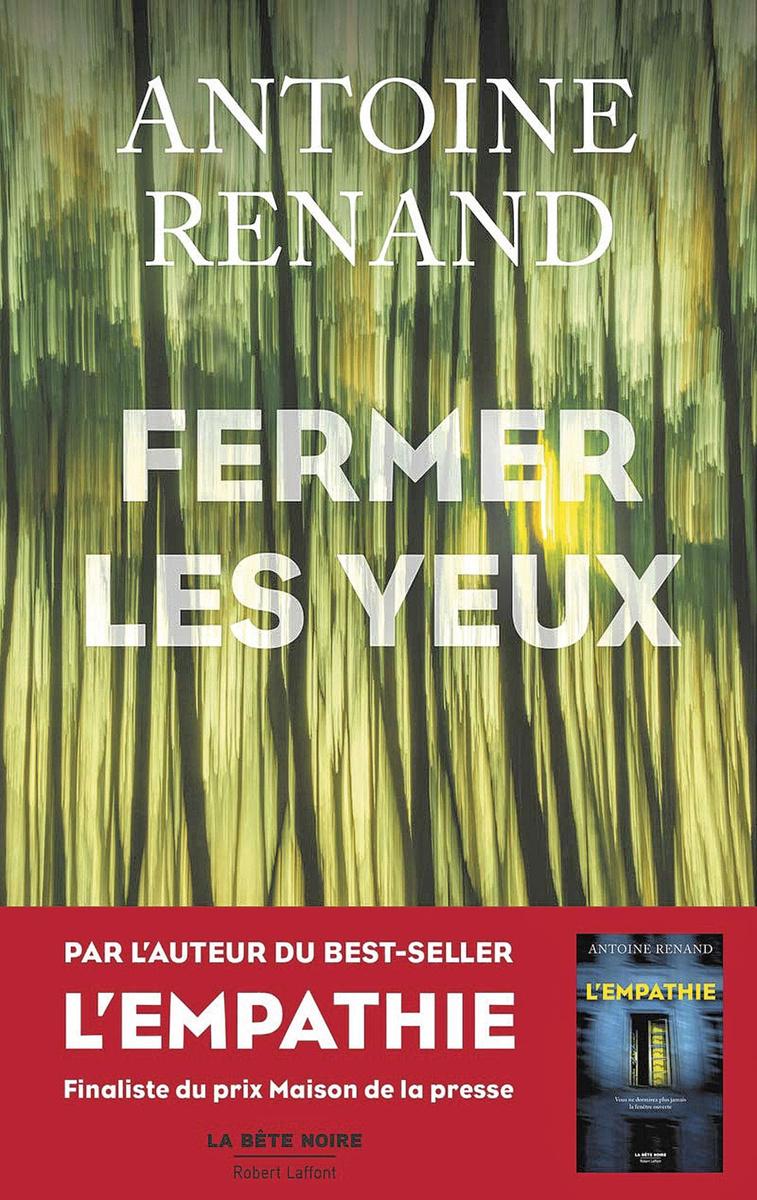
Fermer les yeux
par Antoine Renand, La Bête Noire.
Le deuxième opus d’Antoine Renand, après L’Empathie, ne peut pas encore afficher ses chiffres de vente sur son CV, mais c’est sans doute une question de temps : on trouve ici un enquêteur à la retraite, une grosse erreur commise quinze ans plus tôt et un jeune écrivain spécialiste des tueurs en série… Le tout brossé en 420 pages qui se laissent dévorer. Prometteur !
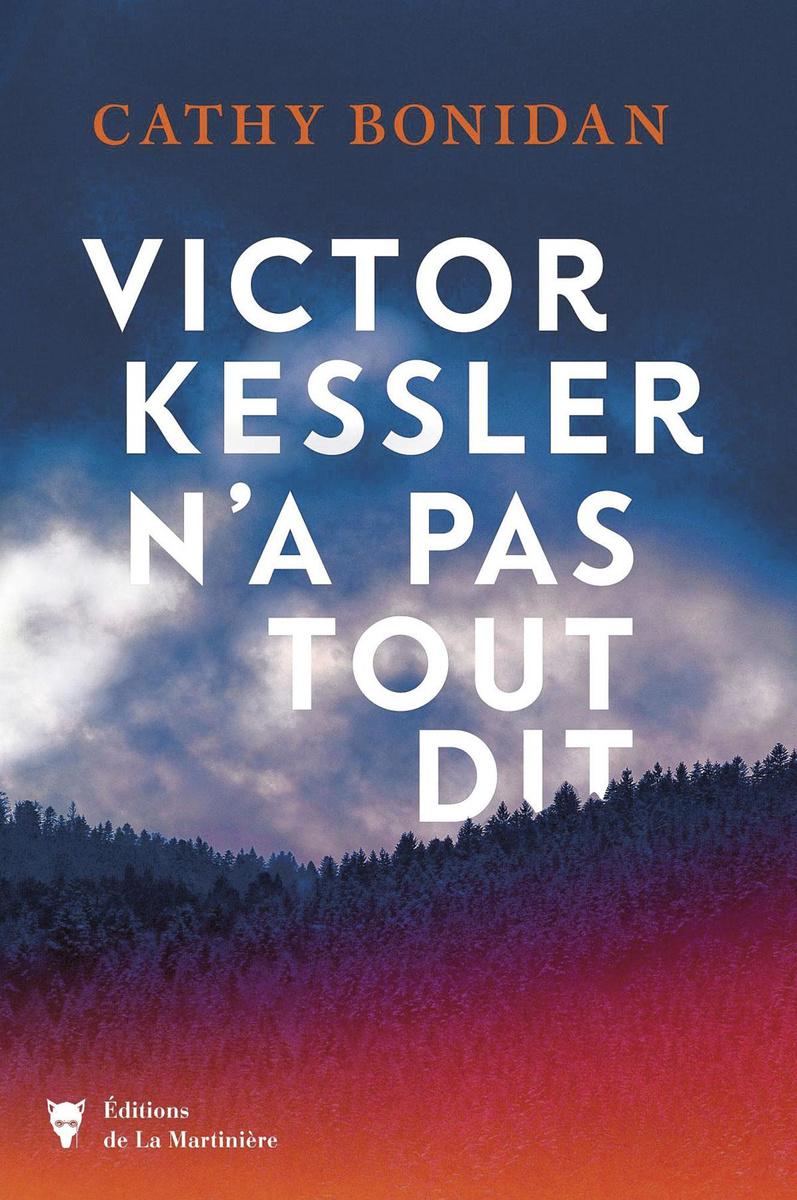
Victor Kessler n’a pas tout dit
par Cathy Bonidan, La Martinière.
Le troisième roman de cette institutrice de Vannes, dans l’ouest de la France, sera-t-il celui qui la fera décoller ? Sa jeune héroïne retrouve ici, par hasard, la confession d’un homme accusé d’infanticide 45 ans plus tôt. De quoi réveiller ses propres démons, enfouis dans les forêts vosgiennes…Un thriller » dans la veine de Guillaume Musso, Joël Dicker ou Michel Bussi « . Tout est dit.
