Non contents de dénoncer les injustices à travers leurs créations, certains artistes font preuve d’un engagement souvent noble, mais dont les conséquences sont irrémédiables.
Pour Aamron, c’en était devenu trop. D’abord le manque d’infrastructures hospitalières, puis le coût exorbitant de la vie, marqué par cette récente augmentation du prix de l’électricité. Mais c’est surtout le dernier changement constitutionnel actant la transformation du régime présidentiel en parlementaire que le rappeur togolais n’a pas digéré. Début mai, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après les 38 ans de règne de son père Eyadéma, est ainsi devenu président du Conseil des ministres, nouvelle plus haute fonction du pouvoir exécutif, renouvelable sans limitation de mandat. Dépité, Aamron a voulu que la contestation des fonctionnaires, des enseignants et d’une partie des 47% de la population vivant en situation de pauvreté soit entendue. Dans un Togo qui traîne la réputation peu enviable de pays où les gens manifestent rarement, principalement à cause des nombreuses interdictions imposées par les autorités et la répression «brutale des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique», selon Amnesty International, le musicien s’est donc exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il a commencé par «inviter» Gnassingbé à quitter la scène politique. Puis il a diffusé un appel à manifester le 6 juin pour offrir un «cadeau spécial» au président le jour de son anniversaire. Le soir même, il a été interpellé, puis incarcéré dans un hôpital psychiatrique.
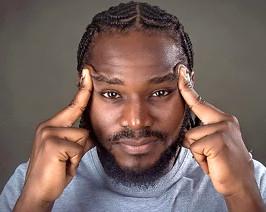
Cette arrestation a certainement achevé de convaincre des dizaines de jeunes de descendre dans la rue le 6 juin pour crier leur mécontentement. Beaucoup ont été accueillis par les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre, celles-ci procédant à une cinquantaine d’interpellations. Dans la foulée, Amnesty a réclamé l’ouverture d’une enquête sur des cas présumés de torture de manifestants. Pas de quoi les démobiliser puisqu’ils ont repris la protestation le week-end du 26 juin… et ont fait face au même type de répression. Les organisations de défense des droits humains parlent d’«exactions commises par des éléments des forces de l’ordre et des miliciens», et dénoncent la mort de sept manifestants. Aamron, quant à lui, a été libéré le 21 juin, peu après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il présentait ses excuses au président et se disait atteint de dépression aggravée. Un message probablement enregistré sous la contrainte puisque le rappeur a, depuis lors, repris ses dénonciations. «Je me suis lancé dans cette opération en mode kamikaze», confiait-il à France 24 début juillet. «J’ai voulu m’inscrire en sacrifice pour créer un électrochoc, un déclic, pour libérer la parole.» Depuis, un «Mouvement du 6 juin» a été lancé et l’opposition estime que le Togo se trouve aux prémices d’une vague d’exaspération plus large. Aamron se dit prêt à garder la bouche grande ouverte. «S’il faut enclencher des procédures judiciaires, je vais le faire pour que ceux qui ont été par ma faute torturés puissent avoir aussi gain de cause.»
Le rappeur le plus courageux
Style musical identique, valeurs similaires, mais détention différente pour Toomaj Salehi, qui s’est retrouvé plus de deux ans derrière les barreaux iraniens. Ce rappeur de 34 ans a toujours articulé son œuvre autour de la dénonciation des inégalités et atteintes aux droits de l’homme dans la république islamique. «Un Iran libre est un pays où les agents du régime ne sont pas autorisés à commettre un viol ou à jeter de l’acide au visage d’une femme», a-t-il un jour déclaré à CNBC. En 2022, peu après avoir écrit Buy a Rat Hole and Hide in It, une chanson dans laquelle il condamne la répression, l’injustice et la pauvreté, Salehi participe aux manifestations qui éclatent à la suite de la mort de l’étudiante d’origine kurde Mahsa Amini, coupable d’avoir mal porté son voile. Dans un nouveau clip, Battlefield, celui que le New York Times qualifie de «rappeur le plus courageux du monde» diffuse dans la foulée des images de ces contestations en osant: «Il est temps de dépasser nos peurs et d’affronter notre ennemi.» Cet automne-là, plus de 500 Iraniens sont tués en marge des protestations et près de 20.000 autres sont arrêtés. Toomaj Salehi en fait partie. Sa condamnation à six ans de prison suscite immédiatement l’émoi parmi ses trois millions de followers sur Instagram et une pétition appelant à sa libération récolte plus de 200.000 signatures. Lorsqu’il est relâché sous caution pratiquement un an plus tard, l’artiste reprend directement la parole sur les réseaux sociaux. Il dénonce ses conditions de détention, son placement en cellule d’isolement, les tortures. Sans surprise, il est renvoyé à l’ombre dix jours plus tard. Pire: il est même un temps condamné à mort pour «corruption sur Terre», l’un des pires chefs d’accusation en Iran, avant que la Cour suprême commue sa peine en emprisonnement pour «propagande contre l’Etat.»
«C’est aux poètes et aux artistes qu’il incombe de faire la révolution. La politique est un métier que nous laissons à d’autres.»
Le contexte à Gaza puis la guerre des Douze jours qui l’a opposé à Israël ont récemment amené le pouvoir iranien à alourdir la répression et à multiplier les arrestations de toute personne qui serait considérée comme opposante ou espionne à la solde de pays «hostiles». Une loi approuvée en juin dernier criminalise désormais toute une série d’activités pacifiques, la publication de messages contestataires sur les réseaux sociaux peut ainsi être massivement sanctionnée. Depuis sa sortie de prison le 1er décembre 2024, Toomaj Salehi se fait plus discret sur le Net. «La très grande majorité des artistes n’a pas pour ambition d’endosser un rôle politique. C’est parce que certains sont terriblement engagés qu’ils deviennent des leaders d’opinion, explique Bernard Foccroulle, ancien directeur du Théâtre de La Monnaie et fondateur de l’association Culture & Démocratie. Si la figure est trop populaire, cela peut faire reculer le pouvoir… ou au contraire l’inciter à s’en débarrasser, comme la junte militaire chilienne l’a fait en coupant les doigts puis en assassinant le chanteur Victor Jara dans les années 1970.» Cela donne à réfléchir, mais cela prouve, selon Laurent Kennes, avocat spécialiste des droits de l’homme, que «les régimes totalitaires sont très conscients du danger que représente une personne à forte popularité comme un artiste. La renommée est fédératrice, elle permet de consacrer une contestation latente.»
Le poète armé
Généralement doté d’un leadership plus émotionnel et spontané, l’artiste qui se transforme en chef d’opinion a l’avantage d’avoir le soutien initial d’une population convaincue par ses talents, de communiquer via des réseaux sociaux non censurés et de pouvoir sensibiliser et mobiliser à l’international. «Une chanson écoutée par 100.000 fans est tout de suite plus percutante qu’un long discours, glisse Laurent Kennes. La force du message dépend toutefois de l’art et de la société dans laquelle il s’inscrit.» Maung Saungkha en sait quelque chose. Dans sa Birmanie natale, les poètes sont vénérés depuis le XIe siècle quand les rois galvanisaient leurs troupes grâce à des troubadours. Plus tard, lors de l’occupation britannique, un mouvement anticolonial entier s’est articulé autour de poètes. Saungkha, quant à lui, a écrit ses premiers vers dans son enfance avant, adulte, de créer l’Association des amateurs de poésie. Avec son style cru, il s’est toujours mouillé pour défendre le peuple rohingya persécuté ou critiquer l’ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi. Cela lui a valu deux séjours en prison: un pour son écrit associant l’ancien président Thein Sein à sa propre verge, l’autre pour ses dénonciations des coupures d’Internet «visant à cacher des crimes de guerre et des meurtres», dira-t-il au New York Times.
«Les régimes totalitaires sont très conscients du danger que représente une personne à forte popularité comme un artiste. La renommée est fédératrice, elle permet de consacrer une contestation latente.»
En 2021, lorsque l’armée birmane reprend le pouvoir de force à Aung San Suu Kyi, imposant la répression et repoussant constamment l’organisation d’élections libres, Saunghka se fond logiquement dans la masse de milliers de manifestants qui défilent dans la capitale Rangoon. Il y apprend à fabriquer des cocktails Molotov, mais il a le sentiment que cela ne suffit pas. Alors il fuit dans l’Etat Karen, où il se forme au métier de militaire puis monte une milice de gamins certes inexpérimentés, mais accompagnés par des rebelles aguerris. Aujourd’hui, le poète de 32 ans codirige l’Armée de libération du peuple bamar, constituée d’environ 2.000 hommes. Leur emblème? Un paon dansant. «Les mots sont des armes puissantes, assurait-il au New York Times en 2024. «Mais face aux militaires, nous avons besoin de vraies armes parce qu’ils ne se battent pas loyalement.» Ils seraient au moins trois poètes à diriger des forces rebelles en Birmanie. Un statut dangereux, mais plus enviable que celui de la poignée d’auteurs tués par la junte depuis le putsch. Saungkha défend l’idée que la Birmanie ne réussira une éventuelle transition démocratique qu’en assurant l’égalité totale entre les groupes ethniques. Rien ne dit toutefois qu’il fera partie du processus. «C’est aux poètes et aux artistes qu’il incombe de faire la révolution. La politique est un métier que nous laissons à d’autres.»
Casser la voix
Les artistes doivent-ils assumer une responsabilité vu leur statut pour la jeune génération? C’est en tout cas l’avis de Denise Ho, chanteuse canado-hongkongaise de c-pop, qui disait en 2016 au quotidien suisse Le Temps essayer de «faire ce qui est juste». Elle ne l’a pas fait à moitié. Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, l’île de Hong Kong est régulièrement secouée par des tentatives d’ingérences de la part de Pékin. En 2014, c’est en voulant limiter la portée du suffrage universel. Cinq ans plus tard, c’est en soutenant un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. A chaque fois, l’artiste prend part aux protestations. Activement. Elle se retrouve en tête de cortège ou donne des mini-concerts gratuits où elle interprète notamment Raise the Umbrellas, un titre écrit en référence au Mouvement des parapluies, utilisés pour se protéger du gaz lacrymogène. A chaque fois aussi, Denise Ho est arrêtée. Pas longtemps, mais les répercussions de son engagement sont pérennes. Depuis 2014, elle est interdite de concert en Chine où sa musique est également proscrite. Un coup dur pour celle qui s’était fait remarquer en 1996 en remportant le New talent singing award, la Star Academy hongkongaise, avant d’être prise sous l’aile de l’icône Anita Mui puis de devenir HOCC, star de la cantopop.

Qu’importe. Denise Ho a trouvé sa voie. Elle veut porter la voix de ceux qui réclament plus de démocratie pour la Région administrative spéciale. «Je crois que ma célébrité, et le fait que les gens me reconnaissent, surtout la police, peut aider à protéger le peuple pendant les manifestations», dit au Sydney Morning Herald celle qui ira jusqu’à plaider la cause des Hongkongais devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. En vain. En 2020, Pékin impose sa loi de sécurité nationale qui vise à «empêcher la sécession, la subversion, le terrorisme et l’ingérence étrangère à Hong Kong.» C’est le début d’une nouvelle ère de répression et d’arrestation de figures de l’opposition. En décembre 2021, la chanteuse est interpellée pour la troisième fois et jugée quelques mois plus tard pour «conspiration en vue de publication séditieuse». Avec quelques autres militants, elle est finalement condamnée à une amende de 4.000 dollars de Hong Kong, officiellement parce que les coadministrateurs du Fonds 612 –dont elle faisait partie et qui a soutenu financièrement des manifestants arrêtés en 2019– n’auraient pas enregistré leurs fonds en tant qu’association. Bernard Foccroulle: «Même si les artistes ne sont pas forcément tous des saints –l’écrivain Peter Handke n’a cessé de soutenir Slobodan Milošević tandis que le chef d’orchestre Valery Gergiev porte allégeance à Vladimir Poutine–, ils offrent des images du monde, des tensions qui le traversent dont il est primordial de prendre connaissance.» Même si elle s’est faite plus discrète sur le plan politique ces derniers temps, Denise Ho est retournée dans son studio d’enregistrement en décembre dernier. Parce qu’elle connaît mieux que quiconque l’importance de la culture dans des situations d’oppression, de résistance et de guerre.
Lire aussi | A Hong Kong, la répression s’intensifie
