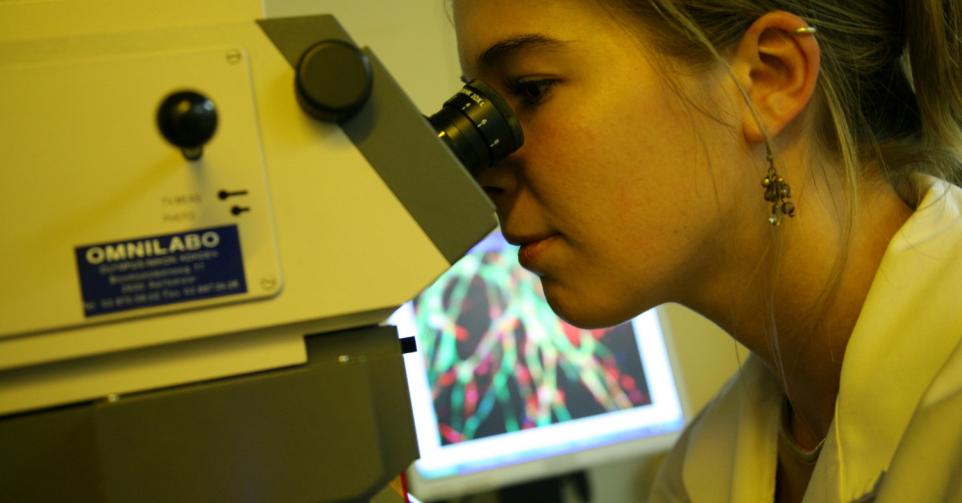L’Etat belge consacre quelque 4% de son PIB à soutenir les entreprises. Objectif: réduire la charge fiscale sur le travail. Rien n’atteste toutefois que ces aides soient efficaces.
Quelque 4% du produit intérieur brut, soit environ 25,1 milliards d’euros: voilà ce que pesaient l’ensemble des aides financières octroyées aux entreprises en Belgique, subventions et coups de pouce à l’investissement mêlés, l’an dernier. Dans les pays de la zone euro, ce soutien financier ne représente en moyenne que 2,3%.
Le calcul n’est pas le fait de farfelus. C’est la Banque nationale de Belgique (BNB) elle-même qui s’est fendue de cette analyse détaillée. Celle-ci tombe à pic – ou fait l’effet d’une douche froide, c’est selon – alors que le gouvernement fédéral cherche, en vain jusqu’ici, des milliards d’euros à économiser dans le cadre du budget 2026.
Observé de plus près, l’écart avec les pays voisins se remarque particulièrement dans le volet des subventions salariales: en Belgique, elles représentent 3,6 % du PIB du pays, soit environ 22 milliards d’euros, alors qu’elles ne pèsent que 1,5% en moyenne dans la zone euro. En 2000, pourtant, la Belgique affichait sensiblement le même résultat que ses voisins, soit 1,6% de son PIB. Depuis lors, cet écart n’a cessé de grandir, en grande partie en raison de l’augmentation des subventions salariales.
«Ces subventions salariales permettent d’alléger la charge fiscale sur le travail», précise la BNB. Une charge qui, en Belgique, est plus élevée qu’ailleurs. En accordant des subventions salariales aux entreprises, l’Etat fédéral et les régions cherchent notamment à renforcer la compétitivité et à favoriser la mise à l’emploi de groupes vulnérables. Ainsi par exemple, les entreprises sont partiellement dispensées de versement du précompte professionnel pour leurs salariés affectés à du travail de nuit et en équipe. Une aide fédérale est également proposée pour une première embauche ainsi qu’aux entreprises de titres-services, au niveau régional.
«Lorsque ces subventions salariales sont prises en compte, la Belgique affiche une pression fiscale nette sur le travail inférieure à celle de la France (39%) et comparable à celle de l’Allemagne (36%)», constate la BNB. Par rapport aux Pays-Bas (30%), le troisième pays de référence pour vérifier si les salaires belges sont compétitifs par rapport à ceux qui sont appliqués chez nos voisins, la Belgique affiche en revanche un moins bon score. Or le soutien de l’Etat aux entreprises vise à éviter que celles-ci ne plient bagages et ne filent s’installer dans un pays où payer un travailleur leur coûtera moins cher, en vertu de l’impitoyable principe de concurrence.
Efficaces, ces aides aux entreprises ?
Si la pression fiscale pour les entreprises diminue de facto via ces différentes formes de soutien financiers, la question de leur efficacité reste posée. La dispense de précompte professionnel dans le secteur de la recherche et du développement (R&D) atteint, elle, son but. En revanche, épingle la BNB, la réduction de cotisation sociale pour la première embauche n’a manifestement pas porté ses fruits. Alors qu’elle a coûté 488 millions d’euros en 2023, elle a surtout permis à des entreprises qui auraient de toutes façons engagé de sauter sur cet effet d’aubaine.
La Belgique ne dispose pas de beaucoup d’études permettant de vérifier si ces coups de pouce aux entreprises atteignent leur objectif, par exemple en matière de création d’emploi. Il arrive aussi que des entreprises qui ont été largement subventionnées se séparent d’une partie de leur personnel voire ferment leurs portes, comme Audi Bruxelles. «On ne mesure pas bien les effets retours de ces mesures, confirmait l’économiste Bruno Colmant, interrogé par Le Vif. L’Etat espère favoriser de la création de richesses mais si celle-ci est avérée, elle ne dépasse pas, en général, 40% des sommes investies au départ par les pouvoirs publics. Or, prouver que le subside reçu sert à quelque chose et prouver à quoi il a servi serait possible. Dans un système idéal, c’est une bonne chose que l’Etat stimule l’activité des entreprises mais en contrepartie, il doit exiger d’elles, a minima, un rapport social, qui démontre entre autres son effet sur le volume de l’emploi ou de la recherche et développement.» Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
«Une plus grande transparence et des évaluations soutiendraient l’assainissement des finances publiques, embraie la BNB. Il convient d’évaluer, pour chaque subvention individuelle, si celle-ci remplit l’objectif politique visé et si elle le fait de manière efficace. D’autant, ajoute-t-elle, que les résultats des recherches empiriques relatives à l’efficience et à l’efficacité des subventions salariales sont mitigés.»
«Prouver que le subside reçu sert à quelque chose et prouver à quoi il a servi serait possible.»
En juillet dernier, des chercheurs du réseau Econosphère avaient estimé qu’en 2022, les pouvoirs publics avaient consacré quelque 51,9 milliards d’euros sous forme d’aides multiformes aux entreprises privées lucratives. Soit environ 9,2% du produit intérieur brut et 17,6% des dépenses publiques. Cette étude portait non seulement sur les subsides à l’emploi et aides à l’investissement mais aussi et entre autres sur la diminution progressive des taux de prélèvements obligatoires sous forme d’impôts ou de cotisations sociales. A titre d’illustration, dans les années 1990, le taux nominal de l’impôt des sociétés était encore à 43%!
Dans cette étude d’Econosphère, l’enveloppe consacrée aux subventions directes aux entreprises était évaluée à 20,1 milliards d’euros en 2023. Un chiffre proche de celui de la BNB, calculé un an plus tard. Comme la BNB, les auteurs de cette recherche soulignaient l’augmentation croissante de ce type de soutiens depuis les années 2000. La Banque nationale, toujours prudente, n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai: en 2021, elle avait déjà pointé les dépenses publiques affectées aux subventions salariales destinées aux entreprises comme particulièrement élevées en Belgique en comparaison avec les pays voisins.