Pas toujours facile de s’y retrouver dans les flots de nouveaux romans qui inondent les librairies. Retrouvez ici nos derniers coups de cœur littéraires.
Une sélections livres de Fabrice Delmeire, Aurore Engelen, Laurent Raphaël, Marcel Ramirez, Olivier Van Vaerenbergh

Je vous demande de fermer les yeux et d’imaginer un endroit calme
Michelle Lapierre-Dallaire
Le Nouvel Attila, 192 p.
Roman
«On m’a toujours fait sentir que je devrais être honteuse de la liste des choses qui m’excitent.» Pourtant, Michelle Lapierre-Dallaire n’en a que faire, de la honte. Son histoire s’affranchit de tout sens de la convenance, et avec ce texte incendiaire, elle entend bien livrer sans fard les tourments –et les joies– qui l’habitent depuis l’enfance. Car pour elle, comme pour Nelly Arcan, qu’elle cite en épigraphe, «écrire [veut] dire ouvrir la faille, écrire [est] trahir, [c’est] écrire ce qui rate, l’histoire des cicatrices.»
Dans son premier roman, Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok, l’autrice québécoise racontait sans fausse pudeur, dans une langue tout en rage et en percussion, l’inceste que lui a fait subir son beau-père durant l’enfance, alors que sa mère, alcoolique, ferme les yeux sur ces agressions. Elle y revient ici, l’évoquant dans la marge de la relation trouble et troublante qui l’unit à sa mère. Car l’objet de ce texte est avant tout le «désir indicible de son corps, celui d’être comme elle, d’être elle.» Je vous demande de fermer les yeux (…) est une histoire d’amour, et une histoire de désir incestueux, celui d’une fille pour sa mère, qui plonge l’enfant dans un désarroi profond face au monde qui l’attend. Un «désir indicible», qui va pourtant être mis en mots dans un récit d’une âpreté folle, nous plongeant dans les tréfonds de la sa psyché à vif.
«Petite, je joue beaucoup avec des Barbie», commence le texte, usant d’un présent qui souligne la persistance du trouble à venir, par-delà l’âge adulte, par-delà la mort. Les poupées modèles sont le terrain de jeu d’une éducation sexuelle et sentimentale autodidacte, où les prescriptions anatomiques sont transgressées par la petite fille. Elle se fait des films avec ses Barbie, mais aussi avec sa mère. «Un film pornographique dans lequel je joue un second rôle. Un film pornographique lesbien dans lequel ma mère tient le rôle vedette.» Ci-gît le tabou et s’inverse l’Œdipe. Michelle Lapierre-Dallaire ne tourne pas autour des mots, sa narratrice est amoureuse de sa mère. Mais cet amour aussi évident qu’il est interdit ne s’incarne pas que dans le désir: il est aussi jalousie et compétition, à tel point que l’inceste déjà évoqué est perçu comme une forme de validation, une «pénétration qui [la] rend visible».
Le texte est d’une crudité redoutable, pas tant physique qu’émotionnelle, provoquant tout à la fois inconfort et fascination devant une honnêteté d’autant plus impressionnante qu’elle est gravée par la littérature, et qui fait dire à la narratrice se sentir «parfois plus nue lorsque j’écris que lorsqu’on me paie pour avoir du sexe». L’un de ces livres qui vous font perdre vos mots lorsque vous annotez dans les marges, où s’enchaînent les traits et les exclamations. C’est aussi un livre à fleur de peau, un livre d’amour et un livre de peine, qui bouleverse et qui remue, qui déplace aussi un peu peut-être.

Maman
Régis Jauffret
Récamier, 256 p.
Roman
Madeleine, 106 ans, s’en est allée. «Tu vas profiter que j’ai le dos tourné pour écrire sur moi.» Cette maman autoritaire, clouée dans son fauteuil à la suite d’une opération de la hanche, vivait son séjour à l’Ehpad comme une prison. Après Papa, Jauffret poursuit l’enquête sur les êtres qui fourmillent en lui, s’égare dans les méandres de cette mère «à jamais exagérée», triture le sentiment de culpabilité qui ronge le mauvais fils, épuisé sous les serments d’amour. «Il faut parfois se préserver de l’amour d’autrui comme d’une volée de coups.» Passant au bain révélateur leur couple mère-fils mal assorti, Régis perce à jour la rencontre de ses parents, comment il devint écrivain, déterre l’anathème que sa Madona obsessionnelle lui jeta dans la tendre enfance. Car Mado mentait «comme on appelle au secours». Dans une rentrée littéraire croulant sous les stèles familiales, Jauffret s’extirpe de la mêlée. Remuant les souvenirs en vermeil dans le grand argentier de la mémoire, se cherchant des poux, l’auteur des Microfictions fend l’armure dans un acte de contrition trop longtemps cadenassé. «Vous voyez bien, Madelon est ma prisonnière et je vous la raconte comme on tabasse.» Bonjour tristesse.
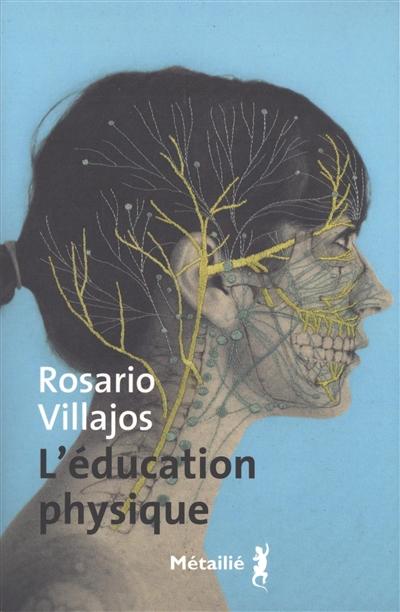
L’Education physique
Rosario Villajos
Métaillé, 256 p.
Premier roman
Catalina est une fille, et comme toutes les filles, elle vit dans la peur, «une peur ancestrale, statique, anthropologique, épigénétique, fondée». En cette fin de journée, elle s’est donné une mission: «Rentrer à la maison à l’heure et sans se faire violer.» Mais le moyen qu’elle a choisi, l’autostop, la fait douter, car on le lui a déjà dit: «C’est une faute grave pour une jeune fille.» Mais quel choix avait-elle, alors que le père de sa meilleure amie venait d’avoir des gestes déplacés, et qu’il était hors de question qu’elle monte en voiture avec lui? Et quel choix a-t-elle, quand son prof d’éducation physique lui explique qu’elle se trompe, il n’a pas les mains baladeuses? Quelle est sa marge de manœuvre quand on lui rappelle sans cesse qu’elle est responsable des pulsions des hommes, que c’est à elle de les éviter? Ce premier roman livre le monologue intérieur bouillonnant d’une adolescente qui s’interroge sur ce corps en devenir qu’on voudrait dompter, dresser et contenir. Ce «on», c’est tout à la fois sa mère, son père, et la société qui l’entoure, celles et ceux qui l’assignent et la contraignent. Catalina «partait du principe qu’elle n’était qu’une marchandise, une pièce de bétail dotée d’un corps que les autres pouvaient manipuler à leur guise, les petits garçons, les médecins, les profs». Bien qu’elle se sente menacée par ce danger, elle résiste, et même le provoque sciemment, avec cette fougue et cette dose d’inconscience que procure l’adolescence, moment suspendu qui oscille entre une forme d’extralucidité sur le monde des adultes, et une vulnérabilité décuplée. Un texte dense et précis qui nous plonge, trois heures et demie durant, le temps d’une session d’autostop, dans la psyché incandescente d’une jeune fille en pleine (re)possession de ses moyens.

La Honte
Arttu Tuominen
Editions de La Martinière, 432 p.
Roman noir
Linda Toivonen, inspectrice à la brigade criminelle de la petite ville de Pori, en Finlande, doit enquêter sur la disparition d’une jeune fille de 13 ans, bientôt retrouvée morte après avoir été torturée puis jetée au fleuve. Une disparition puis un assassinat qui vont en rappeler d’autres, et une enquête qui va rapidement s’inviter dans sa vie intime et privée. Car Linda a elle aussi une enfant de 13 ans, Linnea, avec qui les relations sont difficiles, dont le nez ne décolle pas du smartphone et dont elle ne sait rien de la vie numérique, là où précisément «Peter Pan» recrute ses victimes, dont une de ses camarades de classe.
Le drame, pourtant, va se jouer ailleurs: comme sa mère, et comme un million de Finlandais, Linda boit trop, et Linda minimise le problème… Arttu Tuominen, héritier revendiqué du suédois Henning Mankell et de son serial autour du commissaire Kurt Wallander, n’use du crime que pour mieux mettre en avant les maux de la société finlandaise, pourtant considérée comme la plus heureuse du monde: le passé fasciste du pays avec Tous les silences, le sort des communautés LGBTQIA+ dans La Revanche, ou ici, dans La Honte, l’alcoolisme et les violences sexuelles. Une analyse au scalpel et par le biais de la fiction que l’auteur, ingénieur environnemental, intègre en outre dans une mécanique de serial très habilement huilée. Et si le lecteur attentif découvrira très voire trop vite l’identité de son «Peter Pan», pas de panique: cette Honte, tout en crescendo, s’avèrera haletante jusqu’à la dernière page.
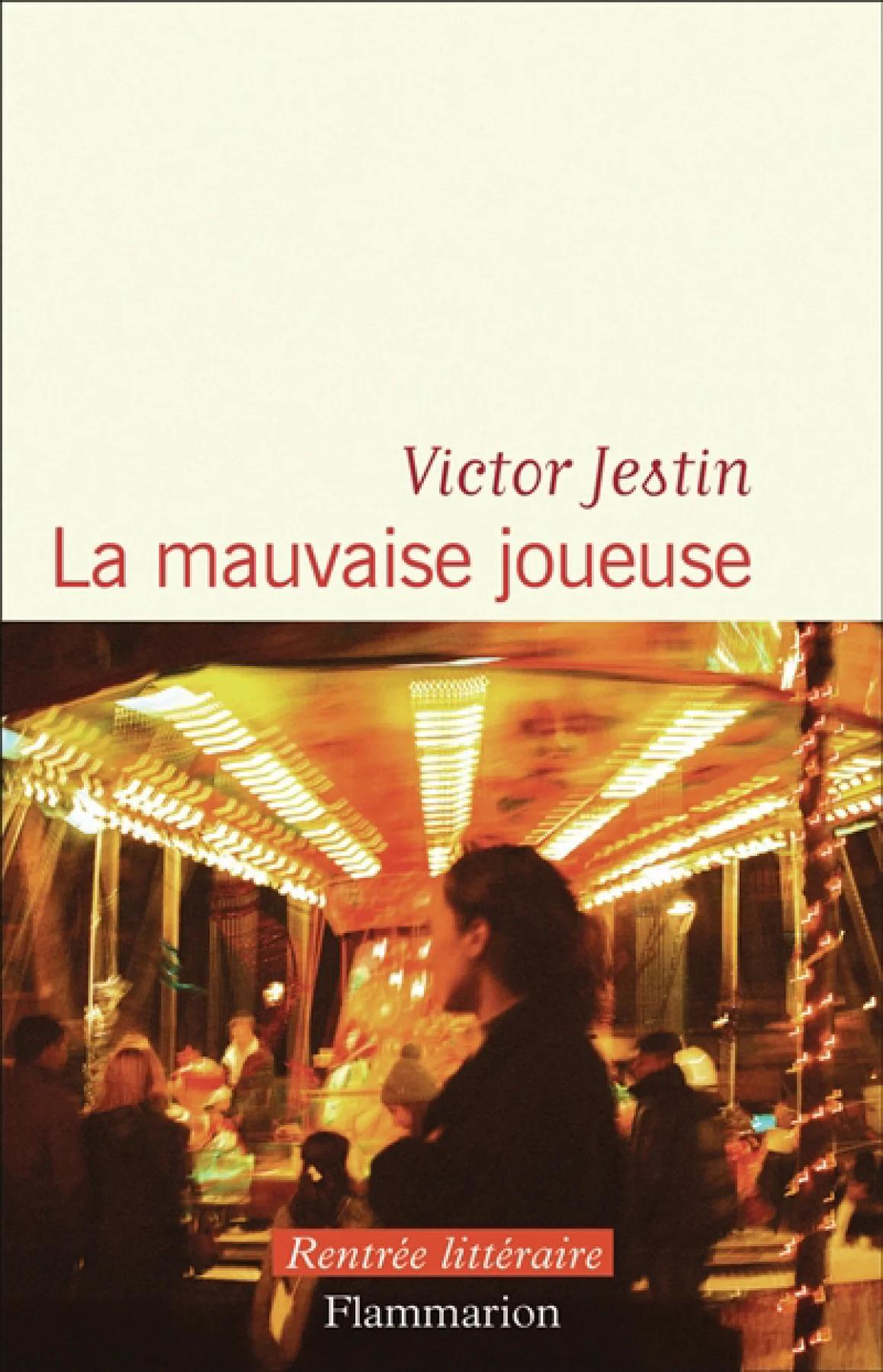
La Mauvaise Joueuse
Victor Jestin
Flammarion, 148 p.
Roman
Trente ans, comptable, «un compagnon que j’aimais, des amis, un appartement et un projet d’enfant», Maud semblait partie pour quelques années de bonheur sans nuage. Mais «il a suffi d’une bêtise» pour tout gâcher. Laquelle? Laisser tomber par accident son antique Nokia 3310 dans la cuvette des WC et accepter le vieux smartphone d’un collègue. Un échange a priori banal, sauf quand on est une ancienne accro aux jeux. A tous les jeux. Quelques minutes plus tard à peine, elle découvre Candy Crush et c’est la rechute instantanée, d’autant plus violente que le sevrage a été long et douloureux.
«J’avais résisté toutes ces années sans le moindre écart, et de surcroît dans l’indifférence générale, car contrairement au tabac, à l’alcool ou à la cocaïne, mon vice à moi n’était jamais considéré.» Le début d’une descente en enfer en forme de suicide social: alors qu’elle aligne les bonbons colorés sur l’écran en roulant, elle heurte un objet –à moins que ce ne soit pas un objet…–, décide de fuir en imaginant le pire, atterrit dans un bowling où elle enchaîne les parties frénétiques, jusqu’au malaise, avec des inconnus, avant de se jeter sur les flippers, de se faire mettre à la porte, puis d’aller chercher sa dose ailleurs, dans un café ou dans une fête foraine. Fléchettes, échecs, tir à la carabine, peu importe. Pour Maud, l’important n’est pas de participer mais de gagner, ce soulagement de ne pas perdre. Même contre un môme croisé sur un terrain de foot d’une cité, harcelé sans pitié pour une revanche au Monopoly. Alors que cette fuite en avant éperdue, et de plus en plus hallucinée, la conduit irrésistiblement vers la maison familiale où tout a commencé, avec un père shooté aux jeux de société, la jeune femme se souvient de ses années sous influence, jusqu’à l’arrêt brutal au sortir de l’adolescence dans un éclair de lucidité. «Une série d’incidents m’avait conduite à la certitude que le jeu devait quitter ma vie.»
D’une plume vive et électrique, Victor Jestin trousse un portrait attachant d’un être à la dérive, et s’affirme un peu plus comme un observateur inspiré du désordre mental, le pedigree de sa mauvaise joueuse s’inscrivant dans la lignée des personnages borderline de ses deux premiers romans (La Chaleur et L’homme qui danse). Les cases «Chance» sont rares dans la vraie vie…
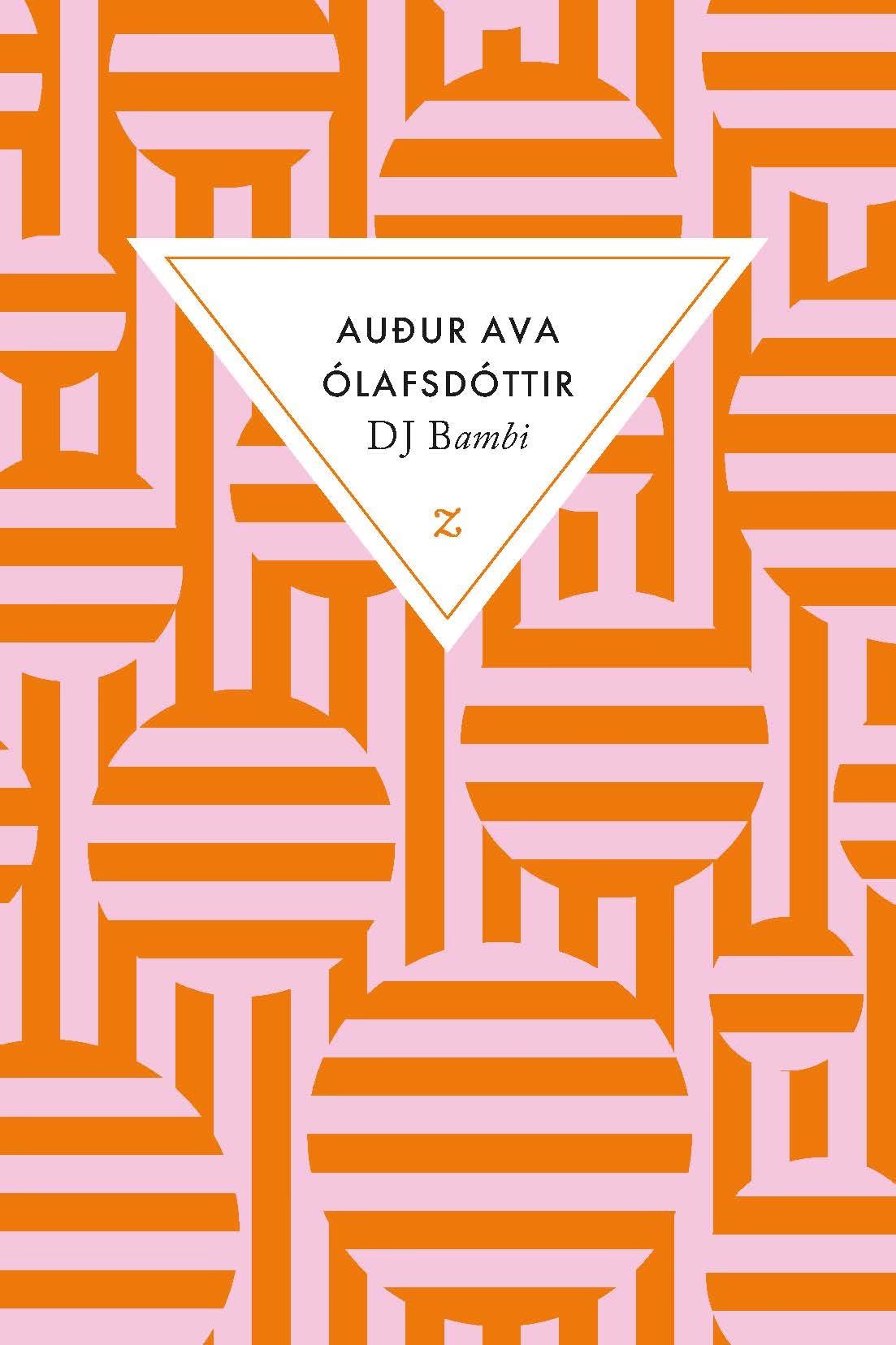
DJ Bambi
Audur Ava Olafsdóttir
Zulma, 198 p.
Roman
Ça commence par une envie de fin, celle de Logn, une sexagénaire en quête du meilleur endroit pour se noyer. Elle imagine ces derniers instants, le blouson en daim qu’elle ôtera pour ne pas que le sel l’abîme, son sac à main qu’elle posera sur une pierre, la lettre qu’elle laissera à son frère. Un projet mûrement réfléchi, mais Logn n’est pas tout à fait prête. «Je ne mourrai que lorsque j’aurai rectifié le grand malentendu de mon existence», quand son corps correspondra à son être. Logn veut mourir, mais dans un corps de femme. Alors, avant de pouvoir enfin accéder à cette réparation, elle replonge dans son passé, son enfance, sa jeunesse, sa vie conjugale aussi. Au fil des souvenirs égrenés le temps de brefs chapitres portant des titres mélancoliques, comme autant de morceaux de vie, Logn fait le point sur une existence faite de doutes et de questionnements, d’un sentiment diffus de ne pas être à sa place, de tendre vers un ailleurs dont elle connaît l’âpreté, mais qu’elle désire plus que tout.
L’autrice islandaise enfile ces instantanés de vie comme des perles sur un collier, chacune miroitant de son propre éclat, ici une histoire d’héritage empêché, là d’un mariage déchiré, ici encore d’une parentalité en mutation. L’histoire de Logn, quelqu’un d’autre aimerait la raconter, une écrivaine qui l’invite à se confier, qui voudrait capturer l’essence de cet être en transition, de son rapport au temps. Son livre, elle aurait voulu l’appeler Logn, ce qui en islandais signifie «calme plat», comme le jour qui vient après la tempête, ou le matin qui suit une profonde dépression. Mais ce mot n’a pas d’équivalent dans les autres langues. «Il n’est pas possible de me traduire», constate Logn. C’est pourtant ce qu’essaie de faire avec délicatesse Audur Ava Olafsdóttir, nous offrant le portrait habité d’une femme en quête d’apaisement
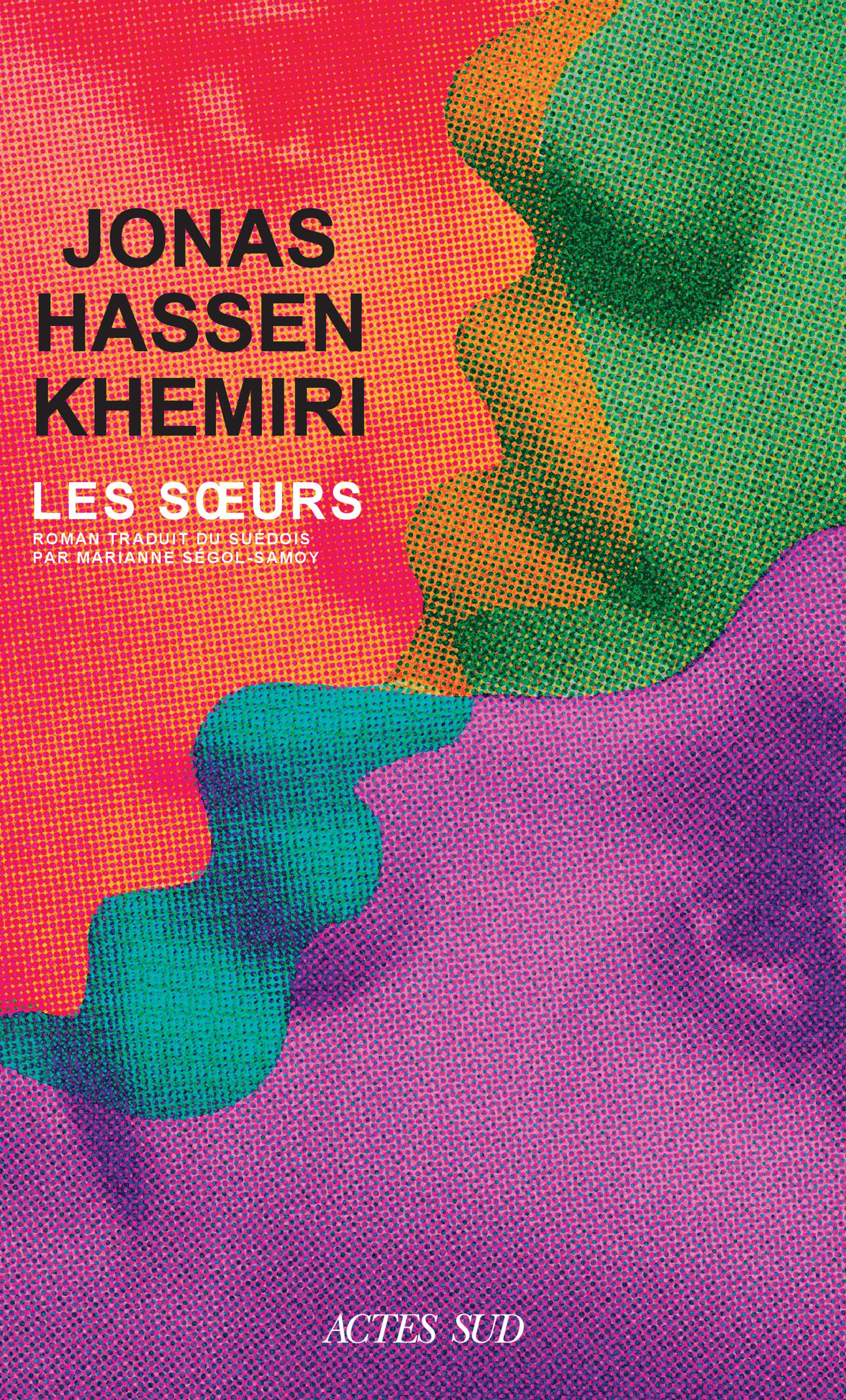
Les Sœurs
Jonas Hassen Khemiri
Actes Sud, 686 p.
Roman
La première fois qu’il entend parler des sœurs Mikkola, Jonas Hassen Khemiri (prix Médicis étranger pour La Clause paternelle) a 5 ou 6 ans. Il se souvient qu’il était question d’une famille qui emménageait dans son quartier de Drakenberg, que la femme, Selima, était une «vieille amie» de son père ayant fui une malédiction, que sa mère était très contrariée par cette arrivée. Toujours seules et prêtes à se battre, Ina, Evelyn et Anastasia semblaient n’avoir peur de rien ni de personne. Suivant scrupuleusement les règles édictées par leur mère, les sœurs veilleront toujours à passer inaperçues pour ne pas attirer la jalousie. L’aura qu’elles dégagent ne leur facilite guère la tâche… A commencer par l’attraction qu’elles exercent sur Jonas. Fasciné par celles qui partagent sa nationalité pour moitié tunisienne, le futur écrivain tentera toute sa vie de (se) glisser dans leur sillage pour, qui sait, tordre la réalité afin de la rendre moins douloureuse.
En sept cahiers échelonnés entre 2000 et 2035 (plus des incursions dans les années 1990), Khemiri déroule une fresque lyrique dont l’ampleur peut intimider (700 pages). Pourtant, dès l’entame, plongeon au cœur d’une fête de la Saint-Sylvestre à l’aube de l’an 2000, le style dégage un «magnétisme» dont il est difficile de s’extraire. Au gré des séparations et des retrouvailles, des amours et des deuils, le roman se déploie en deux narrations parallèles tel un immense jeu de piste entre Stockholm, Tunis et New York. Soit un Rubik’s Cube émotionnel sur la question de l’appartenance, dont la carcasse est secouée par l’onde de choc provenant de la dernière pièce lorsque celle-ci est mise en place. «Tu ne veux quand même pas finir comme les sœurs Mikkola.»
Outre l’étourdissante boucle temporelle de 300 pages composant le Livre I (entre autres ellipses vertigineuses dont le livre fait son miel), on citera des retrouvailles devant un rideau métallique dignes de celles de Ross et Rachel dans Friends puis, surtout, une mise en abîme de l’écriture, ses affres et ses doutes, comme on en a rarement lues. Emporté par une frénésie graphomane et délirante, pétrifié dans un élan désespéré de retenir le temps qui passe, Khemiri veut tout enregistrer, tout saisir, pour comprendre comment faire la paix avec sa voix intérieure. Pourquoi regarde-t-on 40 fois Top Gun adolescent, pourquoi les phrases malencontreuses d’un père s’inscrivent durablement en nous pour toute la vie?
Voulant percer le mystère de la malédiction empêchant les sœurs Mikkola de s’attacher à quelqu’un, parce que les personnages de fiction nous guérissent parfois lorsque les personnes réelles se dissolvent dans l’éther, ce grand livre sur les non-dits (familiaux, comment s’appartenir, la dépression) et son final lumineux ne vous lâche pas. «[…] je sais que quand je relirai ce texte, je couperai soigneusement ces parties, je supprimerai chaque phrase où il est écrit que je pleure.
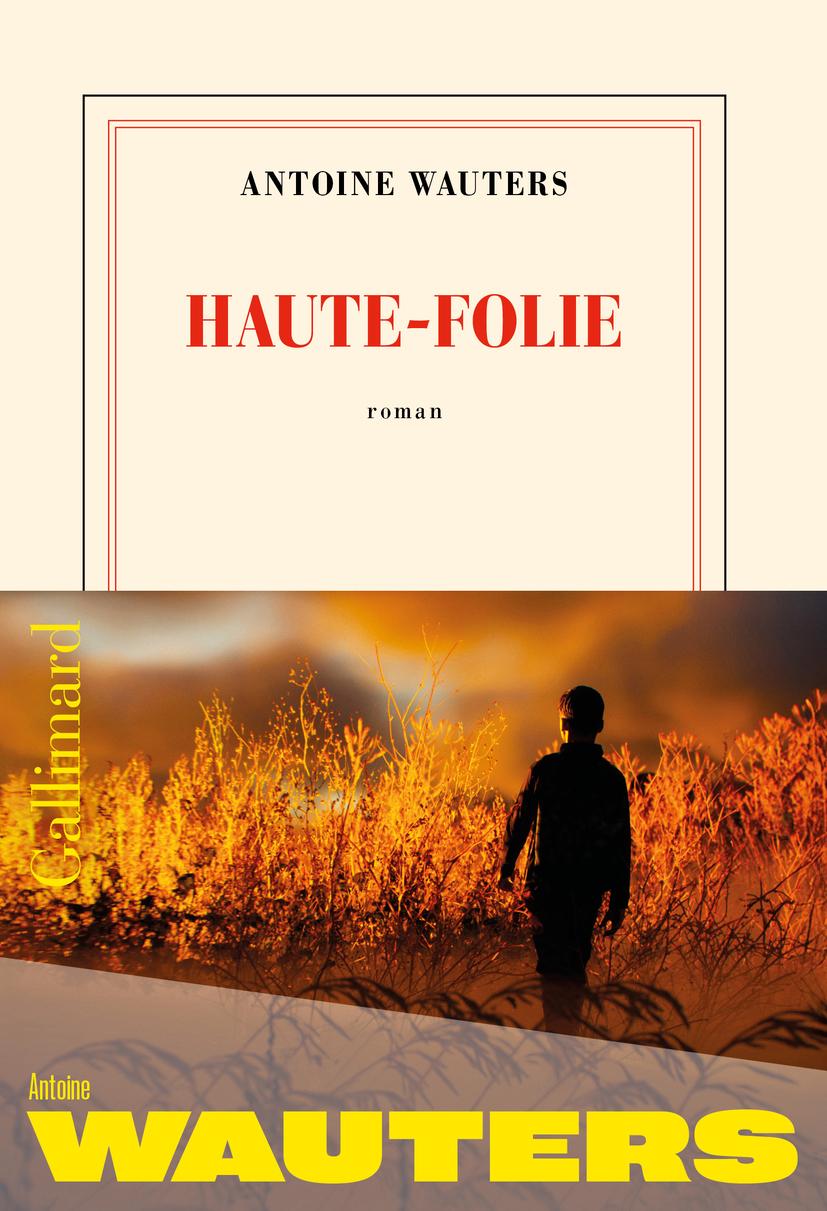
Haute-folie
Antoine Wauters
Gallimard, 176 p.
Roman
Oubliez le nouveau Amélie Nothomb! Parmi tous les livres de cette rentrée littéraire 2025, l’événement belge, c’est l’arrivée chez Gallimard de l’auteur wallon Antoine Wauters, qui devrait ainsi bénéficier d’une surface médiatique d’envergure pour sa prose aux frontières de la poésie, toujours aussi ciselée dans une économie de moyens narratifs qui trouve dans la concision une certaine forme de lyrisme profondément ancré dans le territoire. Haute-Folie est un toponyme, un lieu géographique autant que psychologique, titre programmatique sur les silences qui dévastent les familles.
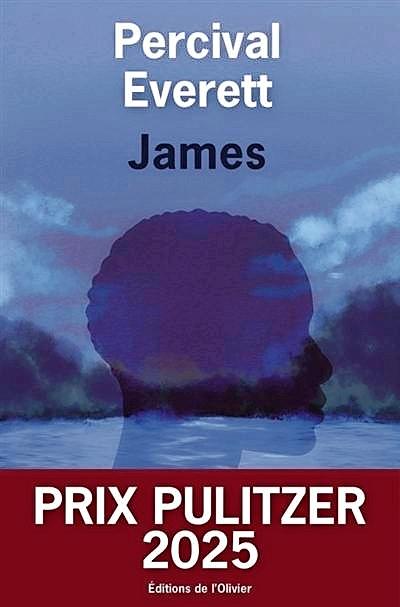
James
Percival Everett
Editions de l’Olivier, 288 p.
Roman
L’histoire de l’esclavage a été largement écrite par les Blancs. Mais il n’est pas trop tard pour en proposer une autre version, celle des opprimés. Démonstration brillante avec ce récit d’aventure raconté à travers les yeux, le corps –cette marchandise brutalisée– et l’esprit aiguisé de Jim, le personnage noir du roman Huckleberry Finn de Mark Twain. Contraint de fuir sa ville et sa famille, le fugitif erre le long du Mississipi, flanqué du jeune Huck, décapant au passage la bêtise, la cruauté et même le vernis de bonne conscience des abolitionnistes. Une satire incisive, édifiante, qui met à nu l’entreprise abjecte du racisme. Bref, un classique instantané.
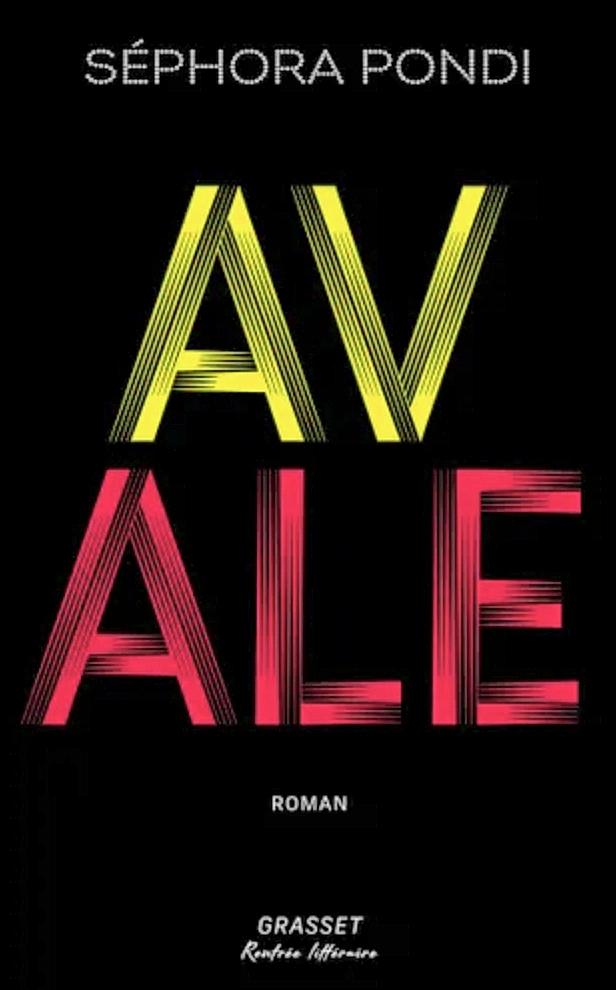
Avale
Séphora Pondi
Grasset, 224 p.
Premier roman
Chaque rentrée littéraire apporte son lot de livres révélations, et parmi ceux de 2025, on compte Séphora Pondi, actrice, scénariste et metteuse en scène pensionnaire de la Comédie-Française qui livre un premier roman tendu, sur fond de misogynoir et de classisme. Avale est une histoire de dévoration qui se déploie à travers les destins parallèles de deux grands traumatisés: Lame, jeune actrice noire dans le vent, pas dupe de la fragilité de l’instant, trahie par sa peau couverte d’eczéma, et Tom, étudiant paumé qui vrille un soir de finale de Coupe du monde.
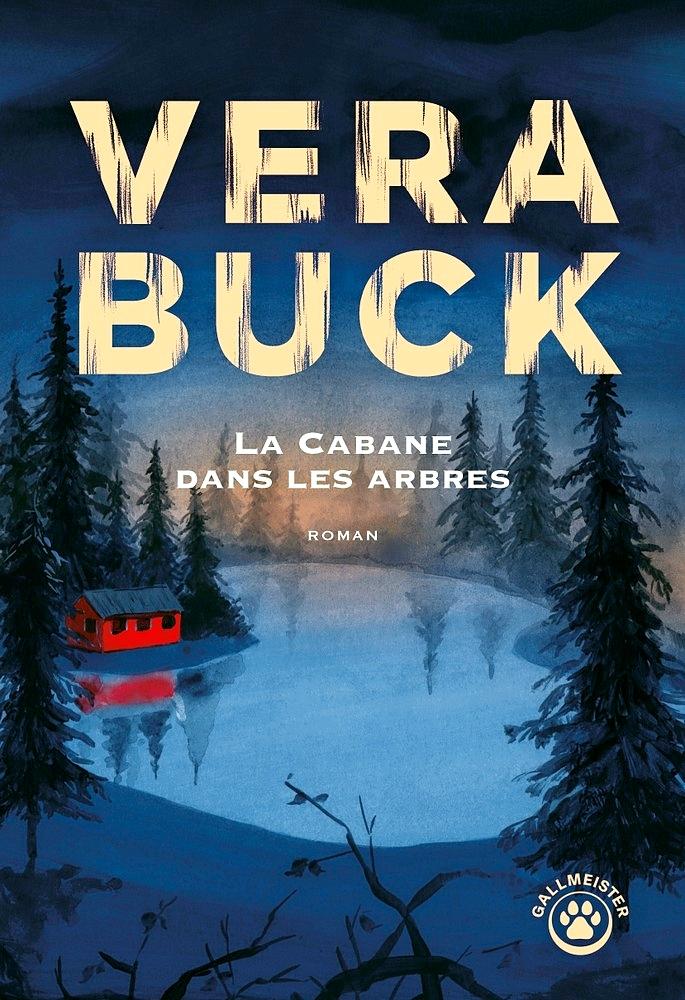
La Cabane dans les arbres
Vera Buck
Gallmeister, traduit de l’allemand par par Brice Germain, 464 p.
Thriller
Ses Enfants loups avaient ravi critiques et lecteurs, nombreux, l’année dernière. Vera Buck remet le couvert et transforme l’essai avec La Cabane dans les arbres, qui coche toutes les cases du thriller scandinave contemporain, même s’il est allemand: des vacances idylliques au fin fond d’une forêt suédoise, un cadavre qui ressurgit, un enfant qui disparaît, des secrets qui ne le sont plus… Et puis, cette cabane, dans le vieux frêne, qui semble aussi sinistre que hantée… L’autrice confirme ici tout le bien qu’il y a à penser du néo-noir allemand, version mainstream.

Quatre jours sans ma mère
Ramsès Kefi
Philippe Rey, 208 p.
Premier roman
Suite au départ inexpliqué de la Mama –«Ça se fait pas, on joue pas avec ça!»– Salmane et son père se retrouvent sans boussole au cœur de la Caverne, cité où les grands projets sont allés «se faire foutre». Dans un premier roman attachant, Ramsès Kefi slalome entre les tours de banlieue et évite les écueils des clichés. Entre tchatche et embrouilles, le temps d’un retour au bled, cette quête des origines révèle une signature au parler vrai. «Fais une douche et un shampoing. On va chez les gens.»

Jouer le jeu
Fatima Daas
Editions de l’Olivier, 192 p.
Roman
Cinq ans après une entrée fracassante dans le milieu littéraire, Fatima Daas est de retour. Avec une double actualité: la sortie au cinéma en octobre prochain de l’adaptation de La Petite Dernière, son premier roman autobiographique choc qui slammait la quête identitaire d’une jeune banlieusarde musulmane et lesbienne, et la publication en cette rentrée littéraire de son deuxième et très attendu roman, Jouer le jeu. On prend les mêmes et on recommence. Ou presque.
Le récit colle à nouveau aux baskets d’une lycéenne de cité. Elle ne s’appelle plus Fatima mais Kayden. Et comme l’autrice, elle questionne son orientation sexuelle et voue un culte à l’écriture. Soit deux «anomalies» dans ce paysage abandonné de la République. Son intelligence et sa sensibilité n’ont toutefois pas échappé à sa prof de français, Madame Fontaine, qui la prend sous son aile et s’est mis en tête de la faire rentrer à Sciences Po, pouponnière de l’élite. Soit la perspective d’une émancipation, d’un transfert de classe inespéré. Et de remettre en route l’ascenseur social de la méritocratie, même si le chemin est long et jalonné de questionnements, de doutes, sur le risque, entre autres, de s’éloigner de sa bande de potes ou de sa famille, ses deux ancres. A ce vertige s’ajoute l’éveil et le trouble des sens, qui parasitent le jugement de la jeune fille, secrètement amoureuse de sa mentor.
Dans une langue orale fougueuse, qui met à nu les émois de l’adolescence et en scène la fracture culturelle qui divise la société française, mais sans pour autant atteindre le niveau d’urgence et d’incandescence de son précédent livre, Fatima Daas capte les états d’âme de cette héroïne des temps modernes, grisée par l’espoir d’une vie meilleure avant de déchanter douloureusement. A la désillusion s’ajoute la brûlure encore plus cuisante d’avoir été trahie. Voire manipulée. Un roman d’apprentissage qui imbrique l’intime et le politique, ce qui en fait à la fois sa force et sa limite, la déception amoureuse portant à ébullition un sentiment d’injustice légitime. «Je me suis attachée à toi, comme on s’attache à une figure d’autorité, au pouvoir, à l’impossible, quand on est une jeune lesbienne dans un monde prêt à nous détruire», reproche, très amère, la narratrice. Bienvenue dans la France insoumise.

Les Bons voisins
Nina Allan
Tristram, traduit de l’anglais par Bernard Sigaud, 320 p.
Roman noir
Cette cuvée 2025 de la rentrée littéraire –cela a suffisamment été dit (et moqué)– est riche en autofictions et récits autobiographiques. Sur les mères, les pères, voire les familles entières des auteurs. Non pas qu’on trouve cela déplaisant, c’est tout simplement qu’on en aurait presque oublié les pouvoirs de la fiction pure. Une de ses maîtresses, l’Anglaise Nina Allan, est (déjà) de retour en français avec Les Bons Voisins: un triple meurtre a été commis sur l’île écossaise de Bute, non loin de Glasgow. Shirley, 15 ans, Sonny, son très jeune frère, et Susan, leur mère, sont retrouvés dans leur maison, tués par balles. Leur père, John Craigie, est rapidement désigné coupable. Vingt ans plus tard, Cath, jadis la meilleure amie de Shirley, est désormais disquaire à Glasgow, et tente de percer dans la photographie. Elle revient sur l’île –officiellement, l’idée est d’y poursuivre sa série de photos intitulée «Maisons du crime». Venue prendre des clichés de l’ex-demeure des Craigie, elle se lie d’amitié avec Alice, la nouvelle résidente. Aidée par cette dernière, elle reprend l’enquête sur le triple meurtre.
On suit ainsi Cath dans ses investigations, et l’on voit, à ses côtés, son «mur du crime» s’étoffer de nouvelles coupures de presse, de nouvelles têtes. Puis le roman prend un tournant inattendu avec la découverte de la maison de poupées que John Craigie avait fabriquée de ses mains à l’identique de leur propre foyer: tel un riff de guitare électrique récurrent parasitant –pour le meilleur– une chanson pop, voici que fées, lutins et autres personnages improbables aussi fascinants qu’inquiétants du folklore britannique (les «bons voisins» du titre) commencent à apparaître dans le livre, avant d’en prendre le contrôle pour un temps…
C’est la première incursion de Nina Allan sur les terres du roman noir, mais ses lecteurs ne seront pas dépaysés. L’autrice, elle-même résidente de la superbe île de Bute, s’approprie le genre, avec son style propre et ses marottes. Aussi, dans cette sorte d’étrange «polar de terroir» (mais de haute volée!) façon Trois crimes à Ploumanac’h, ce genre cher à nos voisins (non, pas les fées et les lutins, cette fois…), elle fissure une nouvelle fois le réel, et mêle ses personnages fictifs tourmentés à de célèbres scientifiques ou au peintre anglais fou et parricide Richard Dadd. Non sans mener en bateau (plutôt en ferry, ici) le lecteur fasciné –«Toute intrigue policière doit comporter une fausse piste, c’est la règle», rappelle Cath… Avec, toujours, cette justesse dans les dialogues et cette propension à entrer dans la tête de ses personnages. Cath est du reste si hantée par la mort de Shirley que celle-ci l’interrompt régulièrement dans ses pensées.
Si les dernières pages laissent penser que le crime a finalement été élucidé, Nina Allan laisse volontairement planer le doute sur de nombreux éléments de l’intrigue que, d’ailleurs, elle ne résout pas. De quoi autoriser les lecteurs un brin rêveurs à se laisser aller à des interprétations très personnelles et… folkloriques.
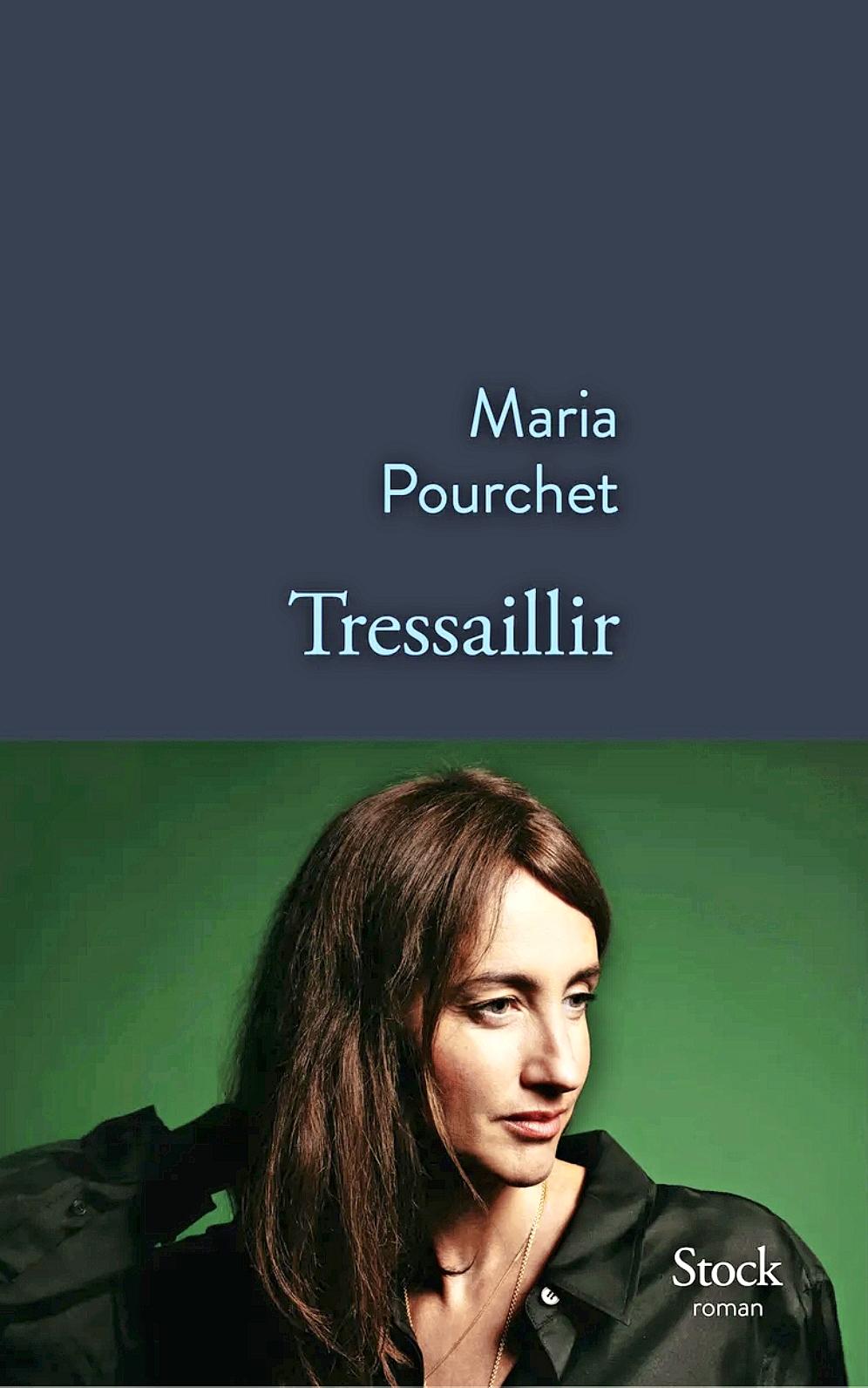
Tressaillir
Maria Pourchet
Stock, 336 p.
Roman
Après l’amour, qu’elle a scruté sous bien des formes, souvent il y a la rupture. C’est elle que Maria Pourchet décortique dans Tressaillir, une rupture qui, loin d’être un geste sec, s’éprouve au fil du temps. Michelle part, elle quitte Sirius, ou plutôt s’en arrache, y laissant quelques lambeaux d’elle-même. La séparation va réveiller la peur viscérale qui l’étreint depuis sa plus tendre enfance, une peur qui est comme un mécanisme de survie, et qu’elle explorera en rentrant chez elle, dans la forêt, ce départ se doublant alors d’un retour.
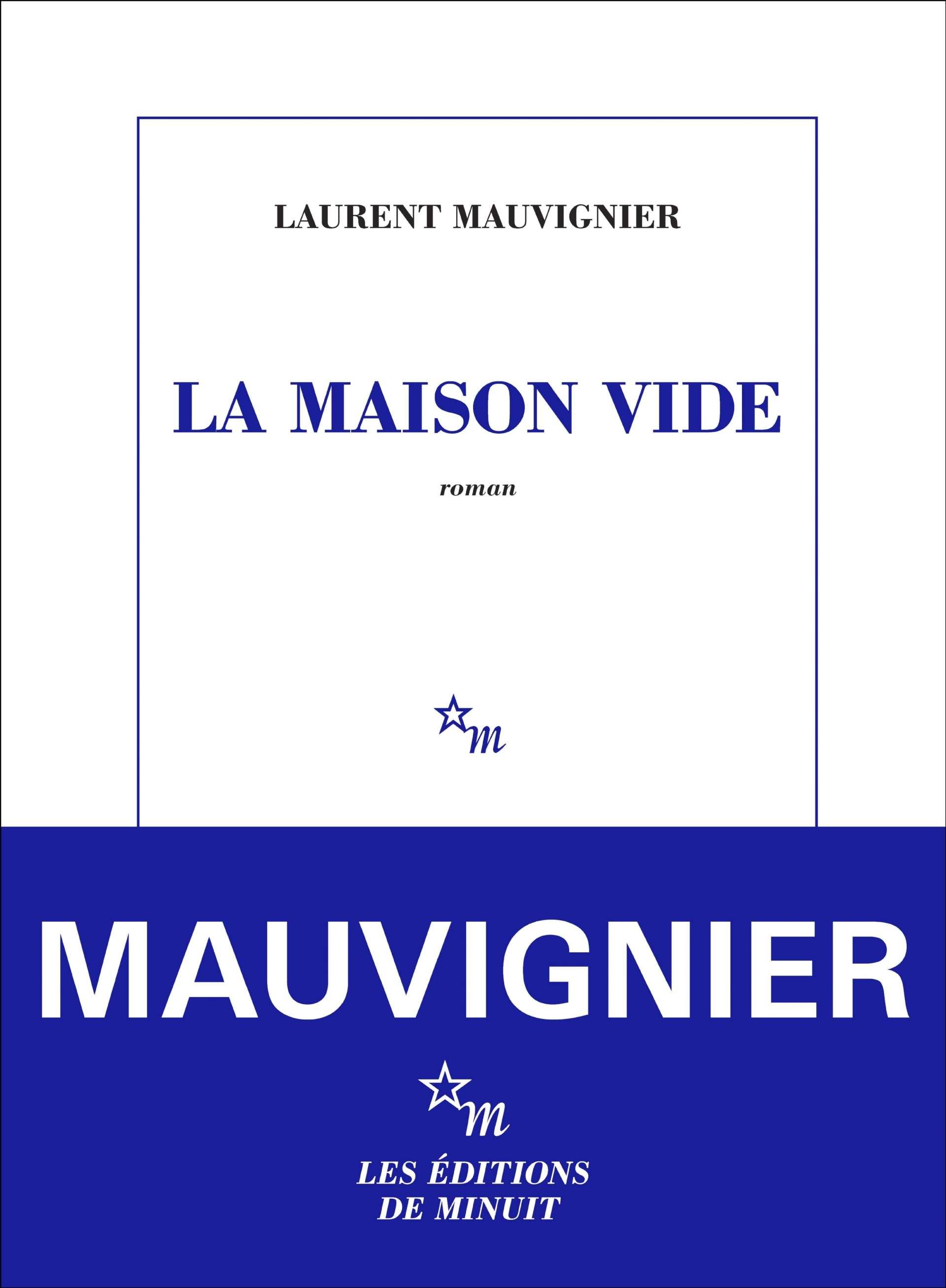
La Maison vide
Laurent Mauvignier
Editions de Minuit, 752 p.
Roman
Tout commence le jour où le narrateur, double à peine fictif de l’auteur, part à la recherche de la médaille de la Légion d’honneur de Jules, son arrière-grand-père et héros de la Grande Guerre, dans la maison familiale du hameau fictif de La Bassée. Il a beau fouiller partout, il ne la retrouve pas. Il exhume en revanche d’autres breloques, photos jaunies et bijoux de ses aïeux qui l’entraîneront dans un long (750 pages!) voyage immobile à travers le temps, sur les traces des fantômes perchés sur son arbre généalogique.
Une enquête dans les replis de la mémoire s‘étalant sur trois générations dont l’ampleur rappelle un certain Marcel Proust. D’autant que, comme son illustre prédécesseur, l’auteur du remarquable thriller Histoires de la nuit, ici au sommet de son art, laisse vagabonder sa pensée sans fil conducteur, sans intrigue autre que le souci de ressusciter un monde englouti, «ignoré de nous-mêmes», en entremêlant reconstitution documentaire et pure invention romanesque. L’ombre de Flaubert et de Zola plane aussi sur cette introspection pudique portée par une voix ample et sinueuse comme un fleuve majestueux reflétant mille nuances. Le hasard faisant bien les choses, l’un des personnages centraux de cette enquête intime hors norme, à savoir son arrière-grand-mère Marie-Ernestine Chichery, est née… Proust. Pas de lien de parenté avec l’autre, mais la coïncidence est tout de même troublante.
S’appuyant sur les vestiges abandonnés dans La Maison vide (un foulard jaune, une vieille commode ébréchée, un antique piano), l’écrivain reconstitue les pièces d’un puzzle de la bourgeoisie provinciale moins banal qu’il n’y paraît à première vue. Déjà, il y a ce mystère: pourquoi sa grand-mère Marguerite a-t-elle été systématiquement défigurée sur les photos, à coups de ciseaux ou de gribouillages rageurs? Comme une tentative de l’effacer de la mémoire. Tout se tient pour Laurent Mauvignier qui pressent que la violence du geste de son père, suicidé en 1983, trouve son origine dans ce passé trouble. C’est même l’un des fils rouges de son entreprise: «Et moi, à l’autre bout du XXe siècle, déjà embringué dans le suivant sans même avoir eu le temps de le croire, me voilà aujourd’hui embrassant cette histoire d’un seul coup d’œil, avec, étalée devant moi, l’évidence qu’il s’agit d’une seule et même histoire diffractée en différentes parties reliées par une unité souterraine.»
Du XIXe siècle jusqu’aux années 1940, il rassemble les éléments biographiques, s’intéresse surtout aux femmes, dont il prend le pouls émotionnel à différents moments clés et souvent tragiques de leur vie: aspirations contrariées, avortement, déshonneur, mariage arrangé… Des parentes broyées par l’histoire: la grande, avec ces deux conflits meurtriers balafrant l’album de famille, et la petite, plus silencieuse mais pas moins destructrice, qui s’est écrite à l’encre du patriarcat. De l’intime mais à haute valeur universelle et politique.
A contre-courant de l’urgence qui domine notre époque agitée, ce métaroman sans véritable héros parie sur le temps long. Il faut accepter de s’abandonner pour en pénétrer les sous-couches narratives. Si on s’arrête toutes les deux minutes pour scroller sur son smartphone, c’est peine perdue. Mais les plus déterminés seront largement récompensés: ils vivront une expérience de spiritisme littéraire fascinante.

A la table des loups
Adam Rapp
Seuil. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sabine Porte. 512 p.
Fresque
On avait décerné l’an dernier le titre ronflant mais recherché de «Grand roman américain» à Toutes les nuances de la nuit de l’anglais Chris Whitaker: on est en passe de repasser la breloque au régional de l’étape, l’écrivain et dramaturge Adam Rapp, avec sa vertigineuse Table des Loups: le destin plein de violence et de maladie mentale d’une famille nombreuse sur 60 ans et moult générations, que tout sépare, et pourtant… Un page-turner autant qu’une plongée dans ce fameux «cœur noir de l’Amérique» que leurs écrivains s’arrachent.
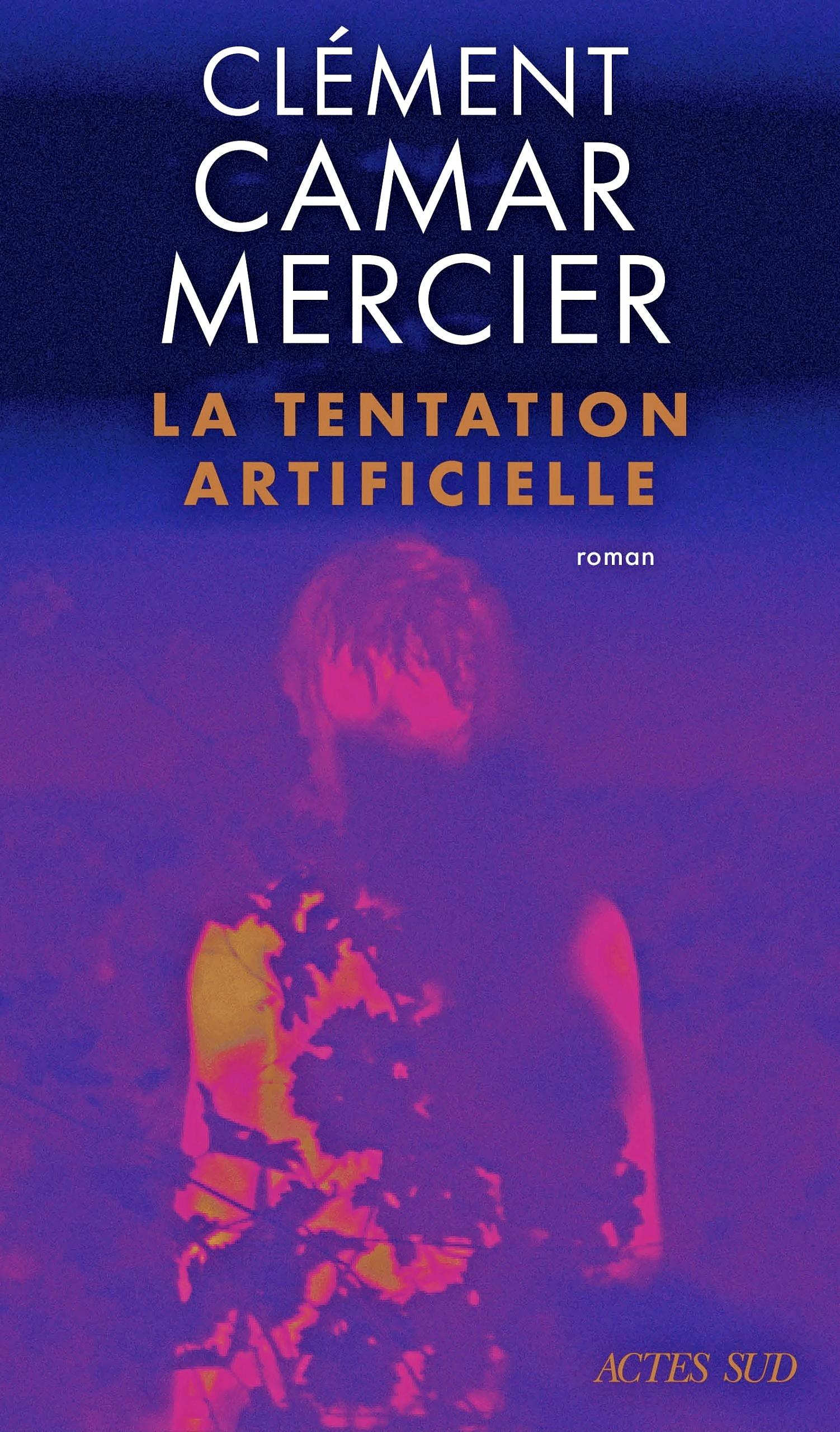
La Tentation artificielle
Clément Camar-Mercier
Actes Sud, 416 p.
Roman
Un codeur mégalomane se pique de démonologie pour engendrer l’IA ultime qui survivra à l’Homo sapiens, espèce en phase finale d’abrutissement. Singeant un monde qui n’en finit plus de bugger, Clément Camar-Mercier signe un roman d’anticipation terminal sur les enjeux de l’intelligence artificielle. Corrosif, brillant, parfois insoutenable, ce brûlot à la première personne du singulier mondialisée claque tel l’American Psycho du chaos numérique. «Pour la fin du monde, le plus tôt serait le mieux.»
Lire aussi | La Tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier, un roman féroce sur l’éradication de l’homme par l’IA
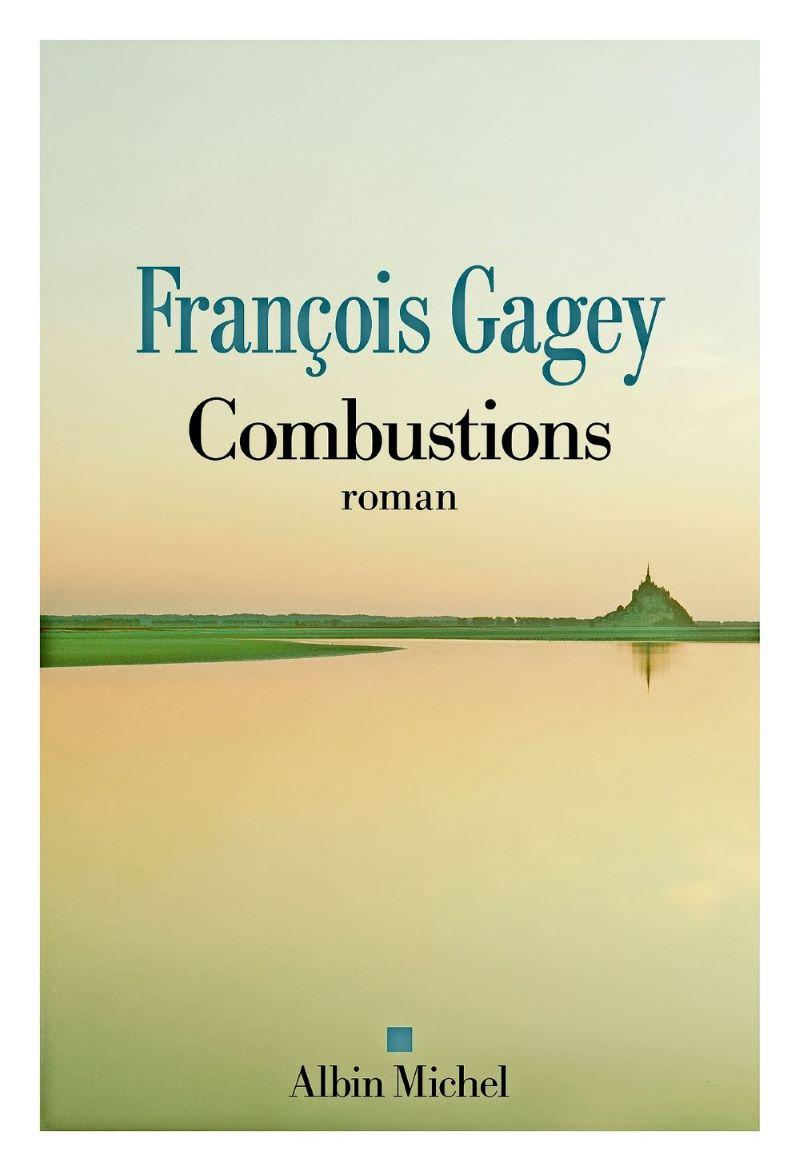
Combustions
François Gagey
Albin Michel, 352 p.
Premier roman
La centrale de Flamanville, dans le Cotentin, n’est plus à la pointe de la technologie nucléaire. Dans ce premier et brillant roman de François Gagey, elle a explosé en octobre 2023, libérant massivement gaz et radiations. Paul, de la banque d’affaires Chassegrain Mireel, et deux de ses amis, dont le narrateur, se promènent ce jour-là sur la plage, à quatre kilomètres du lieu. Démarre alors, très vite, une marche pour leur survie, qui se mêle d’un portrait satirique de nos élites: qu’est le pouvoir face à l’effondrement, et aux chairs qui fondent?
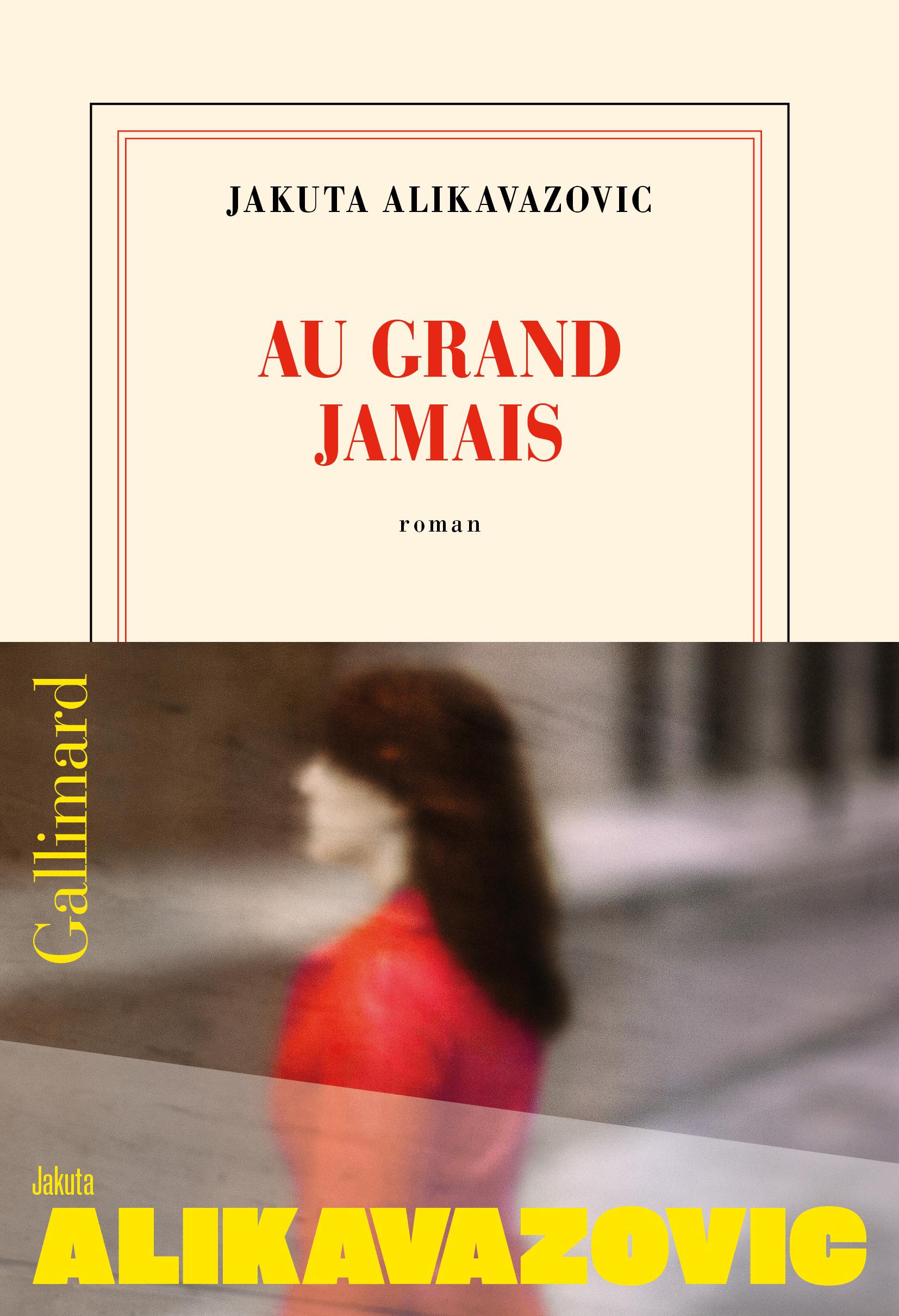
Au grand jamais
Jakuta Alikavazovic
Gallimard, 256 p.
Roman
Comme un ciel en nous était consacré à son père. Le nouveau livre de Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, serait plutôt, lui, une tentative d’enquête sur sa mère. Lorsque débute le roman, elle vient de mourir. Cette poétesse venue d’ex-Yougoslavie aurait cessé d’écrire en arrivant à Paris. De son écriture singulière, «la narratrice» sème le trouble: fiction? Autofiction? Avant tout un texte libre et étourdissant sur les liens familiaux, oui, mais aussi sur les rapports de classe, les pouvoirs de la littérature, l’histoire et les histoires –celles qu’on se raconte, celles qu’on tait.
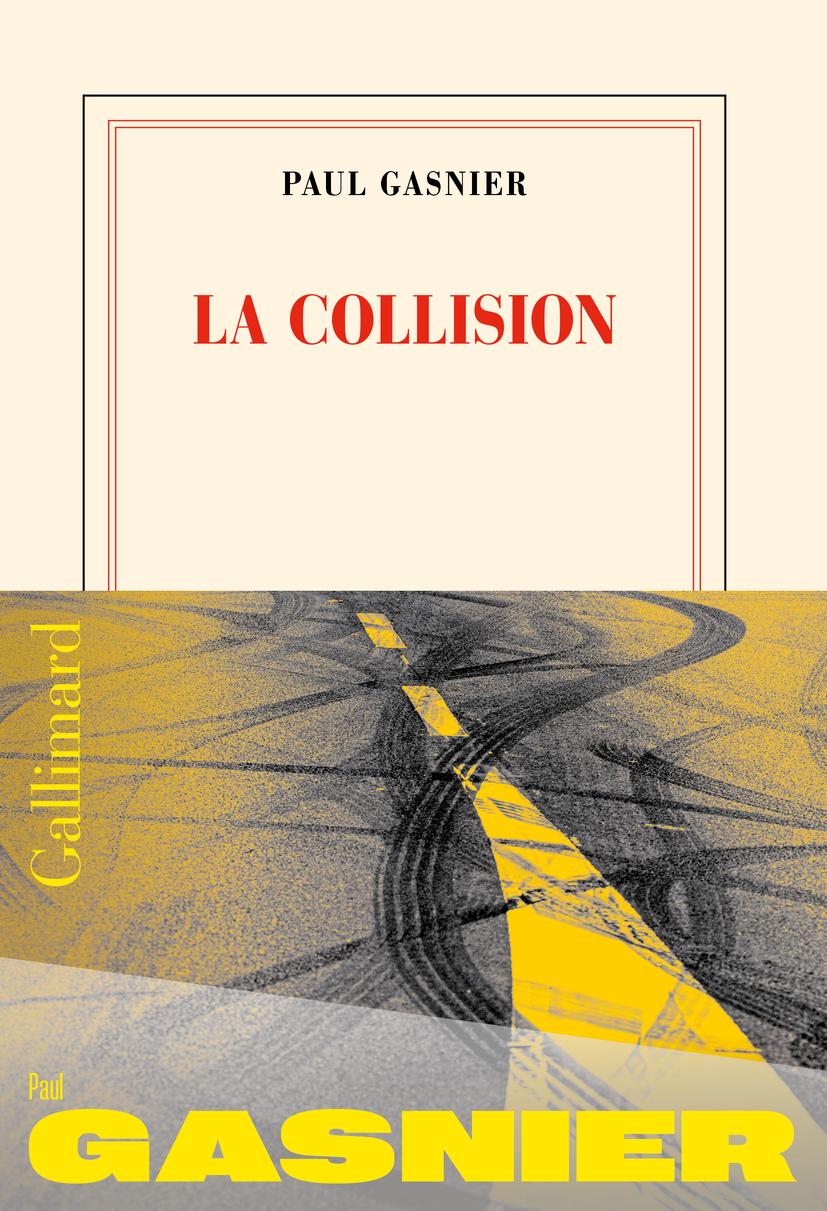
La Collision
Paul Gasnier
Gallimard, 176 p.
Récit
«J’aurais pu m’approprier leur “ça suffit”. Mon passé m’y autorise.» La Collision débute in media res dans un meeting d’Eric Zemmour. L’auteur, Paul Gasnier, également journaliste, y couvre l’événement comme une fatalité, cette «normalisation» de la pensée d’extrême droite qui transforme «la colère en conviction et le ressentiment en intransigeance». Cette colère, Gasnier la connaît, elle l’habite depuis la mort de sa mère, dix ans plus tôt, dans une rue de la Croix-Rousse à Lyon, percutée par Saïd, un délinquant récidiviste juché sur une moto-cross. On pourrait réduire les protagonistes de ce fait divers aux archétypes qu’ils représenteraient sur les plateaux des chaînes d’info, le «jeune en roue arrière» contre la prof de yoga, symbole de la gentrification.
On pourrait faire du fait divers un fait de société, du courroux un bulletin de vote. Mais on peut aussi en faire un geste littéraire, afin de «réinjecter de l’humain dans des histoires manichéennes». C’est ce que s’emploie à explorer Paul Gasnier, cherchant à comprendre sans pour autant excuser, non pour trouver une morale à l’histoire mais pour identifier pourquoi cette histoire parle de sa famille mais aussi de son pays, pourquoi «une vie comme celle de Saïd nous raconte». C’est toute une généalogie de la violence qui apparaît quand on lève le voile sur le passé de Saïd, quand on tente de mettre à jour les déterminismes et les circonstances qui mènent au geste fatal. A l’instar de tout un pan de la littérature nourrie de l’art de la non-fiction anglo-saxonne, une écriture à la première personne qui sans pour autant être autobiographique pense le rapport du «je» au monde pour mieux le décrire dans son époque, La Collision offre un puissant récit contemporain où l’accident du titre figure une forme de faillite collective.
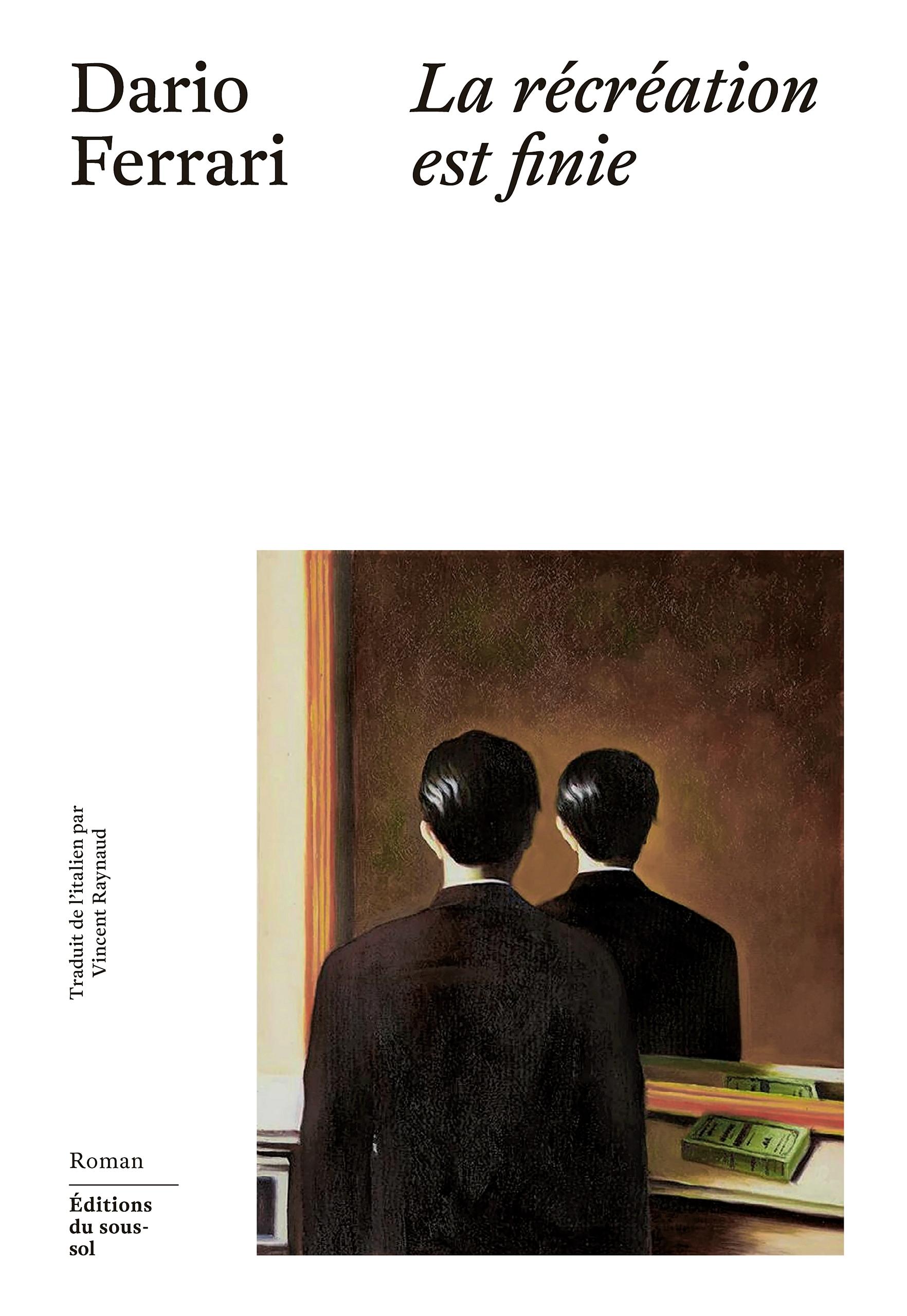
La récréation est finie
Dario Ferrari
Editions du sous-sol, traduit de l’italien par Vincent Raynaud, 148 p.
Roman
Marcello est un étudiant trentenaire un rien dilettante de Viareggio, en Toscane. Afin d’échapper à un avenir tout tracé (reprendre le café de son père), il obtient une bourse de doctorat. On lui propose de la consacrer à Tito Sella, terroriste des «années de plomb» mort en prison. Marcello va s’identifier à lui et développer une véritable obsession pour La Fantasima, son hypothétique autobiographie perdue. Le deuxième roman de Dario Ferrari (le premier traduit en français) est une double immersion drôle et captivante, à la fois dans le farouche petit monde universitaire et dans les méandres des furieuses «années de plomb».
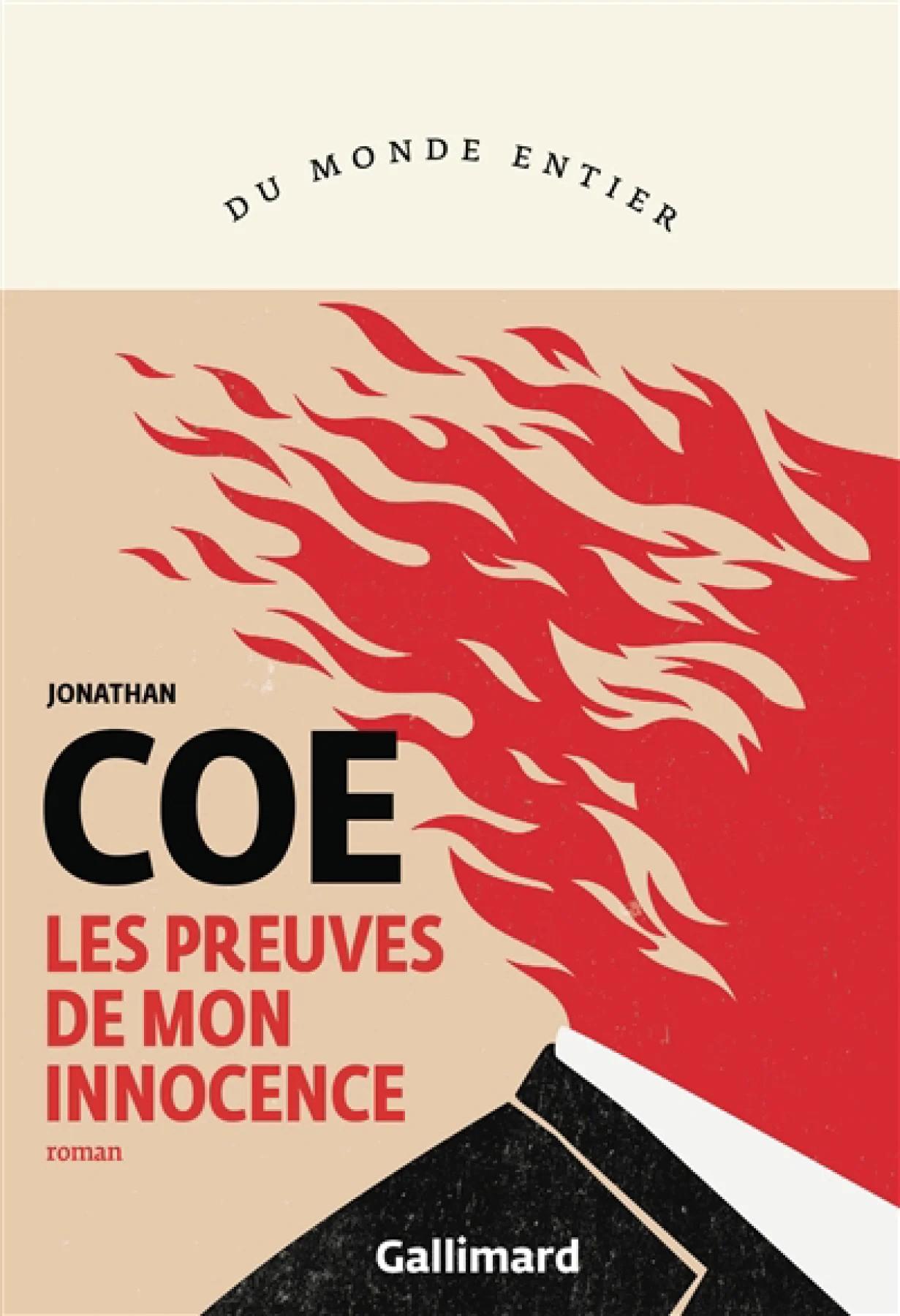
Les preuves de mon innocence
Jonathan Coe
Gallimard, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle, 480 p.
Roman
Que les fans des livres de Jonathan Coe se réjouissent: son regard sur son pays adoré est toujours aussi acéré que délicieusement ironique. Une fois encore, la valse de ses personnages maladroits, empêtrés dans des imbroglios personnels met en musique les grands courants qui traversent la société britannique. Au programme de ce rendez-vous régulier donné par le romancier avec la Grande-Bretagne, la résurgence d’une droite extrême validée par l’establishment, un manuscrit retrouvé, des universitaires sur le retour, des digital natives nostalgiques, et même, un meurtre.
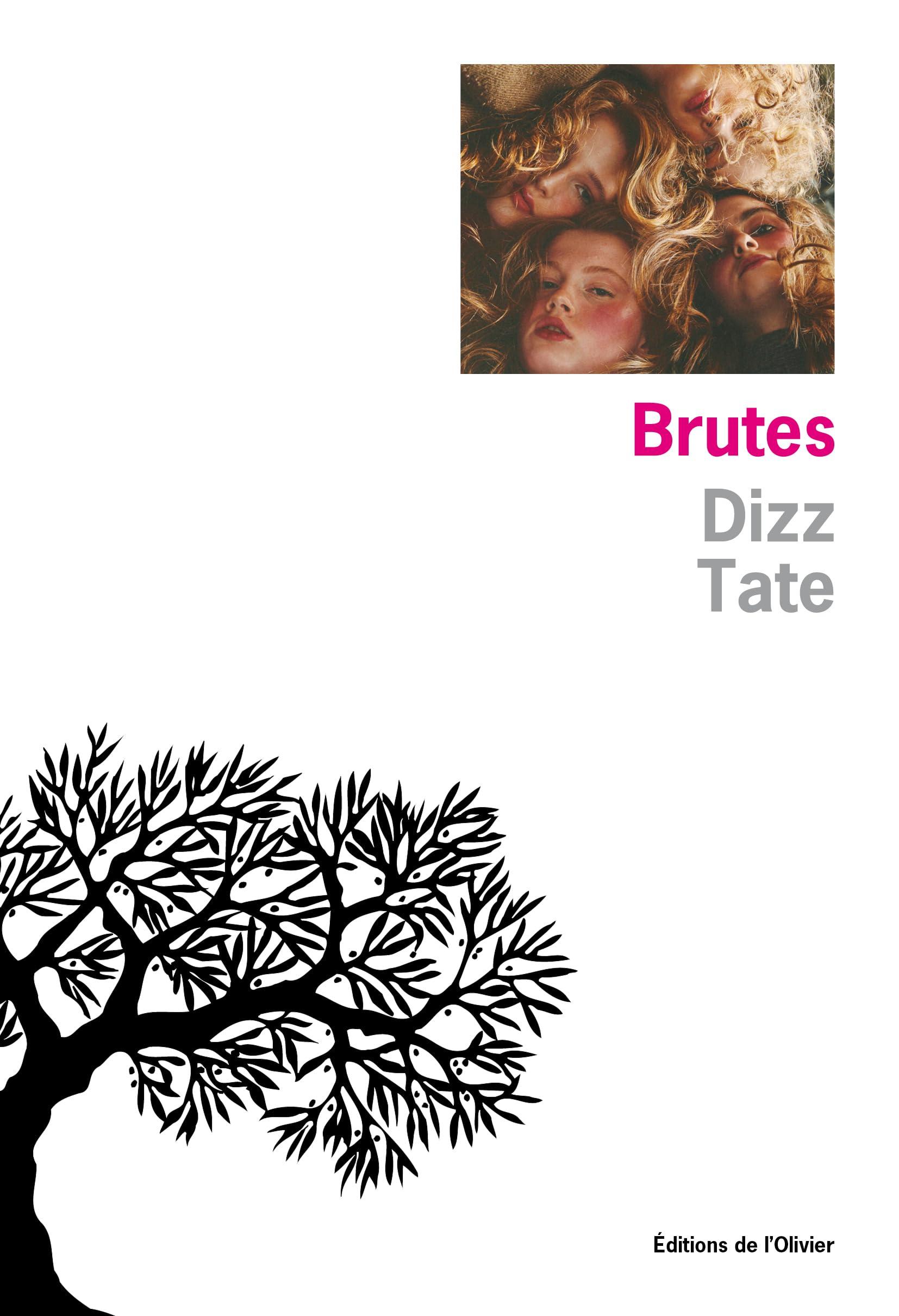
Brutes
Dizz Tate
Editions de l’Olivier, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Madeleine Nasalik, 272 p.
Premier roman
L’adolescence n’en finit pas de s’inviter dans les livres. Nouvelle venue sur la scène romanesque, Dizz Tate en saisit parfaitement les mystères et l’ambivalence. Depuis leurs fenêtres, une bande de gamines, mi-pestes, mi-pétroleuses, observent le manège amoureux du trio magnétique du bahut. Lorsque Sammy, fille d’un télévangéliste célèbre, disparaît, c’est l’émoi, la porte ouverte à tous les scénarios, y compris fantastiques, et le début brutal pour Leila, Britney et consœurs de la fin de l’innocence. Du Virgin Suicides sous le soleil écrasant de Floride.
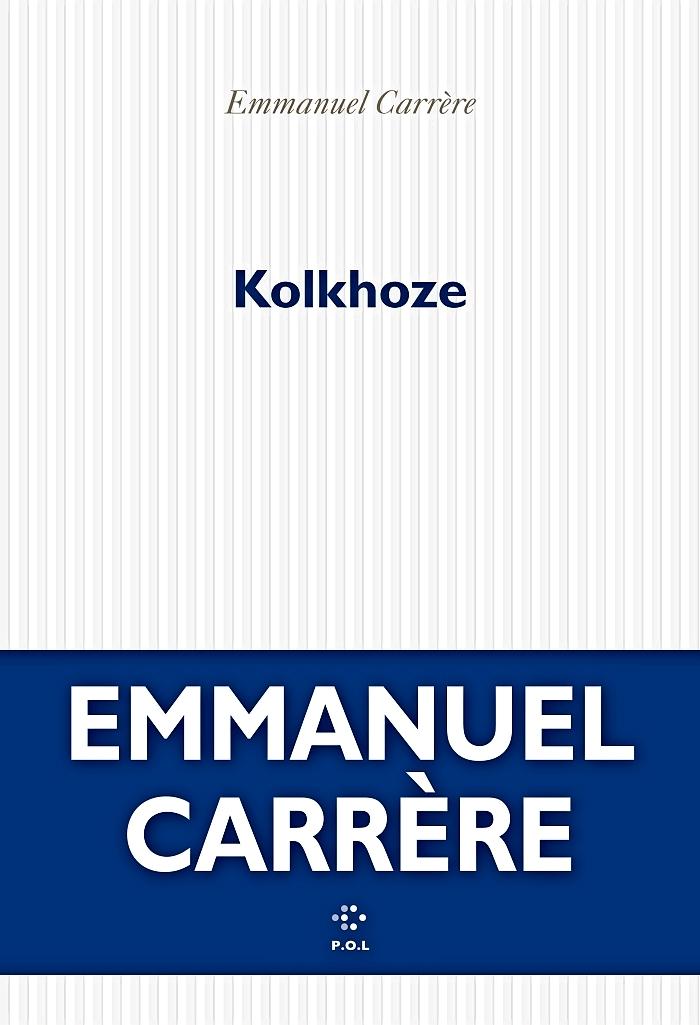
Kolkhoze
Emmanuel Carrère
P.O.L., 560 p.
Roman vrai
Difficile en cette fin d’été de passer à côté d’Emmanuel Carrère, qui multiplie les unes de journaux et fait l’objet de toutes les attentions pour son nouveau roman, Kolkhoze. Il faut dire qu’après avoir raconté avec acuité tout aussi bien sa vie que celles d’autres, il se penche sur un personnage ô combien charismatique, sa propre mère, Hélène Carrère d’Encausse, née Zourabichvili, actrice par sa destinée d’un siècle d’histoire russe et française, nous entraînant de la révolution bolchévique à la guerre en Ukraine.
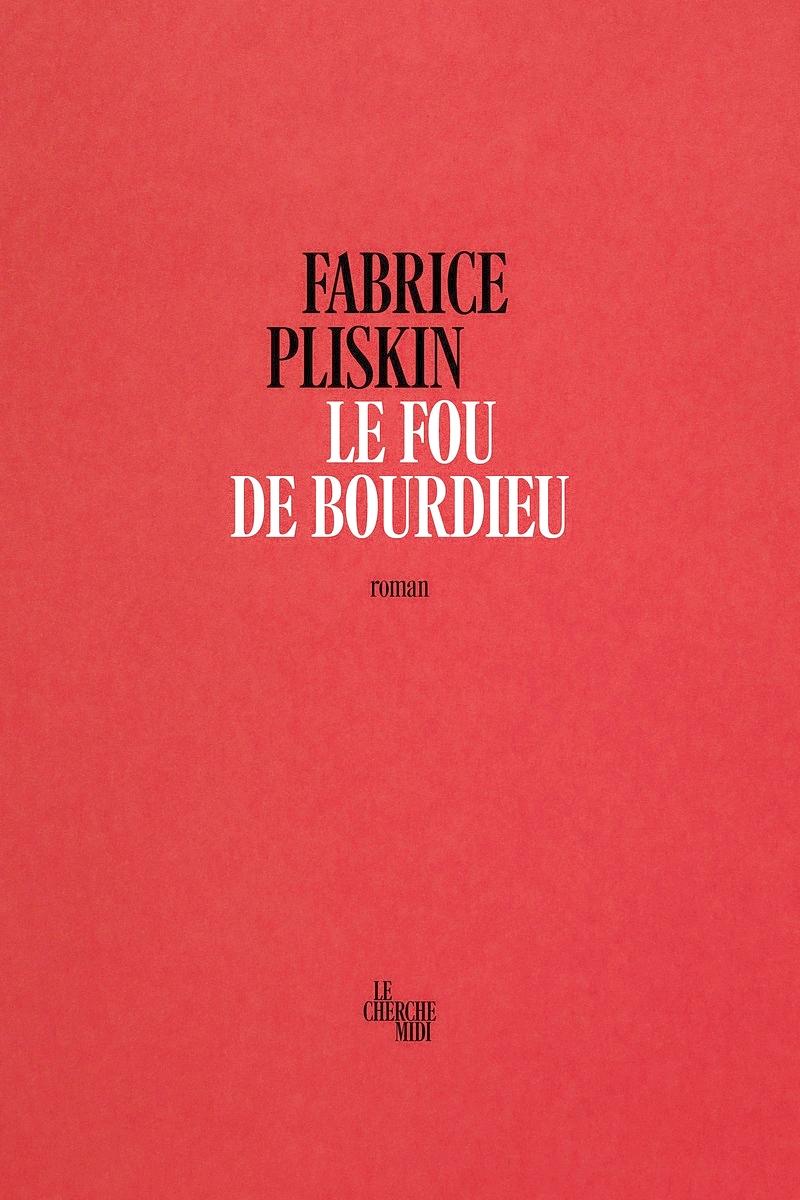
Le Fou de Bourdieu
Fabrice Pliskin
Le Cherche Midi, 496 p.
Roman
Après avoir tué accidentellement un des braqueurs de sa bijouterie, Antonin Firmin écope de huit ans de prison et devient un symbole de l’autodéfense. Au milieu des forces obscures, l’assassin de Chamseddine fait profil bas, découvre la sociologie. Assis au bout de son lit, Pierre Bourdieu semble vouloir l’absoudre: «Ne dites jamais: c’est ma faute. Dites: c’est la faute aux forces systémiques.» C’est une révélation: l’idée de domination fait le lit de son ressentiment. Ivre de gratitude, le pauvre hère s’y réfugie. Après avoir purgé sa peine, à 51 ans, celui qui se fait désormais appeler Antonin Suburre croise la route d’un autre Chamseddine. Suburre y voit un signe, prend sous son aile ce «garçon tragique venu de l’autre côté du périphérique», veut devenir sa bonne fée pour l’affranchir du joug des dominants. Ils deviendront les fugitifs les plus recherchés de France…
Sondant une humanité tragique et boiteuse (xénophobie, apologie de la vengeance, mépris de classe), Pliskin dynamite les rouages du livre-enquête. Abasourdi, le lecteur assiste à la radicalisation d’un daron au physique de mannequin senior, mi-prophète, mi-diva. Une «bête d’ubiquité», le nez dans La Sociologie pour les nuls et une montagne de coke. Emphase et mythomanie, Suburre incarne l’homme capharnaüm, un agité du bocal où macère le vermouth frelaté des pensées conspirationnistes. Etre diminué sous imper VRP, ce lecteur dévoyé de Bourdieu oscille entre le Jean Carmet de Comment réussir quand on est con et pleurnichard et la faconde d’un Jean-Pierre Marielle dans Les Galettes de Pont-Aven. Graphomane invétéré, adepte d’un voguing verbal, le ventriloque usurpateur prône un «Bataclan contre les dominants» pour déboulonner «la fable enchanteresse de la méritocratie». Face à lui, outre son pupille semi-grossiste dans le cannabis, Pliskin oppose un journaliste dépressif incarnant son double quantique. Echantillonnant critique radicale et langage de la street, anthropologie de l’abject et métaphysique du Pascal Praud, Fabrice Pliskin signe une épopée hallucinée, à l’ironie féroce. Un brûlot sauce samouraï entre Fight Club et le Houellebecq d’Extension du domaine de la lutte. «Moi aussi, j’ai fait du sale.» Stupéfiant!
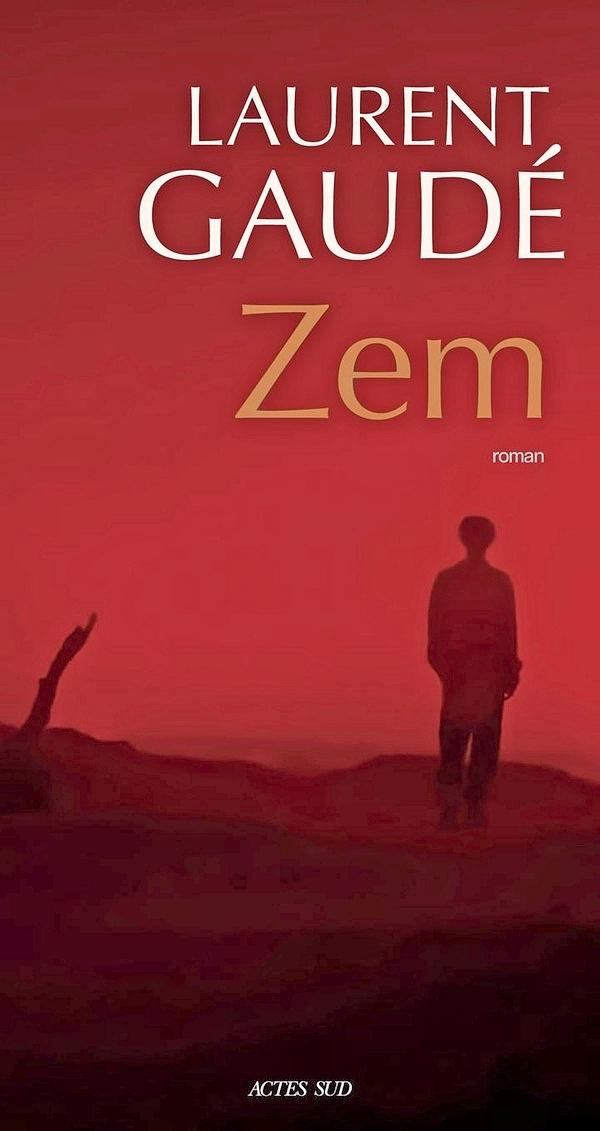
Zem
Laurent Gaudé
Actes Sud, 288 p.
Anticipation
Zem Sparak est de retour, et il n’est pas content. Ce flic grec, devenu «Chien», matricule 51, dans une Athènes et un pays en faillite rachetés et exploités par le consortium international GoldTex (Chien 51, Actes Sud) assure désormais la sécurité rapprochée de Barsok, un homme peut-être providentiel s’il n’y avait la découverte d’un conteneur avec cinq cadavres torturés à l’intérieur. Laurent Gaudé, tout-terrain et ancien prix Goncourt (Le Soleil des Scorta), frappe fort et juste avec cette dystopie entre Blade Runner et 1984.
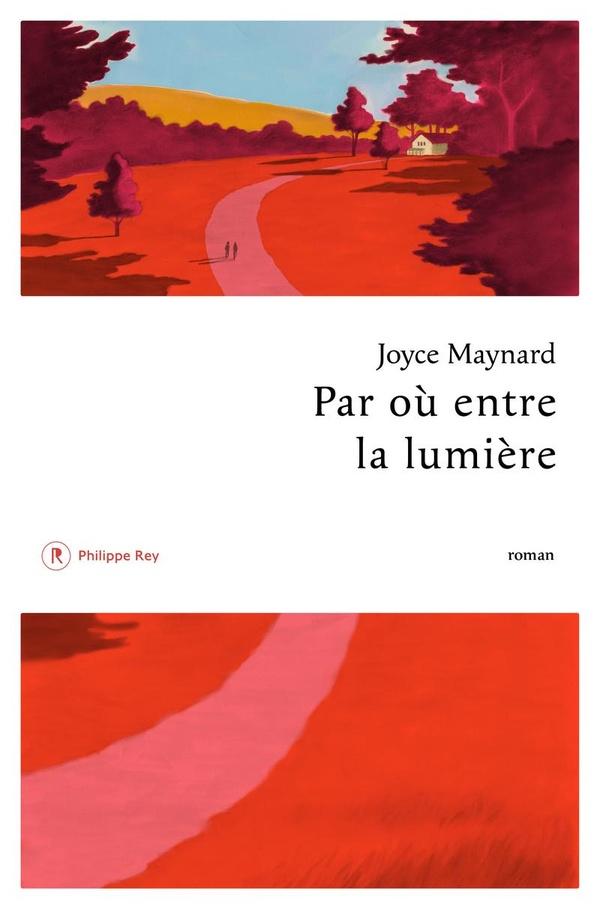
Par où entre la lumière
Joyce Maynard
Philippe Rey, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Florence Lévy-Paoloni, 624 p.
Roman
Quatre ans après le déjà bouleversant Là où vivaient les gens heureux, Joyce Maynard retrouve Eleanor et sa famille, dont l’évolution offre un portrait incarné des transformations de la société américaine au début du XXIe siècle. Malgré l’envergure du récit (plus de 600 pages), l’autrice met son talent de conteuse hors pair, et sûrement un peu sa propre vision du monde, au service d’Eleanor dont le regard, affûté par les épreuves et la vie qui passe, sur la difficulté et la beauté d’être mère aujourd’hui fourmille de fulgurances et de traits de lumière.
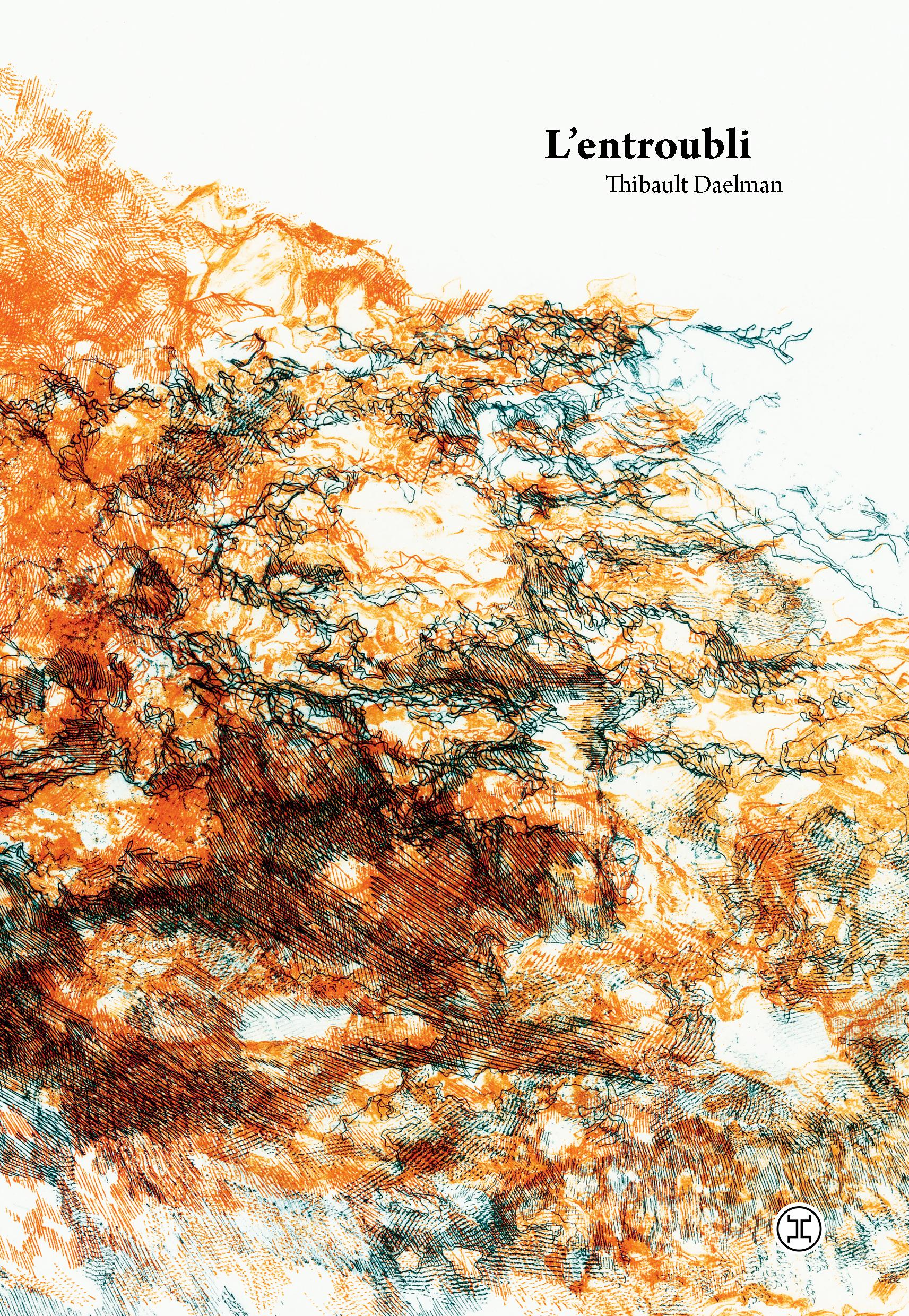
L’Entroubli
Thibault Daelman
Le Tripode, 288 p.
Premier roman
Au milieu des barres d’immeubles orange règne un vacarme assourdissant. «La cour, l’immeuble, l’étage crient. Et nous, on rentre au cri.» Dans l’appartement, loin de s’estomper sous le désordre, le tumulte gronde plus fort. Les insultes proférées par une mère despote recouvrent le mutisme d’un père en perdition, alcoolique et absent. Au milieu du chaos qui tient lieu de milieu, les cinq frères s’exécutent: «Il ne fallait aimer qu’elle.» D’une langue déliée, chahutée par la vie, Thibault Daelman brosse les remous d’une cellule familiale étouffant sous les dettes et le ressentiment. De l’enfance à la majorité, son narrateur à la fois timide et extraverti, sage mais rêveur, enregistre tout. L’arrivée de Thierry, l’amant jardinier et orphelin, transfigure la mère et adoucit la vie… Mais l’accalmie ne dure qu’un temps, déjà pointe l’adolescence, confiée au collège public. En bordure de périphérique, «La poubelle» constitue la destination finale des exclus du tout-Paris. Débute alors la fréquentation urticante des condisciples, l’évitement des petits caïds et des filles, terrifiantes. Et puis, toujours, ce regard flottant, cette marque d’exclusion qui colle à la peau, «cette différence qu’on m’inventait et qui s’appelait “pauvreté”.»
Pour s’échapper, il y a les séjours chez la tante et l’oncle, oasis heureux où grappiller devant l’ordinateur le refuge d’un temps préservé. Passionné par la littérature, saoulé de poésie, l’adolescent se trouve une place dans l’écriture, goûte au vertige de l’émancipation. Sur l’écran, frénétiquement, se dépose la mue d’une enfance où déjà on ne se reconnaît plus. Entre ferveur et silences, alternant le lyrique et le sec, Thibault Daelman fait battre le pouls d’une langue sur le fil, au bord des gouffres, où «les journées sont des époques» quand aucun âge ne vous va. Adepte du parcœurisme (apprentissage de poèmes par cœur), le primo-romancier fait claquer formules poétiques et captation de la tchatche («ça nique les mères, les grands-mères et, surtout, les races»). Porté par un flow particulièrement «sonore», ce premier élan autobiographique révèle une voix qui empoigne comme elle étreint. «On habite sa honte quand le bas de rayon devient trop cher.»

Le monde est fatigué
Joseph Incardona
Finitude, 224 p.
Roman
Depuis qu’elle n’a plus de jambes, Nathalie a choisit de se faire appeler Eve, «parce que dans rêve, il y a Eve». Et Eve, depuis, est devenue une sirène, qui parcourt le monde d’aquariums en océans avec sa queue en silicone, pour, peut-être, rééquilibrer les comptes et assouvir sa vengeance. Que la tristesse est puissante dans les mots de Joseph Incardona et dans le sillage de sa sirène fracassée, revisite tragique d’un mythe à la narration brillante, chez un éditeur qui n’aura jamais si bien porté son nom. «Ce n’était pas mieux avant. C’est pire maintenant.» Mais ça fait partie des livres à lire d’urgence.
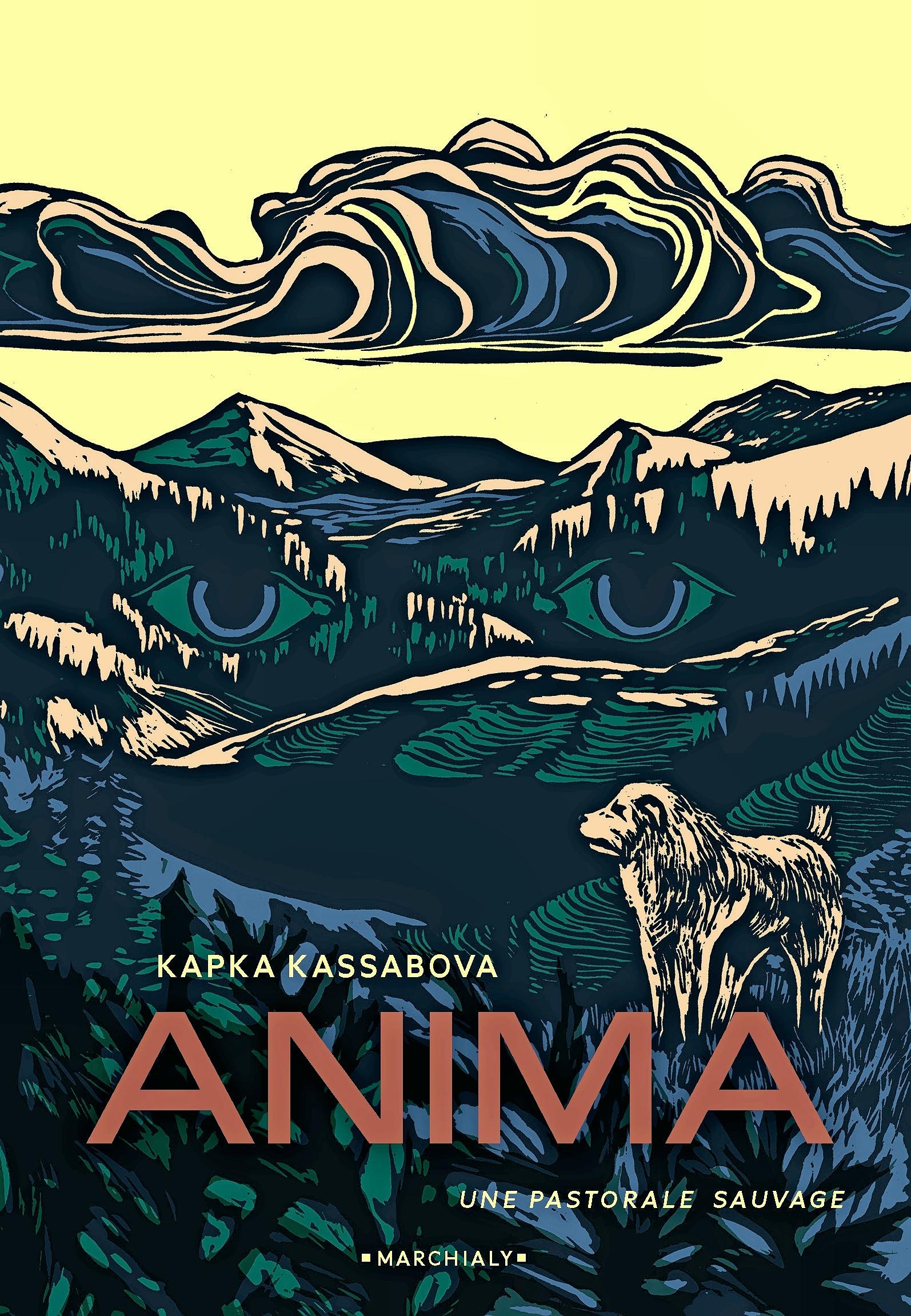
Anima
Kapka Kassabova
Marchialy, traduit de l’anglais par Morgane Saysana, 544 p.
True fiction
«Un matin, je découvris un seau de viande crue dans la douche.» Tel sera le quotidien –surprenant et très, très éloigné du nôtre, pauvres citadins sédentaires– de l’autrice Kapka Kassabova, d’origine bulgare mais écrivant en anglais, tout au long de son séjour sur les hauts plateaux des montagnes de son pays, en compagnie d’une population dévouée aux chiens, chevaux, moutons qui assurent leur survie. Une vie pastorale et de transhumance qui lui permet aussi de «regarder le monde en train de brûler», et de s’interroger sur notre rapport au vivant –il y a du boulot, et donc beaucoup de pages.
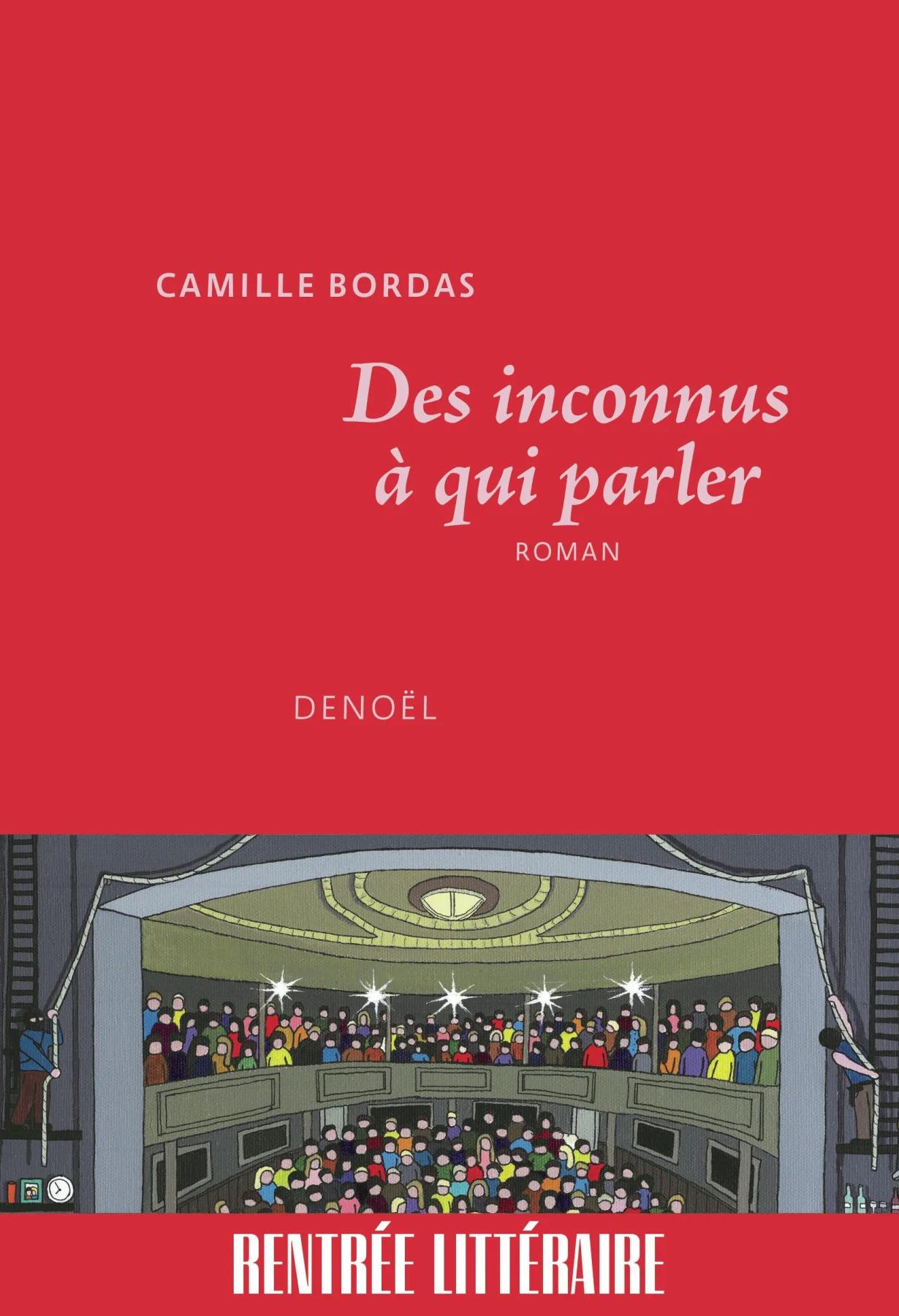
Des inconnus à qui parler
Camille Bordas
Denoël, 448 p.
Roman
Ils sont une poignée inscrits au master de stand-up de l’université de Chicago. Obnubilés par le fait de transformer toute idée en sketch, profs et étudiants partagent la même hantise: que quelqu’un écrive la même blague, plus vite, mieux, voire même «en pire». Ce soir, la fine équipe s’apprête à affronter la troupe de Second City, prestigieuse école d’improvisation… Mais le sujet qui occupe toutes les discussions, c’est l’arrivée imminente de Manny Reinhardt au titre de professeur invité. Après avoir frappé un confrère, le comédien star a été visé par des témoignages de femmes évoquant une «inconduite émotionnelle». L’arrivée de l’humoriste misanthrope divise le campus.
Scène, talk shows, plateformes… Depuis l’explosion du stand-up, la figure de l’humoriste truste tous les plateaux et ne cesse d’engendrer une concurrence accrue. Anthropologue spécialiste de l’histoire de l’art, Camille Bordas plonge au cœur de la fabrique du rire pour en disséquer les codes. A travers la reconnaissance de ses pairs et du public, le comique se coltine l’inconscient de la société, le moteur de la honte, au gré des fluctuations du baromètre social: «[…] les humoristes ne pourraient bientôt plus faire de blagues sur les humains s’ils voulaient éviter le scandale, et il faudrait donc se rabattre sur d’autres espèces». Dans un ample mouvement choral, le temps d’une journée, l’écrivaine française exilée aux Etats-Unis brasse les contradictions d’une époque qui se saoule d’irrévérence tout en s’offusquant de tout et son contraire. «Prêts à tuer pour une vanne», ses humoristes se débattent à chaque instant avec leurs angoisses (même lors d’une alerte attentat sur le campus) pour tirer la substantifique moelle de leur futur matériel. S’attachant à la confection de la partie immergée de l’iceberg, l’obsession du texte, Bordas se demande si le stand-up a détrôné la forme romanesque pour se consoler du monde. Langue pendue (aussi volubile que son sujet), grinçant comme l’était l’humour borderline d’Andy Kaufman, ce buvard acide évoque les premiers Bret Easton Ellis revus par Louis C.K. Pour public averti, donc? «Tu ne racontes que des blagues. –Je raconte des histoires.»
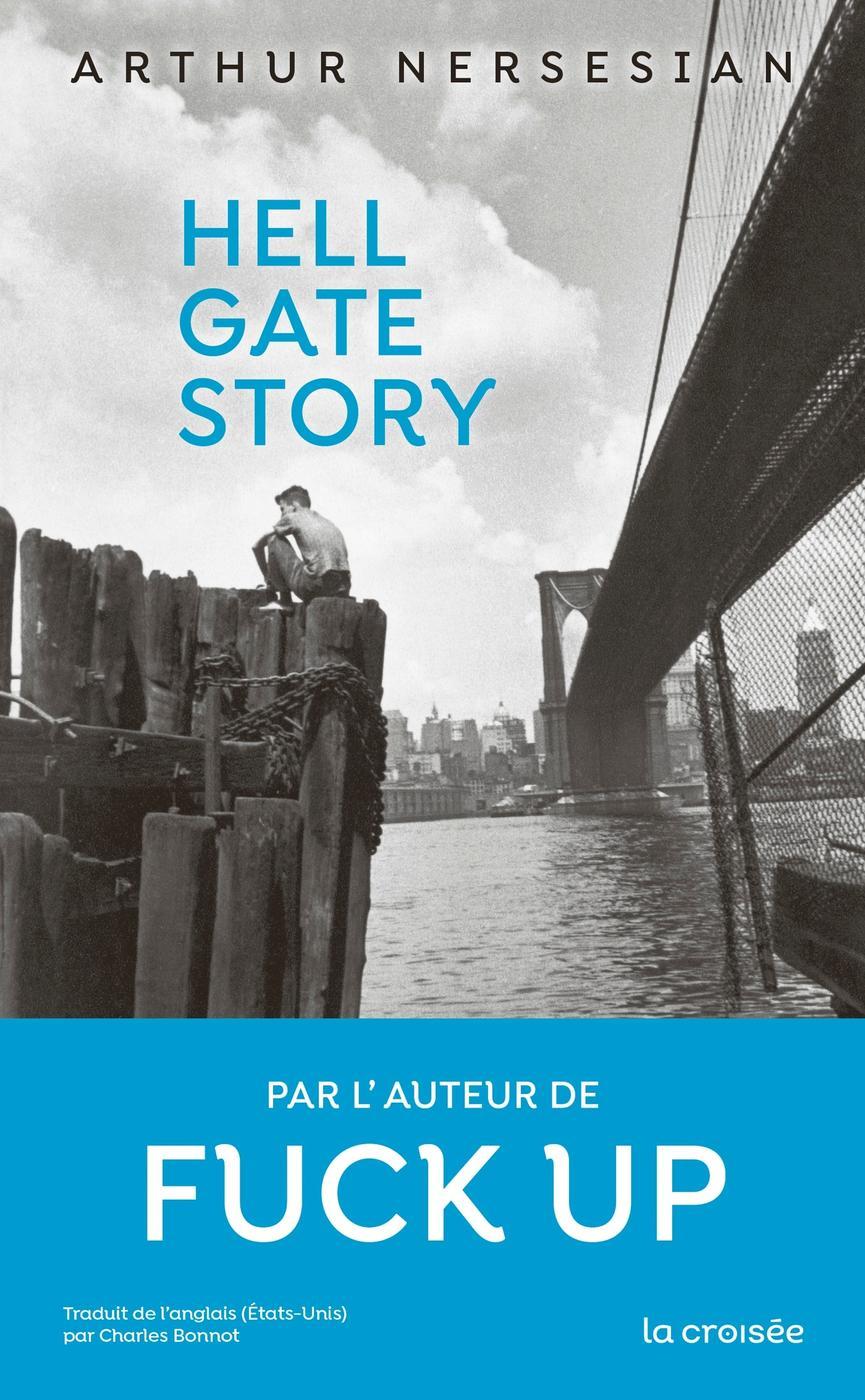
Hell Gate Story
Arthur Nersesian
La Croisée, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Bonnot, 320 p.
Roman
«Quelle était cette atroce variété d’amour qui rendait certaines personnes attirantes dès lors qu’elles étaient condamnées?» On n’en sait rien, mais c’est bien dans cet enfer qu’Orloff Trenchant a sauté à pieds joints. La condamnée, c’est Rita, une blondinette sexy en diable capable de citer Shakespeare ou T.S. Eliot à l’envi, qui s’avérera aussi être une junkie invétérée… La vie d’«Or» est pourtant assez compliquée comme ça: depuis que sa compagne, June, l’a quitté pour un collectionneur richissime, ce modèle d’artiste bohème dort dans son van pourri. S’il ne vend pas des livres dans la rue, il court les galeries pour rester dans le circuit. Quand il lui reste un peu de temps, tout de même, il peint…
Youpi!, un nouveau texte inédit en français d’Arthur Nersesian! Par chez nous, le monsieur est devenu –un brin en retard, certes (son premier succès, Fuck Up, traduit en 2023, fut publié en 1997 aux Etats-Unis)– un des chouchous des lettres US. Un rapide détour par Wikipédia, et nous voilà rassuré: des livres de Nersesian à traduire en français, il en reste une flopée, ouf!
Avec Hell Gate Story, nouvelle ode à «la grosse pomme», nous voici cette fois au tout début des années 2000. «La passion, les retournements, les manigances et les paris risqués étaient ce qui faisait que la vie méritait d’être vécue», affirme Or, le narrateur; car oui, ici encore, la sincérité suinte à chaque page. Tout comme cette tendance quasi héroïque de Nersesian à multiplier les punchlines aussi fatales que Rita, la muse maudite de son pauvre héros. En sinuant inlassablement entre les «sourires contrefaits» du petit monde branchouille de l’art new-yorkais, notre héros se questionne: parviendra-t-il à toucher du pinceau la vérité de son Nageur de l’East River, son probable chef-d’œuvre? La vie nourrit-elle l’art? Est-ce l’inverse? L’essentiel étant sans doute de ne pas s’égarer «sur l’échangeur du New Jersey des décisions à la mords-moi le nœud».
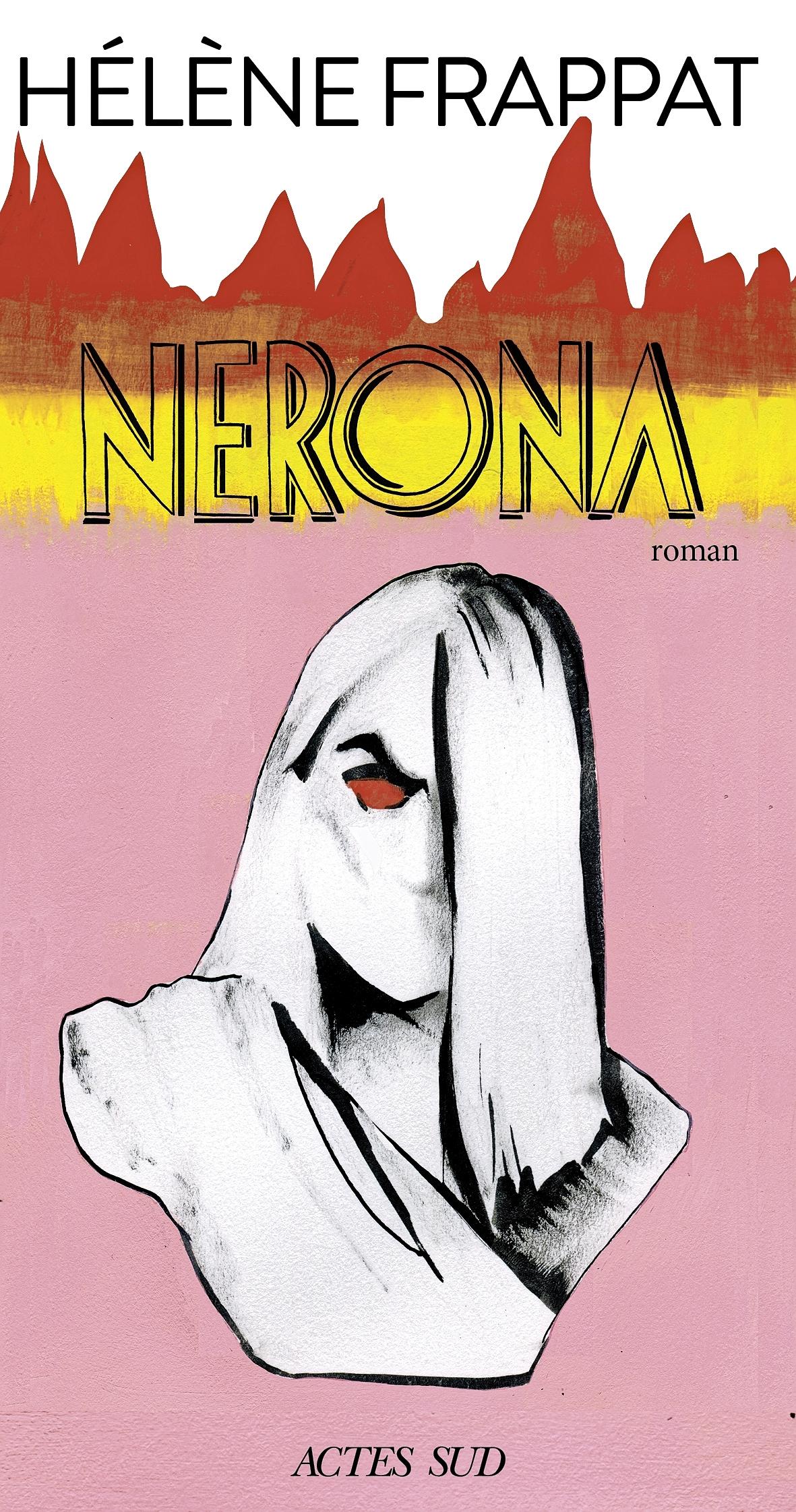
Nerona
Hélène Frappat
Actes Sud, 160 p.
Roman
Hélène Frappat raconte qu’elle était en Italie –«un peu [son] deuxième pays»– au moment où l’on s’apprêtait à y élire un nouveau Premier ministre. Giorgia Meloni l’a emporté. Lorsque l’écrivaine apprend que cette dernière aurait un jour, avec sa sœur, accidentellement mis le feu à l’appartement familial, elle a une révélation: Néron, incendiaire de Rome, est de retour! Cela tourne à l’obsession, à tel point que l’autrice de Trois femmes disparaissent se lance dans l’écriture d’une troublante farce dystopique, logiquement titrée Nerona.
Sans surprise, Nerona, fondatrice du parti du F.E.U. (Force énergie union), est une dictatrice néofasciste. Dans ce pays européen non nommé, «les trains arrivent à l’heure» et ça file droit… Celle qui se fait appeler «Monsieur le Prince» applique une politique populiste et clame ouvertement ses positions: le «neronisme» est climatosceptique, farouchement opposé à la presse et, bien sûr, au «front islamo-wokiste»; entre autres valeurs rétrogrades, il affiche une vision plutôt viriliste du féminisme…
Le texte est un montage de scènes et de points de vue: extrait live de la diffusion télévisée des «Jeux princiers» (sortes de jeux du cirque où des migrants se battent pour leur survie et, peut-être, un titre de séjour), interviews, discours (featuring de la vraie Giorgia Meloni), indiscrétions familiales de Monsieur le Prince, ou coulisses du tournage du film Le Pont de la vérité (avec Julia Roberts!), référence au pont Morandi de Gênes et à la tragédie de son effondrement en 2018 (dans la réalité)…
Hélène Frappat démonte ici le fameux storytelling politique et son langage, si prompt à brainwasher les masses. Les propos de Nerona sont souvent absurdes (entre autres décrets, elle proclame «l’interdiction des incendies et des éruptions volcaniques»), et on rit –jaune, mais on rit.
Au vu de l’actualité brûlante, le livre ne fonctionnera que moyennement en tant qu’avertissement. On connaît la chanson: la réalité et sa fâcheuse tendance à dépasser la fiction… Mais Nerona a beau suivre une despote prête à tuer père et mère (voire sœur, ici), il n’en est pas moins un texte singulier, à l’humour et à la poésie désespérés.

Les Universalistes
Natasha Brown
Grasset, traduit de l’anglais par Marguerite Capelle, 240 p.
Roman
En plein confinement, une rave illégale dégénère dans une ferme isolée du Yorkshire. Le leader des squatteurs anarchistes qui ont «réquisitionné» le bâtiment pour y installer une communauté autosuffisante –en nourriture et en… cannabis– se retrouve dans le coma. Son agresseur présumé a filé avec un lingot d’or appartenant au propriétaire de la demeure, un trader qui vit à Londres et est suspecté dans la foulée d’être à la tête d’un trafic de stupéfiants. En apparence, un banal fait divers, sauf que comme l’écrit la journaliste freelance qui a mené l’enquête et rencontré tous les protagonistes de l’affaire, cet événement «cache une authentique parabole contemporaine, révélatrice de la fragilité du tissu social britannique, usé jusqu’à la corde par l’implacable force d’abrasion du capitalisme tardif».
Disséquant les ressorts idéologiques des uns et des autres, d’abord sous la plume de Hannah (dont le reportage l’arrache à l’anonymat et à la précarité, symptômes d’une profession sur le déclin), puis en s’attachant au sort particulier de chaque acteur du drame, l’autrice du remarqué et remarquable Assemblage (2023) met peu à peu à nu un système néolibéral à bout de souffle. Personne ne sort indemne de l’entreprise de démolition: ni les militants radicaux, dont l’utopie libertaire se heurte aux élans individualistes, ni le banquier soucieux de retrouver au plus vite son prestige social et dont le cynisme illustre les méthodes d’une caste qui «plutôt qu’agir pour accroître la confiance du public dans le système économique et assurer sa pérennité, [il] a choisi d’accumuler les ressources –s’assurant de rester riche en toutes circonstances», ni Lenny, l’éditorialiste «pitbull» antiwoke qui tire les ficelles dans l’ombre et surfe sur le ras-le-bol des «victimes» de la discrimination positive.
Un roman postmoderne par sa forme déstructurée comme par son fond féroce jouant habilement de l’ambiguïté et du malaise. Tout en interrogeant le pouvoir du langage, à la merci des technolâtres comme des populistes, Les Universalistes disserte allègrement sur l’IA, le déclassement de la classe moyenne ou la crise des médias –qui perdent leur âme dans une quête effrénée de l’attention. «On vous dit ce que vous voulez entendre, tout en vous convaincant que c’est la vérité, racontée de la façon la plus objective possible», résume en une formule choc la provocatrice Lenny. Brillant et accablant.
Envie de davantage de recommandations de livres à découvrir? Rejoignez le club de lecture du Vif sur Facebook, «L’heure de lire»

