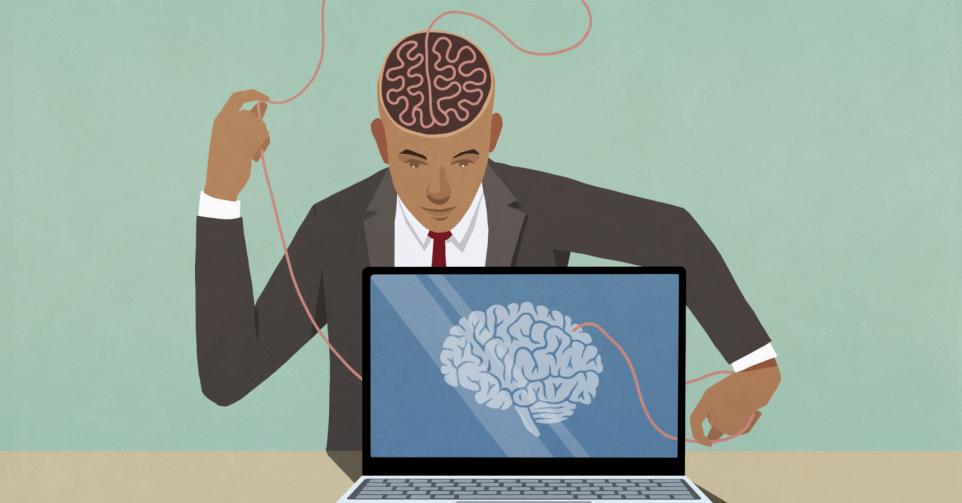Les chercheurs s’accordent sur un point: l’intelligence artificielle peut nuire à la créativité et à la pensée critique. Pourtant, il reste possible de l’utiliser sans se ramollir le cerveau. «Ne sollicitez l’IA qu’en tant qu’assistante enthousiaste, mais un brin naïve.»
Rédiger un essai structuré en vingt minutes ou moins, comme l’exigent certains tests standardisés, suppose un véritable effort intellectuel. Un accès illimité à l’intelligence artificielle allégerait sans doute cette charge mentale. Mais, à en croire une étude récente menée par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), cela pourrait avoir un prix.
Des étudiants ont été invités à écrire des essais au cours de plusieurs séances. Certains bénéficiaient de l’aide de ChatGPT, d’autres non. Tous étaient reliés à un électroencéphalogramme (EEG) enregistrant leur activité cérébrale. Chez les utilisateurs d’IA, l’activité mesurée dans les zones du cerveau liées à la créativité et à l’attention s’est révélée significativement plus faible. Ils avaient également davantage de mal à citer correctement un extrait du texte qu’ils venaient tout juste de rédiger.
Ces résultats s’inscrivent dans un corpus croissant de recherches explorant les effets délétères potentiels de l’intelligence artificielle sur la créativité et les facultés d’apprentissage. Une question se pose alors: les gains spectaculaires à court terme offerts par l’IA générative dissimulent-ils des pertes durables?
«Chez les utilisateurs d’IA, l’activité mesurée dans les zones du cerveau liées à la créativité et à l’attention s’est révélée significativement plus faible.»
L’étude du MIT corrobore les conclusions de deux autres recherches portant sur le lien entre l’usage de l’IA et l’exercice de la pensée critique. La première, menée par Microsoft Research, a interrogé 319 professionnels de la connaissance utilisant l’intelligence artificielle générative au moins une fois par semaine. Plus de 900 tâches ont été analysées, allant du résumé de longs documents à la conception de campagnes marketing.
Travail sans esprit
Sur l’ensemble des tâches décrites, seules 555 nécessitaient, selon les intéressés eux-mêmes, un véritable effort de réflexion critique, comme revoir soigneusement le contenu généré par une IA avant de l’envoyer à un client ou reformuler un prompt après un premier résultat décevant. Les autres étaient jugées largement mécaniques et sans exigence intellectuelle. La majorité des employés ont indiqué que des outils comme ChatGPT, Google Gemini ou Microsoft Copilot leur permettaient d’accomplir ces missions avec un effort cognitif réduit, parfois nettement moindre.
Une autre étude, conduite par le professeur Michael Gerlich de la SBS Swiss Business School, a interrogé 666 Britanniques sur la fréquence à laquelle ils utilisaient l’IA et le degré de confiance qu’ils lui accordaient, avant de les soumettre à une série de questions évaluant la pensée critique, issues d’un test largement répandu. Ceux qui recouraient plus souvent à l’intelligence artificielle ont obtenu des résultats globalement inférieurs. Après la parution de cette étude, plusieurs centaines d’enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur ont contacté Michael Gerlich. Tous déclaraient: «C’est exactement ce que nous vivons actuellement.»
Savoir si l’IA affaiblit durablement l’activité cérébrale reste une question ouverte. Les trois études soulignent l’urgence d’approfondir la recherche pour établir, le cas échéant, un lien de causalité entre un usage intensif de ces technologies et une diminution des capacités mentales. Dans l’enquête de Michael Gerlich, il demeure par exemple possible que les individus dotés d’un esprit critique plus affûté soient tout simplement moins enclins à recourir à l’IA. Quant à l’étude du MIT, elle repose sur un échantillon limité et se concentrait sur une tâche bien spécifique.
«Externalisation cognitive»
A l’instar de nombreuses technologies, les outils d’IA générative ont été conçus pour alléger la charge mentale. Dès le Ve siècle avant J.-C., Socrate se plaignait déjà que l’écriture n’était pas un «moyen de se souvenir», mais simplement «un rappel». Les caissiers n’ont plus à effectuer de calculs grâce aux machines. Les applications de navigation ont remplacé les cartes. Pourtant, nul ne soutient que ces évolutions aient rendu les individus moins compétents.
Rien n’indique clairement que le fait de déléguer certaines fonctions mentales à des machines altère les capacités intellectuelles fondamentales, observe Evan Risko, psychologue à l’University of Waterloo. Avec son collègue Sam Gilbert, il a introduit le concept d’«externalisation cognitive» pour désigner la tendance à confier à des outils externes les tâches mentales perçues comme ardues ou fastidieuses.
Ce qui l’inquiète, c’est que l’IA générative permette désormais de déléguer «un ensemble de processus bien plus complexes». Remplacer un calcul mental n’équivaut pas à déléguer à une machine la réflexion, la rédaction ou la résolution de problèmes. Une fois cette logique installée, le cerveau s’y accoutume, et l’habitude devient difficile à désapprendre. Cette préférence systématique pour la solution la plus simple –désignée comme «paresse cognitive»– tend à s’autoalimenter. Plus la dépendance à l’IA augmente, plus la pensée critique devient laborieuse. L’activité cérébrale s’émousse, et le recours à l’IA s’intensifie encore. Un participant à l’étude de Michael Gerlich a déclaré: «J’ai une telle confiance dans l’IA que je ne serais plus capable de résoudre certains problèmes par moi-même.»
«Plus la dépendance à l’IA augmente, plus la pensée critique devient laborieuse. L’activité cérébrale s’émousse, et le recours à l’IA s’intensifie encore.»
Compétitivité affaiblie, créativité en berne
De nombreuses entreprises guettent avec empressement les gains de productivité que l’IA pourrait leur procurer. Ce succès potentiel n’est toutefois pas sans contrepartie. «Si la pensée critique décline à long terme, cela conduira probablement à une compétitivité moindre», observe Barbara Larson, professeure de management à la Northeastern University.
Un recours prolongé à l’intelligence artificielle risque également d’éroder la créativité des collaborateurs. Dans une étude menée à l’Université de Toronto, près de 460 participants devaient imaginer des usages originaux pour des objets familiers, comme un pneu ou un pantalon. Ceux à qui l’on avait d’abord présenté des suggestions générées par IA ont ensuite formulé des réponses moins inventives et moins diversifiées que ceux ayant réfléchi seuls.
Pour le pantalon, le chatbot avait par exemple proposé de le remplir de paille afin d’en faire un épouvantail –ce qui revient, en somme, à lui conserver sa fonction initiale. A l’inverse, un participant non assisté par IA avait imaginé glisser des noisettes dans les poches afin d’en faire une «mangeoire à oiseaux».
Stimuler les utilisateurs
Le cerveau peut être entretenu. La professeure Larson recommande de solliciter l’IA uniquement comme une «assistante enthousiaste mais un brin naïve». Michael Gerlich conseille de ne pas lui demander un résultat final, mais de l’impliquer à chaque étape du raisonnement. Plutôt que de poser la question «Où puis-je partir en vacances au soleil?», il suggère de commencer par «Où pleut-il le moins?» et de continuer à partir de là.
Microsoft expérimente des assistants IA capables d’interrompre les utilisateurs par des «stimulations» destinées à encourager une réflexion plus poussée. Des chercheurs des universités Emory et Stanford proposent quant à eux de reprogrammer les chatbots en «assistants de pensée» qui poseraient des questions plutôt que de fournir des réponses toutes faites. Une approche que Socrate aurait sans doute saluée.
«Microsoft expérimente des assistants IA capables d’interrompre les utilisateurs par des “stimulations” destinées à encourager une réflexion plus poussée.»
Ces stratégies se révèlent toutefois, dans la pratique, pas toujours efficaces –même lorsque les concepteurs de chatbots complexifient ou ralentissent volontairement leur interface. Certaines peuvent même produire l’effet inverse. Une étude menée par l’Abilene Christian University, au Texas, a montré que des assistants IA envoyant en permanence des «stimulations» nuisaient aux performances des programmeurs les plus faibles lors de l’exécution d’une tâche de codage simple.
Contraintes cognitives
D’autres approches visant à maintenir l’activité cérébrale sont plus directes, mais également plus contraignantes. Les utilisateurs les plus assidus pourraient être tenus de proposer d’abord leur propre réponse ou d’attendre quelques minutes avant d’accéder à l’IA. Selon Zana Buçinca, chercheuse en IA chez Microsoft, ces «mesures de contrainte cognitive» pourraient améliorer les résultats.
Mais elles restent impopulaires. «Les gens n’aiment pas être forcés de réfléchir», observe-t-elle. Les tentatives de contournement seraient sans doute nombreuses. Dans une enquête représentative menée dans seize pays par le cabinet de conseil Oliver Wyman, 47% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles continueraient d’utiliser les outils d’IA même si leur employeur en interdisait l’usage.
La technologie étant encore très récente, le cerveau humain demeure –pour l’instant– l’outil le plus affûté dans bien des domaines. Mais à terme, utilisateurs comme décideurs devront évaluer si les avantages de l’IA compensent ses coûts cognitifs. Et si des preuves plus solides confirmaient qu’elle rend effectivement plus stupide, cela suffirait-il à susciter une réaction?