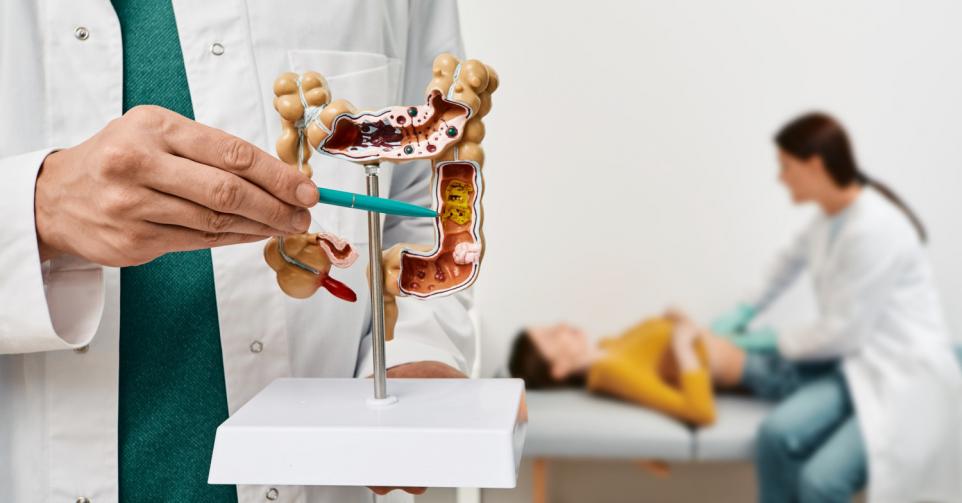Le nombre de Belges souffrant d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) ne cesse d’augmenter. En cause, notamment, les aliments ultratransformés. Douleurs abdominales et diarrhées incontrôlables: ces maladies impactent significativement le quotidien des patients, dont la vie sociale est parfois mise à mal.
Il n’y a plus eu d’étude épidémiologique portant sur le sujet, depuis 30 ans, en Belgique, mais par extrapolation des données européennes les plus récentes, il est estimé à 86.000 le nombre de patients souffrant d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Soit une prévalence de 0,8 cas pour 100 Belges. «Ceux-ci ont à peu près doublé en 30 ans», souligne Edouard Louis, chef du service de gastroentérologie, hépatologie et oncologie digestive au CHU de Liège.
D’ici 2030, approximativement 1% de la population belge pourrait être atteinte de la maladie de Crohn (MC) ou d’une rectocolite ulcéro-hémorragique (RCH). Soit près de 120.000 patients susceptibles de souffrir de douleurs abdominales, de diarrhées fréquentes (parfois hémorragiques), de fissures ou bien d’abcès anaux. L’augmentation des nouveaux cas va se poursuivre chez les plus jeunes, notamment chez les adolescents, prédit le Dr. Louis: «L’incidence des formes pédiatriques ne cesse d’augmenter, alors que le nombre de nouveaux cas chez les adultes s’est stabilisé.»
Hausse des cas dans des pays jusqu’alors épargnés
Si les MICI sont favorisées par les prédispositions génétiques, celles-ci expliquent seulement environ 20 à 30% de la prédisposition, indique l’expert. L’augmentation du nombre de malades, dès les années 1970, est en fait due essentiellement à des facteurs environnementaux, poursuit-il. «L’alimentation ultratransformée, surtout, avec tout ce qu’elle contient d’émulsifiants et de conservateurs, joue probablement un rôle prépondérant dans la hausse des diagnostics. Il y a aussi ce que l’on trouve dans l’eau que l’on boit ou dans l’air que l’on respire, pouvant contenir des microplastiques et des polluants, cite encore le gastroentérologue. Ces éléments contribuent à affaiblir l’équilibre de la barrière intestinale et la rendent plus vulnérable chez des personnes qui sont prédisposées.»
«Ce qui est encore plus invalidant, ce sont les besoins pressants et incontrôlables. C’est un problème majeur au quotidien.»
Les MICI ne sont pas, aujourd’hui, des pathologies dont les patients peuvent guérir. «Une fois que le processus immuno-inflammatoire est déclenché, il s’auto-entretient», indique le Dr. Louis. Les traitements ont néanmoins beaucoup évolué ces vingt dernières années, permettant à une grande majorité des malades de connaître une «rémission parfois profonde». La maladie ne génère plus, ou très peu, de symptômes, et l’intestin ne se dégrade plus.
Cela explique notamment que les cas de MC et de RCH sont surtout recensés dans les pays occidentaux dits «industrialisés». «Il y en a aussi en Afrique, mais nettement moins. Les choses évoluent cependant dans les sociétés africaines qui « s’industrialisent ». Il y a 30 ou 40 ans, il y avait largement plus de cas de tuberculose intestinale que de maladie de Crohn dans les pays du Maghreb, par exemple. Aujourd’hui, c’est l’inverse, pointe Edouard Louis. Mais là où c’est le plus spectaculaire, c’est en Chine et en Inde, où le nombre de malades augmente de façon très nette.»
Les MICI, des maladies à impact social
Les symptômes de la maladie de Crohn et de la rectocolite ulcéro-hémorragique sont presque invisibles pour ceux qui n’en souffrent pas. Pour les autres, ils affectent significativement leur vie sociale. Les symptômes le plus courants liés à ces pathologies sont les diarrhées. «Ce qui est encore plus invalidant, ce sont les besoins pressants, imprévisibles et difficilement contrôlables. C’est l’une des angoisses principales des patients et un problème majeur au quotidien, aussi bien dans leur vie sociale, familiale que professionnelle», confirme le Dr Louis.
La maladie de Crohn a complètement chamboulé la vie de Chloé, 23 ans. C’est en octobre 2023 que l’étudiante infirmière a découvert sa maladie, après trois mois de douleurs inexpliquées. Alors qu’elle attendait son diagnostic, la jeune femme pouvait aller aux toilettes jusqu’à seize fois par jour. «C’était douloureux, j’étais en pleurs, je n’arrêtais pas de maigrir. En un mois, je suis passée de 54 à 47 kg», se souvient-elle. Socialement, sa pathologie a eu des conséquences: «Alors que j’étais jusque-là plutôt celle qui proposait les sorties, je suis devenue assez solitaire.» Elle a aussi retardé sa diplomation. «J’en suis à faire des stages de 3e année tout en suivant les cours de 4e année. Si tout se passe bien, j’obtiendrai mon diplôme en juin 2027.»
Aujourd’hui, grâce à son traitement, Chloé peut se contenter d’un passage aux sanitaires par jour. Ce qui n’est pas le cas de Daniel, 73 ans. L’enseignant retraité a été diagnostiqué de la même maladie lorsqu’il avait 22 ans, deux ans après l’apparition des premiers symptômes. Le septuagénaire a été opéré à quatre reprises: trois fois pour lui retirer des parties de l’intestin grêle, la dernière, à 56 ans, pour un cancer du côlon qui a laissé des séquelles. «Mon côlon n’existe presque plus. Il ne peut donc plus assurer sa fonction de rétention d’eau. Voilà pourquoi j’ai des diarrhées presque en permanence», explique Daniel.

Il poursuit: «Après cette dernière opération, j’ai vécu presque deux ans durant lesquels je devais aller aux toilettes jusqu’à 20 fois par jour. Quand je me déplaçais en voiture, je transportais toujours du papier hygiénique et une lampe de poche avec moi pour pouvoir m’arrêter où je le pouvais. Et avant chaque déplacement, je me renseignais pour savoir si, là où j’allais et sur l’itinéraire, je pourrais utiliser des toilettes.» Aujourd’hui, les diarrhées le forcent à utiliser des sanitaires entre quatre et cinq fois par jour. «C’est beaucoup mieux» qu’avant, philosophe-t-il.
Quand la douleur laisse place à la honte
Chloé et Daniel ne disent pas si ça a été leur cas, mais la plupart de ses patients ont connu au moins une fois un accident d’incontinence, explique Edouard Louis. «Cela fait partie des douleurs sourdes, mais profondes, dont souffrent les malades. Ce sont des choses dont on n’aime pas trop parler, même dans son entourage, poursuit le médecin liégeois. Cela crée un véritable handicap social qui nécessite un travail aussi bien physique que psychologique. La dimension psychologique est malheureusement souvent reléguée au second plan après le traitement de l’inflammation intestinale, alors qu’elle est extrêmement importante.»
«C’était douloureux, j’étais en pleurs, je n’arrêtais pas de maigrir. En un mois, je suis passée de 54 à 47 kg.»
Les diarrhées incontrôlables dont souffrent les patients MICI poussent 60% des malades à éviter «souvent» certains lieux ou activités par crainte de ne pas trouver de toilettes, selon une enquête iVOX pour le compte de l’association Crohn-RCUH. Une crainte justifiée, souligne-t-elle, puisque «la moitié des personnes s’est déjà vue refuser l’accès aux toilettes d’un magasin, d’un restaurant ou d’un autre lieu public».
C’est pourquoi, outre la sensibilisation de la population, l’asbl mène des actions concrètes pour faciliter le quotidien des patients, en cherchant notamment des toilettes qui pourraient rejoindre le «Passe-toilette». Sur présentation de ce pass, les malades peuvent accéder à des sanitaires sans devoir consommer ou payer un droit d’usage, mais aussi d’avoir un accès prioritaire dans les toilettes publiques en cas de forte fréquentation.
Malgré la maladie, «il faut oser sortir. Quitte à se forcer. Le risque, quand on ne sort plus, c’est l’isolement social. On perd ses amis, des occasions de parler d’autres choses, de garder le moral. Faire du sport modérément s’avère aussi très important pour réduire le niveau de stress. Celui-ci ne cause pas la maladie, mais, quand celle-ci s’est installée, il peut contrecarrer une rémission et la transformer à nouveau en état actif», conclut Daniel.