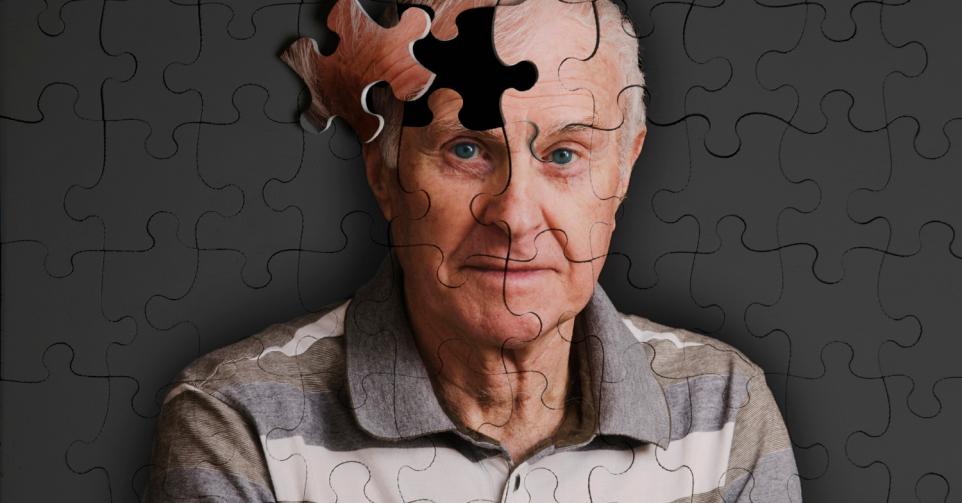Une dépendance à l’alcool, une carence en vitamine B1, et la mémoire s’effondre. Le syndrome de Korsakoff transforme la vie en une succession d’instants déconnectés, où les souvenirs récents disparaissent aussitôt qu’ils apparaissent.
Troubles de la mémoire récente, souvenirs fabriqués pour combler le vide, repères temporels brouillés… Et si c’était le syndrome de Korsakoff? Cette pathologie se caractérise par une amnésie modérée à sévère issue d’une carence prolongée en vitamine B1, dite thiamine, essentielle au métabolisme énergétique des neurones. Cette carence survient principalement chez des personnes en situation de malnutrition ou d’alcoolisme chronique. L’alcool perturbe l’absorption, le stockage et l’activation de la thiamine.
L’épidémiologiste Carole Dufouil, directrice de recherche au Centre Bordeaux Population Health, insiste sur l’importance de s’intéresser à ce trouble. «Le syndrome de Korsakoff est un modèle très parlant des conséquences neurologiques d’une carence prolongée, influencée par une consommation d’alcool à risque. Il montre comment une dénutrition, souvent liée à une dépendance, peut laisser une empreinte irréversible sur la mémoire.» Selon elle, le fait que cette maladie reste peu connue du grand public accentue encore son poids social et sanitaire.
Un quotidien bouleversé par l’amnésie
La mémoire ancienne peut rester intacte, alors que la mémoire récente s’effondre. Un malade oublie ce qu’il vient de dire, pourquoi il a changé de pièce, ou encore l’heure du jour. Pour masquer ces vides, son cerveau fabrique des récits. Ces «confabulations» ne sont pas des mensonges, mais des reconstructions automatiques. L’illusion est parfois si forte que l’entourage s’y trompe.
Le diagnostic repose sur cet ensemble de symptômes: amnésie antérograde profonde (difficultés à créer de nouveaux souvenirs), désorientation et création inconsciente de souvenirs erronés. L’imagerie médicale peut montrer une atrophie de certaines zones du cerveau, mais ce sont surtout les antécédents médicaux et nutritionnels qui orientent les spécialistes dans le diagnostic. Les médecins rappellent qu’en cas de confusion, de troubles de la marche ou de la mémoire chez une personne dépendante à l’alcool, l’administration de thiamine doit être immédiate. Sans ce geste, les lésions deviennent irréversibles.
Une fois installé, le syndrome est incurable. Le patient conserve son langage et parfois son caractère, mais perd l’autonomie nécessaire pour gérer ses repas, ses médicaments ou ses rendez-vous. La prise en charge associe abstinence de substances alcoolisées, prise de vitamine B1, rééducation cognitive et installation d’un environnement structuré et adapté aux effets secondaires du patient.
Carole Dufouil insiste sur la dimension humaine de cette maladie: «La spécificité du syndrome de Korsakoff, c’est que les patients restent présents, parlent, rient, mais qu’ils n’ont plus de continuité temporelle. Ils sont prisonniers d’un présent sans mémoire immédiate. Ce qui rend l’accompagnement particulièrement éprouvant pour les familles».
En Belgique, il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes atteintes. Pourtant, les services de neurologie et d’addictologie décrivent régulièrement de tels cas.
Le KCE, centre belge d’expertise scientifique, a enquêté sur les lacunes de la prise en charge de l’alcoolodépendance, pointant une «absence de traitement sérieux et de considération du problème.» Ses experts ont souligné le besoin de «renforcer le parcours de soins, les compétences spécialisées comme les alcoologues et l’intégration des troubles cognitifs comme le Korsakoff dans les stratégies de soin.»
Sur le terrain, il existe des initiatives émergentes. L’Association Corail est une structure d’hébergement spécialisé pour les personnes atteintes du syndrome de Korsakoff. Ces pratiques pionnières montrent qu’un maillage médico-social est possible, bien que peu répandu aujourd’hui.
L’alcool comme accélérateur de démence
Plus de huit Belges sur dix de plus de 15 ans déclarent avoir bu au cours de l’année écoulée. Parmi eux, la moyenne tourne autour de onze verres par semaine, alors que les recommandations officielles fixent le seuil de consommation à faible risque à dix verres au maximum. Dès que ce seuil est franchi, la consommation est considérée comme à risque. On estime que 6% de la population belge dépasse ce cap. Un sur dix présente une consommation qualifiée de «problématique», et près de 9% pratiquent chaque semaine des épisodes de binge drinking, définis par au moins six verres en une seule occasion.
En 2021, plus de 4.000 décès en Belgique ont été attribués à l’alcool, qu’il s’agisse de cirrhose, de cancers ou de troubles directement liés à la dépendance. L’épidémiologiste Carole Dufouil voit dans ces chiffres un contexte où le syndrome de Korsakoff risque de devenir plus courant. «Une population habituée à dépasser les taux de consommations d’alcool conseillés est plus sujette aux conséquences sur sa mémoire. Nos recherches montrent que l’alcool peut précipiter l’apparition des maladies neurodégénératives et accélérer leur progression en augmentant les dommages structurels et fonctionnels dans le cerveau. De tels résultats interpellent sur les dangers de l’alcool. Ils suggèrent que des mesures préventives plus fortes pourraient contribuer à réduire le risque de démences, ainsi que leur coût social et financier.»
La chercheuse souligne aussi que l’échelle des données hospitalières permet aujourd’hui de mettre en évidence l’impact concret de l’alcool sur les démences. Le syndrome de Korsakoff apparaît alors comme la partie émergée d’un iceberg plus large, celui des maladies liées à une consommation excessive et prolongée. «La mémoire n’est pas seulement une fonction cognitive. Elle est le socle de l’identité, du lien social. Le syndrome de Korsakoff montre que ce socle peut être brisé, mais que la prévention et la vigilance peuvent l’enrayer. Le syndrome de Korsakoff n’est pas non plus une fatalité liée au vieillissement. C’est l’aboutissement d’une carence évitable. La rapidité du traitement et la vigilance en prévention conditionnent la trajectoire du malade», conclut Carole Dufouil.