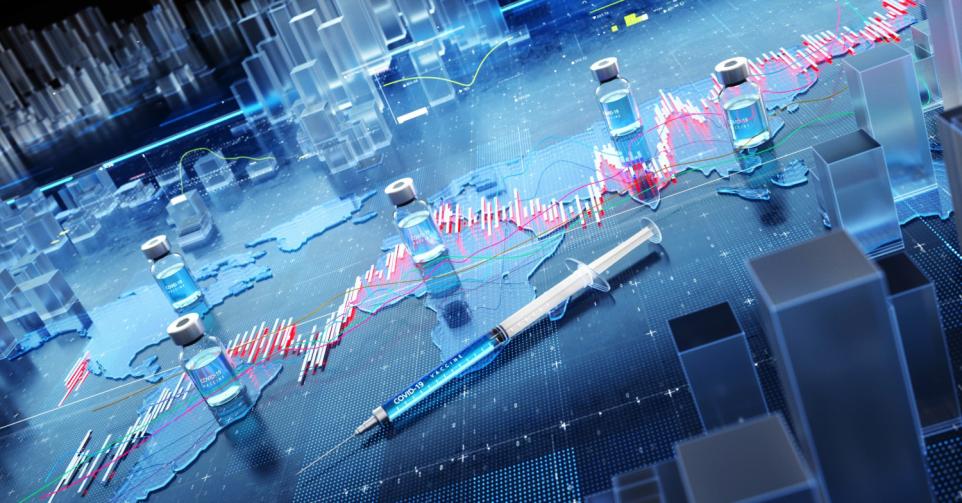La digitalisation des soins de santé, cette «révolution miracle» ventée par l’ensemble du secteur, pèse de plus en plus lourd sur les finances publiques. Coûts de consultance élevés, dépendance aux entreprises privées et investissements massifs futurs interrogent sur la capacité de la Belgique à assumer ce tournant numérique.
Ces dernières années, la Belgique a accéléré la mise en place de plateformes E-santé, d’outils de contrôle, d’automatisation des remboursements de soins et d’optimisation du suivi des dossiers médicaux numérisés. Des avancées vantées pour leur efficacité, certes onéreuses, mais qui rentrent dans une trajectoire désormais inévitable du «tout numérique». Nicolas Neysen, Professeur à l’ULiège en transformation numérique de la santé, juge cette révolution plus que nécessaire: «On voit très clairement que les outils numériques facilitent la vie des équipes soignantes comme des patients. La transformation digitale s’inscrit dans la continuité des progrès technologiques en médecine. Certaines applications contribuent déjà à affiner les diagnostics et à structurer la prise en charge.»
Mais cette révolution a un coût, parfois sous-estimé, ou manquant de transparence. «Dans un hôpital universitaire typique, comme un CHU, qui offre une palette complète de soins, on peut atteindre 300 à 350 applications différentes. Chacune d’elle implique des licences d’exploitation, de la maintenance informatique ou des frais pour l’hébergement et la sécurisation des données. Tout cela représente des coûts à long terme qu’il ne faut pas négliger. Le tout est de savoir si les bénéfices en valent la peine», nuance Nicolas Neysen.
Pour concevoir et maintenir ces outils, des organismes fédéraux comme l’Inami ou le SPF Santé font largement appel à des consultants de boîtes privées. Dans un rapport, la Cour des comptes a estimé les coûts de ces experts numériques entre 2020 et 2022. Pour l’Inami, les dépenses se répartissent entre 27,7 millions d’euros pour des détachés de la Smals et d’Egov Select, et 87,9 millions pour des consultants, soit 48% de son budget d’achat total sur cette période.
La Cour des comptes pointe aussi l’absence d’une «stratégie fédérale claire» pour encadrer ce recours aux consultants et relève des «justifications souvent incomplètes des besoins avant externalisation». Les analyses coûts-avantages entre solutions internes et externes restent rares et le suivi des résultats est jugé «insuffisant». La Cour met également en garde contre une «dépendance structurelle à la consultance», au domaine privé, et particulièrement quand il s’agit du domaine informatique.
Une succession de chantiers onéreux
Derrière les plateformes E-santé et les promesses de simplification numérique, la digitalisation s’est construite par couches. D’abord les prescriptions électroniques, puis les portails patients, les logiciels de facturation, les systèmes de partage de résultats entre hôpitaux et médecins généralistes, les interfaces avec les mutualités ou les médecins-conseils. Dans certains établissements s’ajoutent encore des modules pour la gestion des urgences, du bloc opératoire ou des plannings de gardes. Chaque nouveau projet numérique ne remplace pas tout le reste, il vient se greffer aux systèmes déjà en place dans l’hôpital et ouvre une série de coûts permanents, entre mises à jour, formation des équipes et assistance informatique. A mesure que ces briques s’accumulent, elles génèrent des volumes croissants de données à stocker, à faire circuler et à protéger.
S’ajoute aussi l’augmentation du volume d’examens, d’imagerie et de données cliniques qui exigent des capacités de stockage plus importantes, des sauvegardes redondantes et des connexions stables, ce qui alimente la facture liée aux serveurs, aux licences de bases de données et aux environnements sécurisés. Les directions hospitalières évoquent des volumes de stockage qui se chiffrent désormais en dizaines, voire en centaines de téraoctets pour les plus grands établissements, avec une croissance annuelle qui ne faiblit pas.
La Mutualité Libre avertit sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des coûts de cette transition sur le long terme: «La digitalisation se poursuit à un rythme rapide et celle-ci entraîne davantage de risques de cyberattaques. A l’avenir, les institutions de soins de santé auront besoin d’un soutien financier plus vaste pour répondre aux exigences de sécurité nécessaires. Il ne faut pas qu’investir dans ce domaine, mais y mettre les moyens financiers à la hauteur du projet sociétal.» Les cyberattaques récentes visant des hôpitaux ou des laboratoires ont montré que les données de santé sont devenues une cible de choix.
Sandy Tubeuf, professeure d’économie de la santé à l’UCLouvain, reste, elle, prudente face à l’idée que cette numérisation générerait rapidement des économies au vu des éléments précédemment abordés: «Une technologie qui apporte un gain sur la qualité de vie est utile, mais elle ne permettra pas de réaliser directement des économies. Dans la pratique, les outils numériques peuvent éviter des doublons d’examens ou améliorer la coordination, sans pour autant diminuer le volume global de soins ni les besoins en personnel.»
Des soins de santé dépendants du privé
Du côté des acteurs de terrain, le risque de dépendance technologique est de plus en plus évoqué. Les institutions de soins s’appuient sur des suites logicielles intégrées qui gèrent à la fois le dossier patient, la facturation, les plannings ou la pharmacie. Sortir de ces environnements devient difficile après plusieurs années d’utilisation, quand l’ensemble des processus a été adapté à un fournisseur.
Nicolas Neysen résume ce déséquilibre: «Le fait de s’appuyer sur des suites logicielles du privé peut créer une dépendance à ce secteur. Quand ces outils sont fournis par des géants du numérique qui disposent d’un pouvoir de négociation beaucoup plus important que les pouvoirs publics, on se retrouve parfois à accepter des conditions imposées et à perdre une partie de la maitrise de la connaissance. Tout l’enjeu est de trouver un compromis entre l’accès à des services fiables, déployés à grande échelle, et la capacite à garder la main sur l’expertise et les données. Il ne faut pas qu’une fois notre système de soin numérisé, il devienne dépendant d’entreprises privées.»
Les administrations fédérales et les organismes de sécurité sociale fonctionnent eux aussi avec des équipes mixtes de fonctionnaires et de consultants, ce qui réduit leurs marges de manœuvre lorsqu’il s’agit de migrer vers d’autres solutions moins coûteuses. C’est ce risque que la Cour des comptes met en avant lorsqu’elle évoque une dépendance structurelle à la consultance.
Vers toujours plus de dépenses?
A l’échelle internationale, la dynamique va dans le sens d’une hausse des dépenses publiques de santé, tirée par les progrès technologiques, les attentes croissantes quant aux résultats des soins et le vieillissement démographique. Selon le Panorama de la santé 2025 de l’OCDE, les dépenses publiques de santé devraient augmenter en moyenne de 1.5 % du PIB d’ici à 2045 dans les pays de l’OCDE, ce qui posera des questions de financement dans un contexte de fortes contraintes budgétaires.
Pour la Cour des comptes, le défi consiste à encadrer la dynamique numérique plutôt qu’à la freiner. Le rapport sur la consultance recommande de définir une stratégie claire de recours aux consultants, de renforcer l’évaluation des projets, d’exiger le transfert de connaissances et de privilégier, lorsque c’est possible, des solutions internes ou mutualisées via des structures publiques spécialisées.
Entre gain organisationnel et d’efficacité, mais dépendance technologique et contraintes budgétaires, la digitalisation des soins de santé apparaît moins comme une source d’économies immédiates et de gains de temps que comme un engagement de long terme.