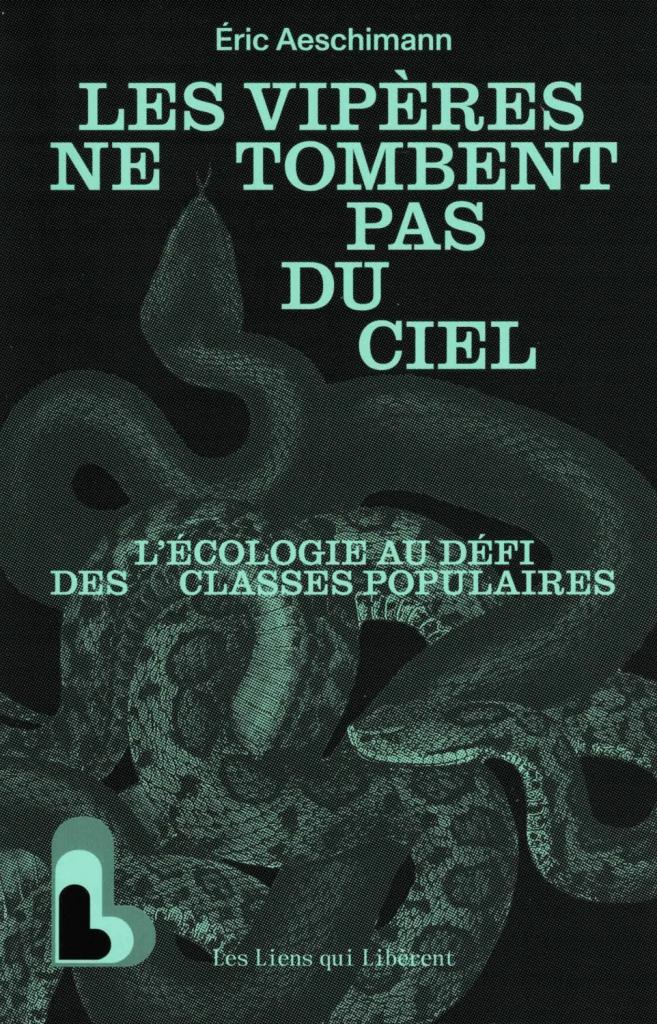Le journaliste Eric Aeschimann constate l’impasse de l’écologie politique face aux attentes des classes populaires. Il prône qu’elle s’inscrive dans une lutte des classes contre les riches pollueurs.
«L’écologie agace ceux qui, à tort ou à raison, pensent que c’est un luxe de bobos, un truc de gens bien éduqués, une façon de faire la morale aux pauvres.» Voilà pour le constat. «La poussée de l’extrême droite aux élections européennes et législatives du printemps 2024 suivie de la victoire de Donald Trump en atteste: dans les deux cas, l’antiécologisme –on pourrait même parler d’écolophobie– a été l’un des moteurs du populisme.» Voilà pour les conséquences. Ce tableau est dressé par le journaliste au Nouvel Obs Eric Aeschimann. Se décrivant lui-même «écologiste», il s’attelle dans son essai limpide et lucide Les Vipères ne tombent pas du ciel (1) à sortir le mouvement écologiste de la mauvaise passe à laquelle il est confronté.
«Réclamer un “écogeste” à quelqu’un qui est pieds et poings liés par la précarité, c’est ajouter de l’humiliation à l’humiliation.»
Pour l’auteur, l’écologie politique, au-delà du contexte particulier (guerre en Ukraine, crise économique et sociale), souffre d’avoir été et d’être encore trop technocratique et trop moralisatrice. En cause, des décisions qui n’ont pas suffisamment pris en compte les préoccupations des citoyens. La révolte des gilets jaunes en France, suscitée notamment par une taxe carbone, en a fourni l’illustration la plus spectaculaire. Eric Aeschimann cite aussi l’instauration des zones à faibles émissions de particules fines dans les centres urbains devenus inaccessibles aux défavorisés des zones rurales et à leur vieille voiture diesel. «Réclamer un « écogeste » à quelqu’un qui est pieds et poings liés par la précarité, ce n’est pas sauver la planète, c’est ajouter de l’humiliation à l’humiliation», commente-t-il.
L’écologie politique doit changer de méthode, considère dès lors Eric Aeschimann. Pour cela, il propose de la replacer dans le cadre d’une lutte des classes, sachant que la politique des «petits gestes» serinée depuis longtemps à l’adresse des citoyens détourne l’attention des vrais gestes que les principaux pollueurs, entreprises et personnes fortunées, devraient légitimement poser. «Il faut recoder l’écologie. Jusqu’ici, l’écologie dominante, d’inspiration technocratique et moralisatrice, a interprété le monde en termes de comportements individuels et de modes de vie choisis, explique l’auteur. Désormais, elle doit le considérer en termes de production économique et de systèmes sociotechniques imposés, c’est-à-dire en termes de pouvoir et de classes sociales. C’est à ce prix qu’elle deviendra une écologie égalitaire et émancipatrice.»
(1) Les Vipères ne tombent pas du ciel. L’écologie au défi des classes populaires, par Eric Aeschimann, Les Liens qui libèrent, 224 p.