Le sentiment d’être méprisé est plus prégnant aujourd’hui qu’hier en raison de l’individualisation et de nouvelles formes de discriminations collectives, analyse le sociologue François Dubet.
«S’il n’est pas certain qu’on soit méprisé aujourd’hui plus qu’hier, il est probable que la rencontre du désir de reconnaissance et des réseaux sociaux fait du mépris l’une des émotions les plus banales et les plus activement dénoncées», avance le sociologue François Dubet en introduction du livre Le Mépris. Emotion collective, passion politique (1). Son essai dessine ainsi les caractéristiques nouvelles du mépris et du sentiment d’être méprisé sans dramatisation mais avec la conscience de l’enjeu que le phénomène représente pour la vie en société et la démocratie.
«Le sentiment de mépris déborde le seul mépris de classe.»
«Plus l’individualisation progresse, plus les conventions hiérarchiques et morales faiblissent, plus les individus ont besoin des autres pour être reconnus, et plus la honte et la culpabilité sont remplacées par la menace d’être méprisé. Paradoxalement, le règne du mépris ou, plus exactement, celui de la peur du mépris, participe du triomphe de l’égalité et de la liberté», diagnostique-t-il. Il lie aussi la hausse du sentiment d’être méprisé à l’explosion des inégalités, qui, de surcroît, se fractionnent et s’individualisent (femmes, minorités, majorité du fait des revendications des minorités…). «Il suffit qu’une dimension des inégalités qui me composent soit invisible, oubliée, stigmatisée, pour que je coure le risque de me sentir « méprisé »», ajoute-t-il.
A côté de cette individualisation du sentiment de mépris, s’ajoutent de nouvelles perceptions de discriminations collectives. L’une d’elles a été exprimée par le mouvement des gilets jaunes en France: «On est méprisé et en colère parce que le monde change sans nous, voire contre nous.» Une autre est ressentie par les enseignants et les membres du personnel soignant, qui estiment avoir globalement perdu de leur prestige et de leur autorité en raison de l’évolution de la société.
La prise de conscience de cette multiplication des risques de se sentir rabaissé est indispensable pour prévenir les conséquences sur l’individu, les groupes et la société. Car «multiforme et contradictoire, le sentiment de mépris déborde le seul mépris de classe pour devenir l’énergie émotionnelle des forces et des mouvements qui menacent la démocratie».
(1) Le Mépris. Emotion collective, passion politique, par François Dubet, Seuil, 128 p.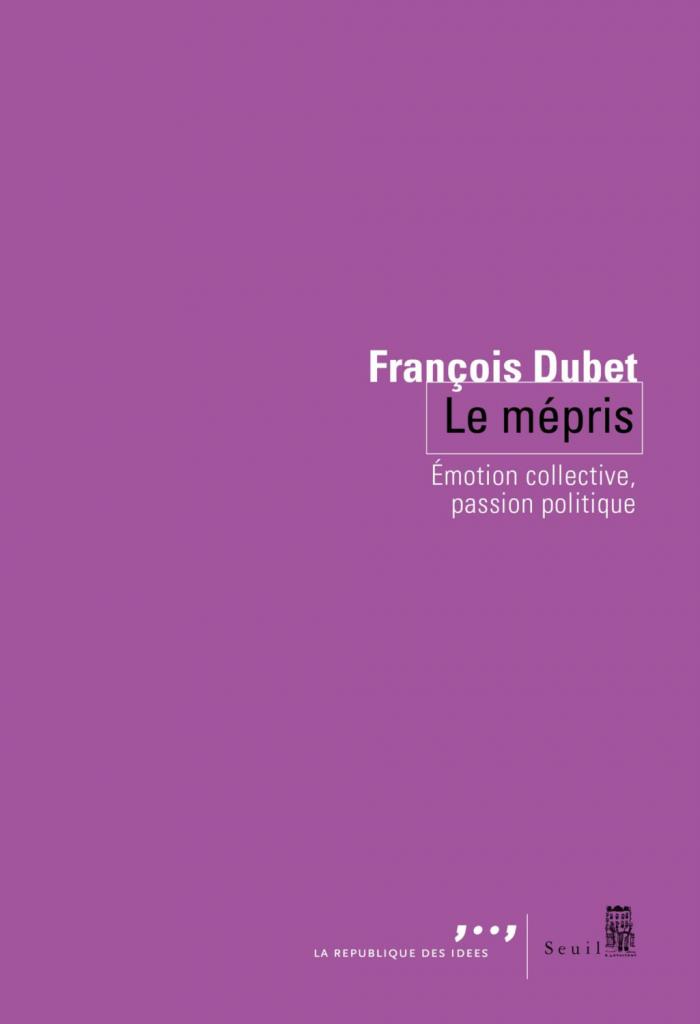
© DR

