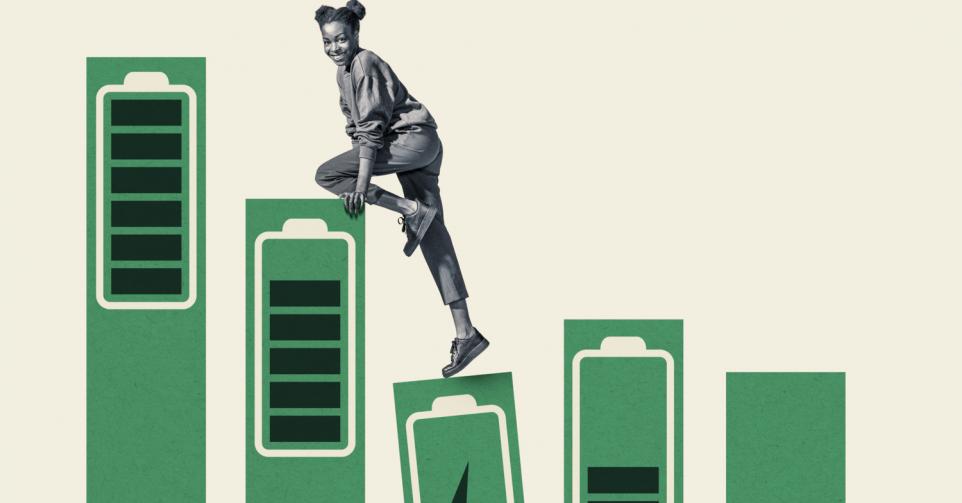Les interactions sociales coûtent beaucoup d’énergie à certains, tandis qu’elles permettent à d’autres de se requinquer. C’est que nos «batteries sociales» se rechargent différemment.
L’invitation est arrivée. Bientôt, ce sera la réunion des anciens élèves, ces têtes qu’on n’a pas vues depuis belle lurette. Il y aura du monde. On y bavardera de ce qu’on est devenus, des dernières vacances, de la pluie et du beau temps. Il faudra engager la conversation. La perspective de cette soirée provoquera des réactions diverses. La plupart prendront un peu sur eux, puis passeront un moment agréable. Pour certains, l’idée de voir du monde et renouer avec des contacts sera une profonde source de réjouissance. Pour d’autres, enfin, la seule vision du carton d’invitation s’apparente à un cauchemar. Ceux-là devront s’y rendre avec une batterie sociale rechargée à bloc, sous peine de se désagréger.
Les interactions sociales peuvent constituer une source d’énergie quasi vitale pour certaines personnes, qui s’alimentent de ces contacts. Pour d’autres, l’effet sera inverse. De telles situations les épuiseront, littéralement. Elles ressentiront probablement un grand besoin d’isolement après l’effort, pour reprendre des forces. Voilà ce que recouvre la notion de «batterie sociale»: les interactions seront soit bénéfiques, soit coûteuses en énergie, selon les individus et les situations.
«Me rendre seule au cinéma est tout à fait inconcevable pour moi. Pire: imaginer un restaurant en solitaire, c’est la fin du monde», confie Delphine, quadragénaire qui avoue avoir un besoin presque permanent de contact. A l’inverse, Julien, formateur, ne cherche pas forcément à accumuler les interactions: «Les repas en trop grand comité m’épuisent rapidement. Je préfère nettement quand on est moins nombreux. Si j’ai une activité sociale le samedi, j’ai besoin de prendre mon dimanche pour récupérer de l’énergie. Je suis plutôt sociable, ce n’est pas ça le problème. Ce n’est pas que je n’apprécie pas les autres personnes, au contraire. Simplement, je suis plutôt une personne introvertie.»
«Des gens se sont inquiétés pour moi, me disant que j’allais finir toute seule. Mais ça me convient très bien.»
Une batterie, c’est évocateur
La batterie sociale est une métaphore dans l’air du temps. Il n’est pas rare, dans des articles de presse et sur les réseaux sociaux, de croiser un témoignage faisant état d’une batterie sociale complètement à plat, comme vidée par un trop-plein d’interactions.
Pourtant, la thématique n’est pas neuve, puisqu’elle se rapproche fortement des concepts d’introversion et d’extraversion. Voici un siècle, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung théorisait déjà les deux attitudes, selon que l’on puise son énergie en soi-même ou à l’extérieur. L’opposition entre ces deux typologies de personnalité trouve aujourd’hui un nouvel écho à la faveur de l’omniprésence des appareils électroniques que nous devons en permanence recharger. L’analogie avec la batterie semble particulièrement évocatrice de l’état des ressources en énergie de tout un chacun.
Nous connaissons tous cette angoisse à la vue de l’unique barre restante sur l’écran de notre smartphone. Une fois dans le rouge, il est grand temps de rebrancher la prise.
«Il n’est pas simple d’identifier ce qui, tout à coup, fait d’un concept comme celui-là une mode. Parfois, il suffit de trouver les mots justes. Il y a une douzaine d’années déjà, la juriste américaine Susan Cain, elle-même introvertie, a rencontré un grand succès avec son livre La Force des discrets: le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard (JC Lattès, 2013)», souligne la psychologue parisienne Laurie Hawkes, elle-même autrice de plusieurs ouvrages abordant la thématique, dont La Force des introvertis (Eyrolles, 2022).
Pour elle, l’image de la batterie sociale peut s’avérer intéressante, mais n’est pas forcément la panacée. «Une batterie, vous devez la brancher pour la recharger. Or, la batterie sociale, elle, se recharge de manière différente en fonction des profils. Je dirais même que pour beaucoup d’introvertis, il ne s’agit pas tant d’une batterie à plat que d’un état de surcharge.»
«La solitude est angoissante pour moi»
«D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu cette préoccupation de remplir ma vie de nombreux contacts sociaux et d’échanges. J’ai toujours voulu passer du temps avec des gens, prendre le temps de rire et de parler. J’ai toujours eu la sensation de me « nourrir » de contacts humains», raconte Aurélie, active dans le secteur des médias. Pour elle, bien remplir sa vie est nécessaire. «Cela a un effet sur mon énergie, que je sens remonter en flèche quand je rentre d’une soirée, par exemple. J’ai alors l’impression d’avoir rentabilisé mon temps, au lieu de le perdre… même s’il ne se passe rien de fou. La solitude et l’ennui ont quelque chose d’angoissant pour les personnes comme moi, alors que je sais que c’est une source d’énergie pour d’autres, que c’est nécessaire à l’équilibre humain. Le revers de la médaille, c’est d’être souvent en hyperactivité, en recherche de vibrations procurées par les relations sociales et de ne pas avoir la sensation de se poser, de fuir les moments où l’on se retrouve face à soi-même», reconnaît la quadragénaire.
«Après une réunion, j’ai juste besoin de silence»
«Je ne suis pas fan des réunions, qui me prennent beaucoup d’énergie, confie Julien, la quarantaine. Je me canalise en faisant quelque chose comme dessiner ou écrire. C’est aussi une question de digestion de l’information. Trop de données arrivent et me réclament beaucoup de ressources attentionnelles. Parfois, ça m’ennuie, tout simplement. Même en étant présent physiquement, je m’enfuis. Et lorsque je retourne dans mon bureau, je m’affale et je traverse un moment de léthargie. J’ai trop encaissé, j’ai juste besoin de silence.»
Un monde bruyant
«On peut imaginer plusieurs facteurs sociaux contribuant au succès de ce concept, poursuit la psychologue. Je dirais tout de même que nous vivons dans une société très compétitive, dans laquelle il convient de se mettre en avant. A côté de cela, les réseaux sociaux et Internet sont omniprésents. Beaucoup de choses se passent en ligne, sans contacts physiques. Ces deux éléments, au fond, peuvent sembler divergents, mais il faut comprendre que les introvertis peuvent se sentir très épuisés par la compétition permanente.»
Evoquer la santé mentale et parler de ses émotions devient de moins en moins tabou. C’est l’observation formulée par Mélissa Manacorda, qui a récemment publié Je suis introverti·e, et alors? (Améthyste Editions, 2024), une sorte de «guide de survie en société». «Je pense que la parole se libère un peu sur ces sujets. La période du Covid fut certainement un déclencheur pour beaucoup de personnes, qui se sont rendu compte à quel point il est important de prendre du temps pour soi», selon que l’on ait vécu le confinement comme une contrainte ou un soulagement.

Graphiste de profession, elle se dit elle-même introvertie. «Je sentais une sorte de décalage avec les autres, avec parfois cette impression que quelque chose clochait chez moi. J’ai considéré que le meilleur moyen d’en parler était peut-être d’en faire quelque chose de constructif sur les réseaux sociaux», poursuit Mélissa Manacorda. C’est ainsi qu’est né le compte Instagram «Les Introverti·es», qui invite à «bien vivre son introversion en société», grâce à des publications alliant avec légèreté conseils et témoignages. Le compte, assure sa créatrice, affiche quelque 12.500 abonnés, qu’ils soient introvertis, extravertis ou quelque part entre les deux.
«Ce qui est intéressant avec un concept comme celui de la batterie sociale, c’est qu’il déculpabilise, analyse Delphine Landenne, psychologue clinicienne à Liège. La notion d’introversion n’est pas particulièrement bien connotée socialement. A l’ère de la surexposition numérique, ce genre de métaphore est parlante.»
Ses patients ne débarquent pas dans son cabinet en formulant le terme «batterie sociale», concède-t-elle. «En revanche, ce qui est très fréquent, ce sont des personnes qui consultent parce qu’elles éprouvent des difficultés à s’affirmer, elles se renferment et se sentent trop introverties.»
«J’ai besoin de me protéger de l’extérieur»
«Professionnellement ou en privé, cela s’accentue avec le temps. Peut-être est-ce dû à nos modes de vie ultraproductifs et consuméristes, à l’agitation extérieure, au brouhaha politique, économique, écologique», déroule Virginie, traductrice et journaliste. Certains petits gestes permettent de mieux apprivoiser le besoin d’apaisement. «Je me suis acheté des rideaux que je ferme le soir. Je me réveille le matin dans ce cocon, j’ai besoin de me protéger de ce qui se passe à l’extérieur.» Elle ne fuit pas les interactions, mais privilégiera les tête-à-tête aux grandes réunions. «Par exemple, je ne mélange pas mes amis. Mes amitiés sont cloisonnées et cela me donne l’impression qu’on est plus à l’écoute de l’autre. Lorsque j’ai un dîner avec tout un groupe d’amis, je n’ai pas trop envie d’y aller. Trop de monde? Trop de bruit. En revanche, la foule ne me fait pas peur. Je peux aller voir un concert avec une ou deux personnes, au milieu de milliers d’autres.»
«Le bavardage inutile, très peu pour moi»
«Lorsque je côtoie des gens, au bout d’un moment ça m’épuise. Alors, j’ai besoin d’être seule pour recharger les batteries», témoigne Christine, sexagénaire plutôt introvertie. Je ne sais pas vraiment me reposer si je suis entourée, même de mes enfants. Je suis comme une éponge, j’absorbe tout. Lorsqu’on me parle, j’écoute vraiment, je ne fais pas semblant. Me rendre à un cocktail où il va falloir créer du lien un peu superficiel, avec du bavardage inutile, ce n’est pas pour moi. Il me faut des conversations intéressantes. D’ailleurs, je préfère un dîner en petit comité, avec des conversations plus profondes et authentiques à mes yeux.»
Ne pas oublier les ambivertis
Néanmoins, préviennent les psychologues, le caractère intraverti ou extraverti appelle à la nuance. «Certaines personnes penchent vraiment d’un côté ou de l’autre, mais pour la plupart, la réalité se trouve quelque part entre les deux, estime Delphine Landenne. Elle fluctue, en fonction des moments de la vie, des situations sociales. On peut tous éprouver des besoins de solitude par moments, même si on est extraverti. C’est un continuum.»
Le néologisme «ambiverti» s’est d’ailleurs popularisé pour qualifier les nombreuses personnes qui présentent à la fois des traits d’introverti et d’extraverti. En simplifiant un peu, on pourra considérer que les introvertis ont besoin de solitude pour se ressourcer, privilégient plutôt le calme et l’écoute plutôt que l’agitation et le débit de parole, préfèrent intérioriser et prendre leur temps de la réflexion, tout en étant parcimonieux dans leurs relations sociales, en cherchant la qualité plutôt que la quantité. Les extravertis recherchent plutôt la stimulation au contact de l’extérieur, ont la parole facile, sont orientés vers l’action, sont plus fonceurs et comptent de nombreuses relations sociales. Entre ces deux pôles se décline tout un nuancier à l’intérieur duquel la majorité des personnes évoluent de façon fluctuante.
«Si j’ai une activité sociale le samedi, j’ai besoin de prendre mon dimanche pour récupérer de l’énergie.»
Pour autant, l’environnement dans lequel nous vivons est souvent plus simple pour les extravertis. La tendance, y compris dans une perspective de développement personnel, est plutôt à l’extériorisation et à l’affirmation de soi. «On peut simplement citer l’exemple du monde professionnel, illustre Mélissa Manacorda. Un recruteur aura tendance à privilégier le candidat qui s’exprime facilement, qui se vend bien et valorise son expérience, plutôt que celui éprouvant des difficultés à trouver ses mots et exprimant le strict minimum.»
Introverti, c’est bien aussi
«Cela peut être compliqué d’être introverti dans une famille d’extravertis, note également Laurie Hawkes. C’est l’exemple typique de la maman qui vient me trouver parce qu’elle s’inquiète pour son fils parce qu’il s’enferme dans sa chambre, rencontre peu d’amis et reste très solitaire. Peut-être que cet adolescent a juste des besoins différents, parce qu’il est introverti.»
Il ne s’agit en aucun cas d’une maladie, insiste cette dernière. L’introversion peut même représenter une force, une capacité à intérioriser la réflexion, par exemple. «Il ne faut pas non plus confondre l’introversion avec la timidité. Il n’y a pas forcément de problème d’estime de soi, même si, intuitivement, j’aurais tendance à considérer que les introvertis sont davantage sujets à des problèmes de confiance en soi. Si la société dévalorise ce trait de caractère, cela peut finir par attaquer un peu cette estime.»
«J’ai l’habitude de considérer que la timidité, ça se travaille, alors que l’introversion, c’est une manière d’être et de fonctionner.»
Mélissa Manacorda tient également à distinguer plusieurs notions, même si elles ne s’excluent pas nécessairement. La batterie sociale recouvre l’idée d’une réserve d’énergie qui s’épuise ou se recharge au contact des autres. L’essentiel consiste sans doute à bien se connaître, identifier ses besoins et, pourquoi pas, les communiquer.
La timidité, elle, «est plutôt un état passager qui se manifestera lors d’une interaction sociale. C’est le trac chez le boulanger, en quelque sorte. J’ai l’habitude de considérer que la timidité, ça se travaille, alors que l’introversion, c’est une manière d’être et de fonctionner.» L’anxiété sociale, elle, relève plutôt du trouble, de la peur excessive des interactions, qui nécessitera éventuellement une prise en charge professionnelle.
«Parfois, je peux donner l’impression d’être froide et distante, alors que franchement, je ne pense pas être comme ça», explique par exemple Christine, sexagénaire, qui assume son besoin de solitude. «Comme j’ai changé au cours de ma vie, cela a parfois pu être difficile à comprendre pour mon entourage, témoigne également Murielle (1). Quand tu as toujours répondu oui à toutes les invitations et que tu commences à dire non, parce que tu identifies mieux tes besoins, ça peut provoquer quelques incompréhensions. Des gens se sont inquiétés pour moi, me disant que j’allais finir toute seule. Mais ça me convient très bien, à moi, ces moments d’isolement.»
«Plus les années passent, plus j’apprécie la solitude»
«Jusqu’à 40 ou 45 ans, j’avais besoin d’animation autour de moi pour me ressourcer. En sortant de chez moi, en faisant de belles rencontres, y compris professionnelles, j’avais ce sentiment de ne pas avoir perdu mon temps, se souvient Murielle (1), active dans la communication. Puis j’ai eu quelques désillusions, amicales notamment, ou simplement des éloignements. Petit à petit, j’ai commencé à sélectionner mon entourage. Surtout, j’ai appris à dire non. Je me suis rendu compte qu’il m’arrivait de me retrouver quelque part parce qu’on m’invitait, mais sans en avoir envie. J’avais peur de déplaire. C’était lié à mon éducation également. Il fallait être « le bon petit soldat », être irréprochable. J’ai ensuite entamé un travail sur moi, ce qui m’a aidée. J’ai eu besoin de pouvoir dire « stop ». Plus les années passent, plus j’apprécie ces moments de solitude, ces vacances en solo, ces sorties au cinéma seule avec moi-même.»
«En télétravail, mais en contact permanent»
«Je ne l’avais pas remarqué, c’est mon manager qui l’a perçu. C’est vraiment au contact des autres que j’ai de l’énergie. Quand je me retrouve seule toute une journée, l’énergie s’en va, la batterie est plate», témoigne Delphine, consultante dans le secteur informatique. Pourtant, son activité professionnelle se déroule en grande partie en télétravail, mais elle parvient à tirer son épingle du jeu. «Je suis à la maison, mais en contact permanent avec l’extérieur. On travaille beaucoup en équipe, ce qui signifie que je cause toute la journée, par téléphone ou en visioconférence. Je n’ai pas l’impression d’être seule et cette façon de fonctionner me convient.»
Apprendre à se connaître
D’autres cas de figure semblent plus hybrides. «Je suis très extravertie. En soirée, je parle à tout le monde, même à un chien avec un chapeau», sourit Amélie (1), la trentaine. Préserver ses relations sociales, de façon quasi permanente, est un besoin pour elle. «En revanche, ça m’épuise, reconnaît-elle. J’ai beaucoup d’empathie et ça me prend énormément d’énergie.» Mais, comme pour le sport, il arrive qu’on apprécie des activités qui coûtent en énergie.
Sage-femme, elle n’éprouve pas particulièrement ce besoin dans un cadre professionnel. Là, le travail est effectué, avec application, les contacts s’établissent naturellement entre patiente et soignante. Les amitiés, c’est une autre histoire. Dans l’esprit d’Amélie, elles doivent être ménagées, choyées au quotidien, quitte à en faire plus que ce que sa batterie lui permet d’endurer. Mais elle a appris, à l’aide d’un suivi psychologique, à mieux gérer ce trait de caractère ces dernières années.
Lire aussi | Être introverti n’est pas une tare !
«J’ai 44 ans et mes expériences m’ont appris à connaître mes besoins et mes volontés, en amitié, pour les contacts sociaux en général», exprime Raphaël (1). Ce comptable mesure à quel point le travail, notamment, est pour lui un lieu indispensable pour alimenter sa batterie sociale. «La question financière est moins déterminante qu’auparavant, comparativement à l’utilité sociale, très clairement.»
Par deux fois, pour suivre les activités professionnelles de sa compagne, le couple et leurs enfants se sont expatriés, en Azerbaïdjan et au Sri Lanka. La perte prolongée de tout contact social vraiment authentique, du jour au lendemain, lui a permis de réaliser à quel point l’isolement était éprouvant pour lui. «Ne plus rien faire et m’ennuyer m’a fait me poser des questions. J’ai broyé du noir. Vraiment, la solitude m’a énormément pesé», livre-t-il.
Face au risque d’épuisement, de perte de motivation ou encore d’exacerbation de l’irritation que peut engendrer une batterie sociale à plat, bien identifier ses besoins constitue probablement un bon conseil de base. Il s’agira d’un premier pas pour mieux expliquer son mode de recharge à son entourage. Et surtout pour s’octroyer des moments de déconnexion ou reconnexion indispensables pour ménager sa monture.
(1) Prénom d’emprunt