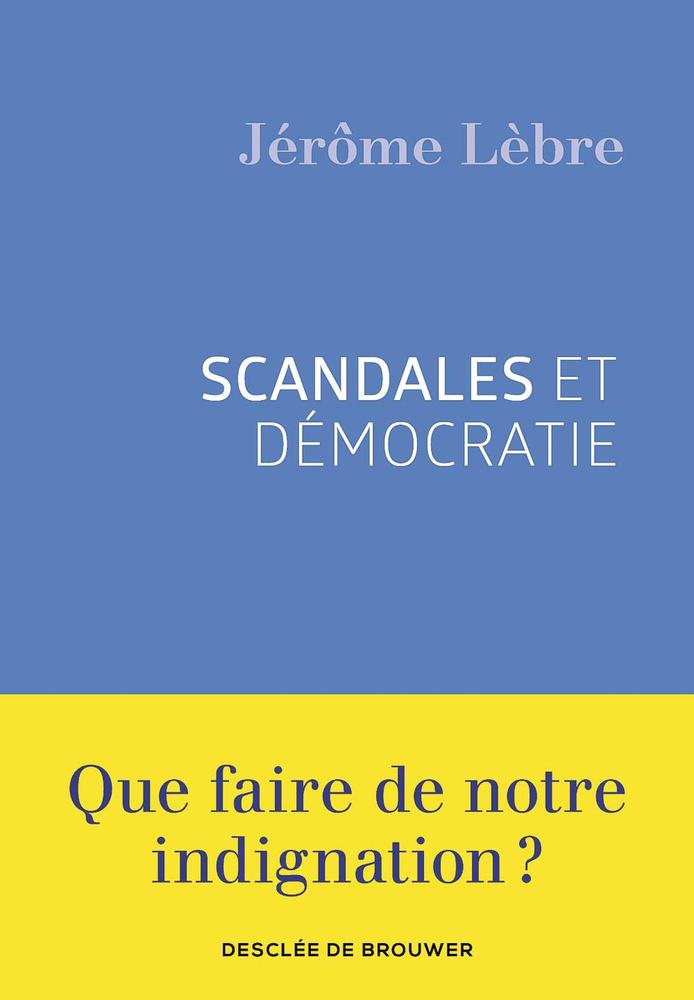« L’importance des scandales financiers à la fin du xixe siècle, des scandales de corruption dans les années 1980, des scandales sanitaires et écologiques peut-être moins récents qu’on ne le croit, rendent compte des préoccupations générales d’une autre manière que les discours politiques et leurs succès électoraux « , énonce le philosophe français Jérôme Lèbre dans Scandales et démocratie (Desclée de Brouwer, 216 p.). Distinguant les scandales des provocations qui, elles, sont manifestes, l’auteur explique que les transgressions, » aussi humaines que le respect des règles « , sont toujours désirées mais les scandales jamais voulus. Or, ceux-ci remodèlent la société » selon des lignes toujours surprenantes qui ne respectent aucune conception préalable du « tout » social et surtout aucune division préalable en communauté familiale, religieuse, etc. « . Entre autres analyses, Jérôme Lèbre met en évidence la spécificité des scandales d’Etat. » Plus le pouvoir souverain insiste sur sa légitimité ou son autorité, plus il se protège d’une manière illégale. […] La résistance aux transgressions souveraines est alors bien moins assurée par les institutions publiques que par les médias « , observe-t-il. Le citoyen, lui, ne peut répondre à la multiplication des scandales et affaires que par la soumission de la politique à une exigence de justice qui la dépasse et, plus individuellement, par un désir accru de justice, condition de la démocratie.