«Si l’Union européenne adoptait des sanctions, elle obtiendrait des résultats», estime Monique Chemillier-Gendreau. Pour la juriste, Israël n’a jamais admis la création d’un Etat palestinien.
Le feu vert accordé par le gouvernement israélien le 19 mai à l’entrée dans la bande de Gaza de quelques camions transportant de l’aide alimentaire et des médicaments ne change pas fondamentalement la situation des Gazaouis. L’apport est trop réduit pour écarter la menace de la famine alors que l’assistance humanitaire d’envergure est bloquée par Israël depuis le 2 mars. De surcroît, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne remet en aucune manière le projet de l’opération «Les chariots de Gédéon» qui vise à envahir l’entièreté du territoire palestinien, déplacer les populations, détruire des infrastructures, chasser le Hamas, et récupérer les otages encore aux mains du groupe islamiste palestinien.
Les prochains jours diront si les pressions diplomatiques qui commencent à prendre forme pour infléchir la position d’Israël auront un quelconque effet. En attendant, en regard de la situation dramatique que vit la population de la bande de Gaza, se pose la question de la complicité de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, voire de génocide qui pourrait être associée à l’attitude des Occidentaux, alliés d’Israël. Professeure émérite à l’université Paris Cité, la spécialiste du droit international et de la théorie de l’Etat Monique Chemillier-Gendreau publie un livre «cri d’alarme» qui remet la conjoncture actuelle dans un contexte plus large, Rendre impossible un Etat palestinien (1).
L’opposition à l’existence d’un Etat palestinien est consubstantielle au projet de création d’Israël, soutenez-vous dans votre livre. De quelle façon cela s’est-il concrétisé?
Rendre impossible un Etat palestinien est l’objectif d’Israël depuis sa création. Dans le travail que je mène depuis des années sur cette question, et notamment à l’occasion des demandes d’avis consultatifs introduites récemment devant la Cour internationale de justice (CIJ), je me suis rendu compte que dès le projet sioniste, il n’y avait pas de place pour un Etat palestinien. Si vous regardez les cartes du projet d’implantation d’un Etat au Moyen-Orient produites par les responsables sionistes à la fin du XIXe siècle, vous constatez qu’il déborde complètement de ce qu’a été la Palestine mandataire et qu’il ne laisse pas de place pour un Etat palestinien. Ensuite –c’est une éclatante vérité qui m’est apparue en tant que juriste–, le mouvement sioniste, c’est-à-dire ces extrémistes sionistes désormais au pouvoir en Israël mais qui l’ont toujours nourri, a détruit, de manière méthodique et systématique, les éléments de l’Etat.
Quels sont les éléments constitutifs d’un Etat qui ont été ainsi détruits?
Un Etat, dans la doctrine moderne, c’est un territoire cohérent et continu, un peuple rassemblé, une autorité dotée de pouvoirs régaliens, et une capitale, symbole de ce pouvoir. Depuis sa création, Israël a attaqué avec beaucoup de persistance ces quatre éléments. Le territoire n’est plus continu. D’abord, il a été occupé en vertu de la résolution 181 (NDLR: le plan de partage de la Palestine en un Etat juif et un Etat arabe approuvé par l’Assemblée générale de l’ONU le 29 novembre 1947). Celle-ci a donné une légitimité à l’Etat d’Israël, que, sur cette base, on ne peut plus contester. En 1948, à l’occasion de la guerre déclenchée par des pays arabes qui s’opposaient au plan de partage, Israël en a profité pour s’emparer, par la force et en contradiction avec la charte des Nations unies, d’un tiers du territoire qui était dédié à l’Etat palestinien. En 1967, Israël a occupé par la force l’intégralité de ce qui restait du territoire palestinien. Depuis, il le truffe de colonies, en Cisjordanie et à Jérusalem, avec près de 700.000 colons, ce qui rend évidemment un Etat palestinien non viable. Et il est en train de s’emparer à nouveau de la bande de Gaza. Israël l’affirme ouvertement. Donc, pas de territoire pour un Etat palestinien. La population ne peut pas se regrouper puisqu’elle a été chassée, a dû se réfugier dans d’autres pays et est désormais interdite de droit au retour. L’Autorité palestinienne, créée par les accords d’Oslo, n’a jamais été, aux yeux d’Israël, un embryon d’Etat. Ce fut le grand malentendu de ces accords. Les Palestiniens pensaient que ces derniers étaient un premier pas vers la souveraineté et qu’au fil du temps, l’Autorité palestinienne se transformerait en Etat. Mais Israël ne lui a jamais concédé la moindre fonction régalienne. Enfin, la capitale: dans la dernière étape des accords d’Oslo, les représentants d’Israël, acculés notamment par les pays garants de la négociation, ont proposé comme capitale palestinienne un faubourg de Jérusalem, Abu Dis… Il faut que la communauté internationale regarde la réalité en face. Israël n’a jamais permis que les Palestiniens disposent des éléments constitutifs d’un Etat.

Les Israéliens n’ont-ils tout de même pas accepté le principe d’un Etat palestinien, en endossant le plan de partage de l’ONU en 1947 et en s’engageant dans des négociations sur les accords d’Oslo qui jetaient les bases d’une solution à deux Etats?
Je pense que l’engagement des Israéliens au cours de ces étapes n’était pas sincère. J’en ai la preuve pour la première. Immédiatement après la résolution de partage de l’ONU, Israël se déclare Etat indépendant et demande son accession aux Nations unies. Mais comme la guerre de 1948 a commencé, les Nations unies ne peuvent que constater qu’Israël ne respecte pas la charte de l’ONU. L’Assemblée générale s’inquiète de cette situation. L’accession d’Israël est retardée. Il lui est demandé de garantir qu’il accepte les principes de la charte et toutes ses conséquences juridiques. Le délégué israélien fait cette promesse. Mais dès le lendemain, elle est violée. La résolution 194 sur le droit au retour des réfugiés n’a jamais été acceptée. La résolution 242 sur la restitution des territoires n’a jamais été respectée. Israël viole le droit humanitaire sur une très grande échelle en cas de conflit armé. La réalité est là. La Cour internationale de justice, dans son avis de 2024, a dit très clairement que l’occupation de la Cisjordanie est illégale, et constitue une annexion déguisée. A propos de l’étape des accords d’Oslo, Israël y a été contraint par la communauté internationale et par le président américain Bill Clinton qui avait besoin d’un succès diplomatique. Quand on voit la suite donnée aux accords, je pense que l’on peut dire que les dirigeants israéliens n’étaient pas sincères.
Vous constatez que la solution à deux Etats et une issue négociée entre les deux parties sont illusoires et qu’il faut revoir les stratégies. Dans quel sens?
Rien ne se fera sans une pression à base de sanctions de la part de la communauté internationale. Il est inadmissible qu’on sanctionne tant d’autres pays et pas Israël. Car le Conseil de sécurité de l’ONU et l’Union européenne, par exemple, savent sanctionner quand ils le veulent. Israël bénéficie d’une impunité extraordinaire. De sa propre volonté, il ne bougera pas. C’est à la communauté internationale de réfléchir et de se demander ce qu’elle veut faire. La crédibilité du droit international est en jeu. Il traverse une profonde crise et est exposé à une grande menace, notamment en raison des positions de Donald Trump. Le moment est grave parce qu’un monde entièrement connecté comme le nôtre qui n’aurait pas de règles communes et de procédures pour les faire appliquer se dirige vers le chaos. Le conflit entre Israël et la Palestine est absolument emblématique. Rien ne se fera sans un processus de sanctions et d’autorité de la part de la communauté internationale. Ensuite, la solution à deux Etats est-elle encore possible dans le contexte actuel ou faut-il aller vers un Etat binational? C’est aux Palestiniens de décider. Ce n’est pas à nous. Des voix vont dans les deux sens. Je ne pense pas que la solution à deux Etats soit impossible si la communauté internationale manifeste la volonté de l’imposer à Israël. Si l’Union européenne appliquait des sanctions contre Israël en vertu de l’article 2, impliquant le respect des droits de l’homme, de l’accord d’association entre les deux parties et le suspendait, ce serait un choc salutaire pour Israël.
«Moralement, je n’en peux plus d’être confrontée à des faits humainement insoutenables. Des enfants opérés sans anesthésie…»
La guerre à Gaza et la répression en Cisjordanie s’inscrivent-elles dans la droite ligne de cette politique de rejet de la création d’un Etat palestinien?
Bien sûr. Déjà, la montée du Hamas dans la bande de Gaza a été favorisée par Israël qui y voyait une manière d’affaiblir l’Autorité palestinienne. Israël a tout fait pour qu’elle soit déconsidérée et qu’elle n’exerce pas de pouvoir sur la population. Il a joué la carte du Hamas. Le Hamas étant ce qu’il est, on en voit le résultat aujourd’hui. En Cisjordanie, la colonisation accélérée, avec des colons à l’idéologie extrémiste très marquée, a aussi fragilisé le pouvoir de l’Autorité palestinienne… Il faut lire l’avis de la Cour internationale de justice de juillet 2024. Elle dit clairement qu’il ne faut plus se leurrer, l’occupation ajoutée à la colonisation signifie qu’une annexion déguisée est en cours. D’ailleurs, Israël ne s’en cache pas.
Israël n’est plus une démocratie. C’est un Etat ethnique qui pratique la discrimination.»
Comment qualifieriez-vous ce qui se passe aujourd’hui à Gaza? Allez-vous jusqu’à envisager la possibilité d’un génocide?
Cette question revient tout le temps. C’est un peu lassant. Les crimes internationaux sont définis par des conventions. Pour toutes les situations où il y a des crimes, il faut étaler des preuves devant des juges, qui décident ensuite le niveau de qualification. Il est évident que ce qui se passe à Gaza relève déjà depuis longtemps des crimes de guerre, et que devant l’ampleur qu’ils ont pris, on peut les qualifier de crimes contre l’humanité. Y a-t-il un génocide, c’est-à-dire la volonté de destruction totale ou partielle d’un groupe? Au fur et à mesure que la situation évolue, on se rapproche évidemment de cette situation. D’ailleurs, la Cour internationale de justice elle-même a dit qu’il y avait un risque accru de génocide. Elle tranchera dans quelques mois dans son arrêt, et pas dans un avis consultatif, l’affaire qui a été portée devant elle par l’Afrique du Sud. Voilà. Nous, simples particuliers, nous ne pouvons dire que ce que je viens d’énoncer, qu’il y a un risque accru de génocide, et que ce risque, chaque jour, augmente. Nous sommes bien sur une trajectoire génocidaire. Il faut donc obliger nos gouvernements à cesser d’êtres complices de cette situation.

Comment cette complicité pourrait-elle être établie?
La Convention sur le génocide, adoptée en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, a été pensée comme un projet dynamique avec l’ambition que «plus jamais, cela ne recommence». Elle inclut donc un devoir de prévention. La Cour internationale de justice l’a rappelé dans ses ordonnances. Les autres Etats du monde ont l’obligation de prévenir le génocide. On entend encore des responsables politiques défendre Israël parce que c’est une démocratie et parce qu’il a le droit de se défendre. Ces propos sont scandaleux. Israël n’est plus une démocratie depuis 2018 (NDLR: le 19 juillet, la Knesset a adopté une loi établissant qu’Israël est «l’Etat-nation du peuple juif»). Israël est un Etat ethnique qui pratique la discrimination. C’est dans sa «Loi fondamentale». Comment peut-on parler de démocratie? La «Loi fondamentale» d’Israël est contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est un Etat juif pour les Juifs. Les autres n’ont pas les mêmes droits. C’est totalement antidémocratique. Il faut arrêter de dire que c’est un Etat démocratique. Et il faut cesser de dire qu’Israël a le droit de se défendre contre les attaques du 7 octobre 2023. Le propos était acceptable à l’époque, si la défense avait été proportionnée. On en est maintenant à des années- lumière. Il faut avoir un langage clair sur ces points.
Sachant la proximité d’Israël avec le pouvoir américain, le sursaut moral peut-il venir de l’Europe?
Moi qui travaille énormément sur ce dossier, je n’en peux plus, moralement, d’être confrontée à des faits humainement insoutenables. Des enfants ont été opérés sans anesthésie, à même le sol. Des familles entières crient famine et se battent devant les rares camions qui amènent un peu de nourriture. Des enfants mangent de la terre. La population n’a plus d’eau potable… Nous sommes devant une horreur –il y en a d’autres dans le monde– mais dans celle-là, nous avons une part de responsabilité parce que si nous prenions des sanctions contre Israël, nous obtiendrions des résultats. Israël serait obligé de cesser ce qu’il fait. On assiste à quelques frémissements dans le chef de quelques dirigeants qui ont soutenu Israël et qui commencent à dire que, moralement, ce n’est plus possible. C’est le cas de quelques personnalités en France. C’est le cas de quelques gouvernements dont la position évolue, notamment celui des Pays-Bas qui en a rejoint d’autres, très peu nombreux, qui demandent qu’on applique l’article 2 de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Mais cela va beaucoup trop lentement comparé à la souffrance des Palestiniens.
Le droit international connaît une crise profonde, expliquez-vous. Est-ce la pire crise depuis sa création?
Quand j’enseignais encore à l’université, je disais à mes étudiants que la crise israélo-palestinienne était symbolique du droit international et que si elle arrivait à être résolue sur la base des principes du droit international, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, de l’égalité entre les peuples, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, etc., le droit international en sortirait consolidé. Or, c’est l’inverse qui se produit. Le droit international n’est pas en difficulté seulement sur ce conflit. Sur la question de l’Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU est totalement impuissant. Il est paralysé par le veto qui est une aberration des origines.

«Il est du devoir des forces vives de penser un après-ONU.»
Comment espérer sortir de cette crise?
Nous avons aujourd’hui une crise très grave. Je ne pense pas qu’on puisse la surmonter à petit frais. Les Nations unies sont dans une situation paradoxale. Le mécanisme central, le maintien de la paix, est mort par le fait que le Conseil de sécurité est paralysé par les membres permanents et leur droit de veto. Dans le même temps, les Nations unies mènent toutes sortes d’actions formidables. L’Assemblée générale, la grande tribune de toutes les nations du monde, continue, elle, à agir, mais ses résolutions ne sont pas contraignantes. Donc, elle est impuissante. Les agences de l’ONU, les organisations spécialisées font un travail important depuis plusieurs décennies de mise en œuvre de la solidarité entre les humains, que ce soit le Programme alimentaire mondial (PAM) ou les programmes sur l’environnement, sur le développement, dans la lutte contre la pauvreté, etc. Nous avons là un instrument formidable. Mais son mécanisme central est mort. Or, on n’opérera pas de réforme des Nations unies sur ce point parce que les articles 108 et 109 de la Charte exigent que toute transformation soit votée avec l’accord du Conseil de sécurité et le vote positif des cinq membres permanents. Dans la situation actuelle de tensions entre les trois grandes puissances impériales –la Chine, la Russie et les Etats-Unis–, il n’y aura jamais d’accord, même sur une réformette du Conseil de sécurité ajoutant quelques membres permanents, ce qui ne donnerait pas une très bonne réforme. Je pense qu’il est du devoir des forces vives, des ONG, de la société civile, des groupes d’intellectuels, des think tanks, etc. de penser un après-ONU, c’est-à-dire d’imaginer un nouveau système qui reprendrait tout ce que je viens de citer de positif au sein des Nations unies, que l’on améliorerait encore, et qui reverrait le mécanisme central du maintien de la paix pour éviter cette paralysie. Il faudra supprimer la catégorie de membre permanent. C’était une aberration, un principe aristocratique pour une organisation qui prône la démocratie. Les membres permanents sont là de manière définitive, ne sont pas soumis au vote quoi qu’ils fassent. Il faut mettre fin à ce principe. Mais le chemin sera long pour y arriver. La Société des Nations (SDN) a été créée après la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Ce fut un échec puisqu’il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Les Nations unies ont été créées après, c’était une amélioration par rapport à la SDN. Mais aujourd’hui, le système est usé. La question est de savoir si nous attendons une nouvelle catastrophe, militaire ou climatique, pour refonder un nouveau système, ou si nous décidons de prendre les devants et commençons à penser ce nouvel instrument avant la catastrophe.
(1) Rendre impossible un Etat palestinien. L’objectif d’Israël depuis sa création, par Monique Chemillier-Gendreau, Textuel, 160 p.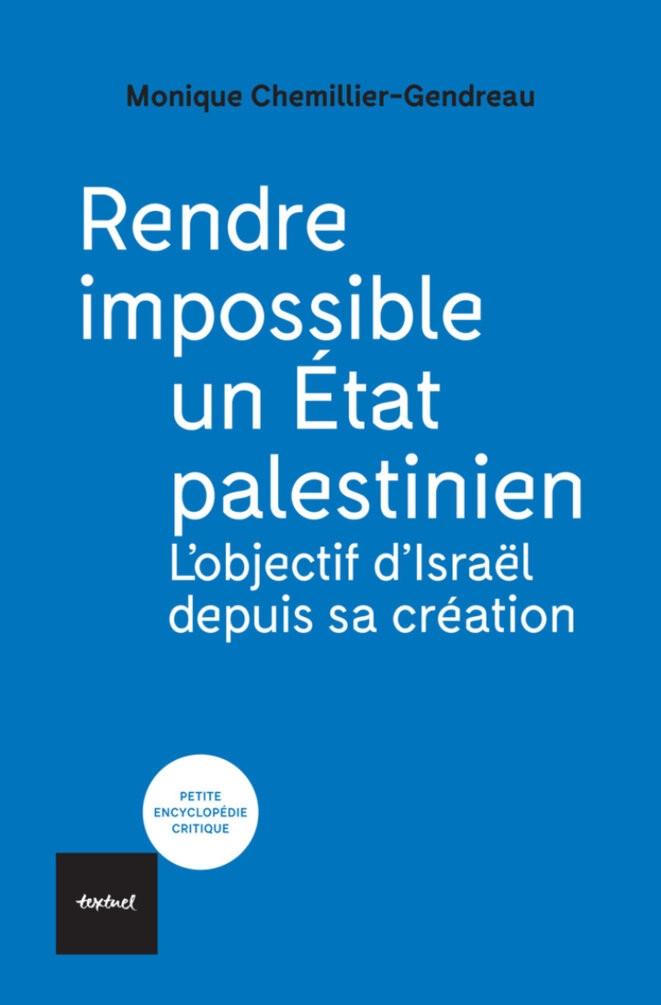
Une réaction européenne?
Les ministres européens des Affaires étrangères se sont réunis le 20 mai pour évoquer la situation dans la bande de Gaza. Au menu, notamment, la demande des Pays-Bas d’étudier une possible suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël entré en vigueur en 2000. L’analyse repose sur l’article 2 du texte qui stipule que «les relations entre les parties, ainsi que toutes les dispositions de l’accord lui-même, seront fondées sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, qui guide leur politique intérieure et internationale et constitue un élément essentiel du présent accord». La démarche néerlandaise fait suite à celle engagée par l’Espagne et l’Irlande dès février 2024 auprès de la Commission européenne. Elles lui avaient demandé d’évaluer le respect de cet article par le gouvernement israélien.
Que le gouvernement du Premier ministre Dick Schoof soit à l’origine de la relance de l’examen de cette question est symptomatique de la gravité actuelle du débat. Il est composé de formations de centre-droit, de droite et d’extrême droite, et les Pays-Bas sont traditionnellement des alliés de l’Etat hébreu.

