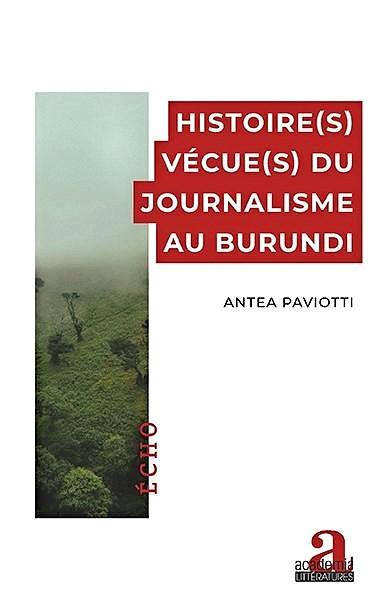L’anthropologue Antea Paviotti livre les récits de journalistes du Burundi. Entre pressions insistantes, répression véritable et quelques espaces de liberté abandonnés ou forgés.
Essor des fake news, défiance envers la profession, perte de diversité…: exercer le métier de journaliste en démocratie «libérale» est de moins en moins simple. Mais que dire de la pratique du journalisme dans des pays à pouvoir autoritaire? L’anthropologue Antea Paviotti en donne une touchante et précieuse illustration dans Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi (1). Pour cela, elle a interviewé 20 journalistes en exercice ou anciens au Burundi et quinze autres exilés en Belgique. Des récits des seize témoignages qu’elle a retenus pour son essai, ressort le constat qu’il faut un courage extrême et la conviction de son utilité sociétale pour poursuivre cette profession face aux nombreuses entraves. Le classement 2025 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières place le Burundi à la 125e place sur 180 pays et territoires évalués.
«Si on peut tendre le micro pour aider les communautés à se parler, il faut le faire.»
Lire aussi | Au Burundi, la lente asphyxie d’un pays oublié
L’étude d’Antea Paviotti traverse l’histoire contemporaine du Burundi. En fonction des séquences politiques, le travail du journaliste a pu être plus ou moins difficile. Et les méthodes pour échapper à la censure ou à la répression variées. Aucun n’a cependant échappé aux contraintes rappelées par l’autrice en introduction: «Les menaces d’un supérieur au travail, les conflits intrafamiliaux, les sensibilités tutsie et hutue à gérer […], le contexte sécuritaire…» Mais la manière de les affronter fut diverse selon les époques. Innocent Muhozi raconte ainsi qu’au début des années 1990, un de ses collègues a osé rétorquer «Clause de conscience; venez lire l’édito vous-même» à un ministre qui lui avait enjoint de lire sa prose lors du journal radio du matin. Alexis Sinduhije se rappelle avoir développé une façon de faire du journalisme pour éviter de s’attirer les foudres du pouvoir: «Il fallait trouver le prétexte des faits de société pour parler des questions politiques sans les prononcer. Et parfois, des ministres prenaient des mesures.»
Plus qu’en démocratie, le journalisme a tendance, dans ces pays, à avoir une finalité politique. Négative quand il sert les ambitions d’hommes de pouvoir qui «veulent juste exploiter les aspects de la profession qui les intéressent». Positive quand il encourage le vivre-ensemble: «J’ai toujours considéré que si on peut tendre le micro pour aider les communautés à se parler, au lieu que ce soit les kalachnikovs qui parlent, il faut le faire», juge ainsi Nestor Nkurunziza. L’évolution du journalisme reflète aussi celle de la société.
(1) Histoire(s) vécue(s) du journalisme au Burundi, par Antea Paviotti, Academia, 228 p.