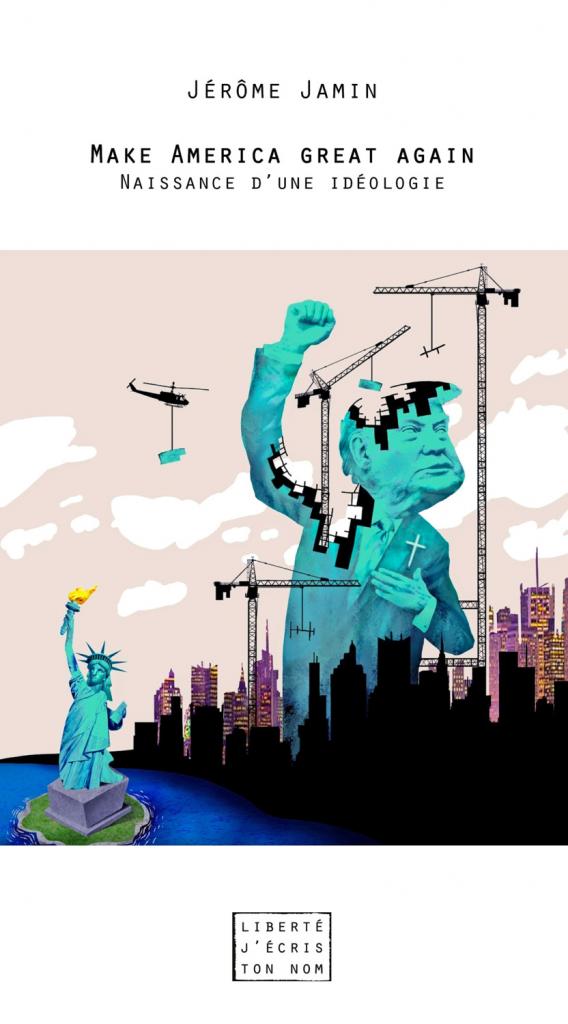Pour le président américain, la loi budgétaire votée au Congrès est «un pont vers l’âge d’or de l’Amérique». Pour d’autres, elle est un boulevard vers une dette abyssale et déroge à la doctrine trumpiste à peine forgée.
Deux «victoires monumentales». C’est ainsi que dans le camp de Donald Trump, on a salué l’arrêt, le 27 juin, de la Cour suprême limitant la capacité des juges fédérés à bloquer au plan national les décisions de l’exécutif qu’ils considèreraient comme illégales, et le vote, le 3 juin par le Congrès, de la loi budgétaire qui entérine des diminutions de taxes et impôts, et une augmentation du bugdet de lutte contre l’immigration illégale. Par corollaire, elle impliquera une hausse de la dette, déjà colossale (37.000 milliards de dollars) des Etats-Unis.
Conséquence immédiate, l’ancien allié et collaborateur de Donald Trump, l’homme d’affaires Elon Musk, a décidé de créer une formation politique, le Parti de l’Amérique. Celui qui présida aux destinées du Département de l’efficacité gouvernementale et, à ce titre, imposa pendant les premiers mois du mandat du président républicain des économies à l’administration, avait fustigé la prodigalité de la «Big beautiful bill». Mais il n’est pas sûr que la dissidence d’Elon Musk embarrasse grandement la marche en avant du président. Et pas davantage les conséquences du bilan extrêmement meurtrier (plus de 100 morts) des inondations qui ont frappé le Texas dans la nuit du 3 au 4 juillet. Il est loin d’être établi que les coupes dans le budget de l’Agence d’observation océanographique et atmosphérique aient eu un impact direct sur la catastrophe.
«Pour Trump, la démocratie ne peut fonctionner qu’avec un corps social ethniquement homogène, blanc et chrétien.»
Ainsi Donald Trump bâtit-il depuis le début de son second mandat une politique et même une idéologie, selon Jérôme Jamin, professeur de science politique à l’ULiège. Il en détaille la construction dans un essai intitulé Make America Great Again – Naissance d’une idéologie (1). Or, le dérapage annoncé de la dette auquel il a consenti serait en rupture avec les idées du Tea Party dont il s’inspire. Explications.
Le trumpisme s’est-il transformé en idéologie depuis le second mandat de Donald Trump?
Oui, incontestablement. Mais, comme toute idéologie, elle se construit à travers le temps. Sans doute, y aura-t-il des ajustements. En tout cas, les grandes lignes sont tracées. Il y a d’abord le projet nativiste. C’est l’idée que l’on défend l’Etat de droit, la république, et la démocratie, mais que celle-ci ne peut fonctionner qu’avec un corps social ethniquement homogène, en l’occurrence blanc, chrétien d’origine européenne, avec éventuellement des minorités, afro-américaines, latinos ou autres. Le projet était balbutiant il y a dix ans. Donald Trump parlait du mur à construire au sud des Etats-Unis, des Mexicains, dont certains étaient des trafiquants, et qu’il fallait empêcher de rejoindre le territoire américain… Mais il n’en parlait pas au sens ethnique. Aujourd’hui, il fait un usage assez intensif du nativisme: le corps blanc doit être majoritaire et la république ne peut fonctionner qu’avec cette homogénéité ethnique. Cette doctrine est ancienne aux Etats-Unis. Elle apparaît avec la naissance de la république. Elle a été au cœur du programme de Pat Buchanan, candidat à la présidentielle en 1992, 1996 et 2000 (NDLR: il est candidat sans succès aux primaires du Parti républicain lors des campagnes de 1992 et 1996; et se présente comme candidat du Parti de la réforme en 2000). Mais, à l’époque, cela ne passe pas. Il est considéré comme un raciste et un antisémite. Le nativisme apparaît aujourd’hui dans ses discours et dans quelques ordres exécutifs que Donald Trump a signés depuis le début de son second mandat. Pas mal de commentateurs aux Etats-Unis affirment que Donald Trump, c’est Pat Buchanan avec un meilleur agenda, ce dernier serait arrivé trop tôt sur la scène politique.

Qu’est ce qui forge l’idéologie trumpiste, à côté du nativisme?
Un autre volet, qui était en gestation, est maintenant clairement confirmé par les actes, c’est l’agenda du Tea Party. Ce mouvement apparaît un peu avant l’arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche et monte en puissance pendant son mandat. Son programme consiste en une glorification du travail dur et du mérite que ce soit dans le chef d’un individu, d’une PME ou d’une multinationale. Il développe aussi un discours très dur sur les impôts, qui doivent être réduits au maximum, et sur la dépense publique, qui ne doit pas être un gaspillage. Ce credo explique le rôle attribué à Elon Musk dans les premières mois du mandat, avec, cependant ici, une rupture par rapport à ce qui avait été promis. Certes, les taxes vont diminuer, comme le demande le Tea Party, mais la dette va augmenter. Tout n’est pas encore totalement cohérent dans la constitution de cette idéologie. Mais c’est le lot de beaucoup d’hommes et de femmes politiques de ne pas parvenir à mettre tout en œuvre au même moment.
Vous évoquez aussi le rapport du président avec les évangélistes…
Son positionnement par rapport à leurs idées est devenu plus clair. Donald Trump n’est plus ambigu sur le fait qu’il défend la famille traditionnelle et le couple «un homme, une femme». Il est ouvertement hostile à toutes les politiques visant à permettre à des gens de sortir de cette vision binaire et d’avoir d’autres identités. Il a durci sa position au fur et à mesure des années. Il a nommé à la Cour suprême des juges qui, eux-mêmes, sont conservateurs sur ces questions. A la suite d’un arrêt qu’elle adopté en juin 2022, l’avortement n’est pas interdit mais n’est plus protégé par la vie privée et il n’est plus une matière fédérale, mais une matière fédérée. Chaque Etat fait ce qu’il veut. Cet agenda a séduit l’électorat évangéliste qui, sans nécessairement apprécier Donald Trump, reconnaît qu’il met en œuvre ce que les autres n’ont pas su faire. En réalité, les évangélistes ont bien plus influencé et manipulé Donald Trump que lui-même les a manipulés.
Avant, on était dans un discours grossièrement populiste qui consistait à accuser les élites de tous les maux et de dire qu’on défendait le peuple. Maintenant, on voit à quoi ressemble le peuple, qui doit être aidé ou non, qui peut rester sur le territoire… On n’est pas devant une idéologie comme le socialisme ou le libéralisme qui peut se revendiquer de plusieurs siècles d’histoire avec des déclinaisons pays par pays. Mais le trumpisme commence à devenir très cohérent et on peut assez facilement voir où il mène…
La rupture concernant la dette par rapport au programme du Tea Party s’est-elle concrétisée dans le vote de la loi budgétaire?
La fameuse «Big beautiful bill» vise essentiellement à libérer le travail de la contrainte des taxes et des impôts. C’est donc moins de lourdeurs, moins de taxes, moins d’impôts sur les individus et sur les entreprises, ce qui implique une perte assez importante en termes de recettes, mesurée par le Bureau du budget, non-partisan, à plusieurs milliers de milliards de dollars. L’administration Trump tente encore d’en diminuer les effets en touchant au budget de Medicaid, le programme d’aide en matière de santé pour les plus pauvres. Les quatre postes qui, aux Etats-Unis, coûtent le plus à l’Etat et pèsent sur la dette, sont les pensions, les deux programmes de santé Medicare et Medicaid, la défense, et les intérêts de la dette. Donald Trump veut réduire l’accès à Medicaid pour réaliser des économies et diminuer les effets de l’endettement lié à la baisse des taxes et des impôts.
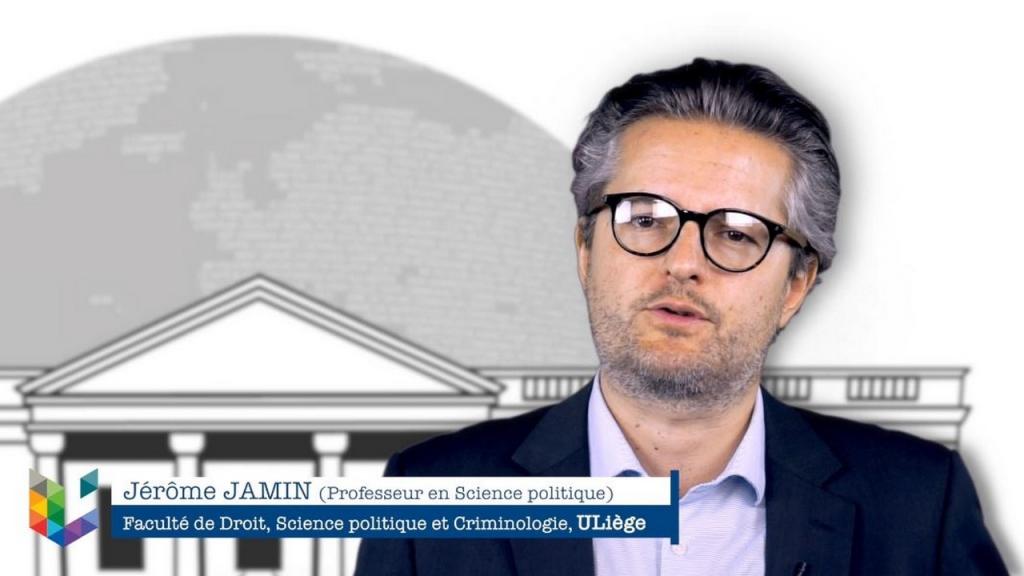
Le succès du mandat de Donald Trump dépendra-t-il de la part du gâteau qui sera réservé aux classes moyennes et populaires? Ses premières mesures ne suscitent-elles pas déjà du mécontentement parmi ses électeurs?
Les deux éléments qui vont jouer, ce sont l’emploi et l’inflation. Avant, il n’y avait que l’emploi. Comme il y a très peu de filets sociaux aux Etats-Unis, une personne sans emploi est assez vite à la rue, sauf si elle a de grosses économies. Si durant la dernière année du mandat de Trump, l’économie va mal et que le taux de chômage augmente, c’est mécanique, le Parti républicain le payera. S’est ajouté à cela le problème de l’inflation. Mais il n’y a pas de raison que cela moins sensible avec Donald Trump que cela ne l’a été avec d’autres présidents. C’est toujours comme cela.
«La politique migratoire divise. Le creusement de la dette divise. Difficile de mesurer la proportion des mécontents.»
Quant aux conséquences des mesures déjà prises par Donald Trump depuis le début de son second mandat, certains affirment à propos des taxes douanières par exemple, qu’il est trop tôt pour les percevoir mais qu’elles sont inévitables. Quoi que Trump fasse, le mal est fait, selon certains économistes. A propos de la lutte contre l’immigration illégale, il y a clairement un mécontentement général, y compris donc chez les électeurs de Donald Trump. Il s’explique par le fait que les agents de la police douanière et de contrôle des frontières arrêtent de façon indiscriminée tous les illégaux alors que le programme du candidat Trump indiquait que ne seraient concernés que les voleurs, les violeurs, les trafiquants… Un certain nombre d’électeurs trumpistes se retrouvent avec un voisin, un ami, un travailleur illégal bien intégré avec des enfants scolarisés et un emploi qui, du jour au lendemain, est raflé dans la rue. Cette politique migratoire divise. Le creusement de la dette divise. Il est difficile de mesurer la proportion des mécontents. Mais Donald Trump a encore la main. Aux élections de mi-mandat, le problème ne viendra pas de lui mais des démocrates. Certains devraient capitaliser sur un certain nombre de thèmes pour pouvoir revenir en force mais je ne suis pas sûr qu’ils en soient capables. Pourtant, il y a matière.

A propos des inondations qui ont frappé le Texas dans la nuit du 3 au 4 juillet, pourrait-il y a voir un lien entre la réduction du personnel de certaines agences, le retard apparent dans l’alerte des citoyens, et l’ampleur du bilan humain (au moins 104 morts)?
Il est impossible de le dire à ce stade. Mais ce genre de drames, accompagné d’une réduction des dépenses dans un service public précis, pourrait être utilisé «intelligemment» par les démocrates. Mais ceux-ci me paraissent tellement dépassés par la situation que je ne suis même pas sûr qu’ils parviendront à en faire une affaire politique. Donald Trump, en revanche, utilise tout et n’importe quoi pour politiser des tragédies. Au moment des incendies de forêts à Los Angeles, il a réussi à dire que c’était la politique de diversité de la ville, dirigée par le Parti démocrate, qui, par son laisser-aller sur la question des transgenres et de l’égalité homme-femme, avait conduit à ce que le corps des pompiers n’ait pas été aussi efficace que par le passé. Il fallait oser. Les démocrates devraient dénoncer les effets de la diminution du budget d’un certain nombre d’agences pour protéger les gens au niveau de la santé, de l’environnement, des catastrophes naturelles … Mais je ne suis pas sûr au vu de leur situation qu’ils en soient capables.
(1) Make America Great Again – Naissance d’une idéologie, par Jérôme Jamin, éd. Liberté j’écris ton nom, Centre d’action laïque, 112 p.