Le reportage de RTL-TVI sur les fraudes aux allocations sociales a fait grand bruit. Avec des tickets de caisse pour représenter les aides aux allocataires sociaux, l’angle était pourtant assumé. Mais d’autres chiffres illustrent la complexe question de la fraude sociale.
«Attention, ils vont te voler ton iPhone comme ça, en direct.» Dès la première scène, le décor du reportage de RTL‑TVI portant sur la fraude aux allocations sociales est planté. La rue de Dison, à Verviers, connue pour avoir hérité du titre officieux de la plus pauvre du pays, héberge l’équipe médiatique pour un reportage qui a défrayé la chronique médiatique ce week-end. Plans de drones, musiques graves, passage en revue des dépenses du foyer pour les animaux de compagnie, le travail médiatique se veut minutieux. Il présente par ailleurs les allocations auxquelles les personnes interrogées ont droit sous forme d’un ticket de caisse. Laetitia, une maman solo de 37 ans, cumule donc ainsi 1.776 euros de revenus du CPAS avec 900 euros d’allocations familiales, plus des avantages sur les transports, les soins de santé ou le logement social à bas prix. «Tout roule», sourit le présentateur, Christophe Deborsu.
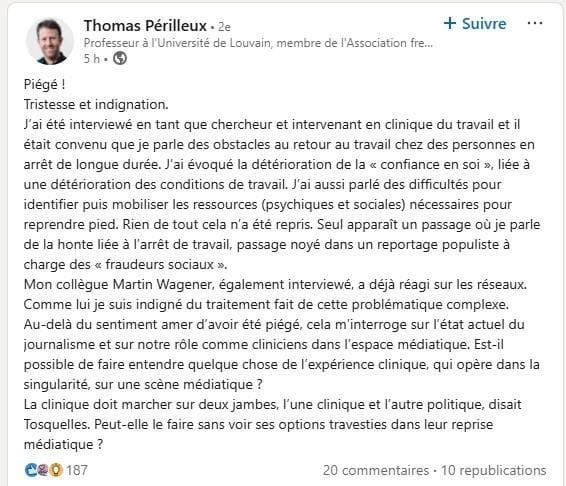
Sur les réseaux sociaux, après la diffusion de l’émission, tous les universitaires questionnés dans le reportage font part de leur indignation concernant le traitement de leurs interviews. Le Vif a voulu savoir pourquoi.
Quand la fraude aux aides sociales devient une question de survie familiale
14%. C’est le pourcentage de familles monoparentales en Wallonie et à Bruxelles. Le chiffre est 5% plus élevé qu’en Flandre. C’est déjà une piste pour estimer la surcharge qui pèse sur les CPAS du sud du pays, alors que le reportage montre comment la présidente du CPAS de Verviers, Gaëlle Denys (PS), «peut comprendre» (ce qu’elle a corrigé également sur ses réseaux sociaux) pourquoi des couples émargeant au CPAS ne se domicilient pas ensemble afin de ne pas voir leurs allocations minorées. «Le problème repose sur le statut de cohabitant, pose le vice-président du Cirtes (UCLouvain), Martin Wagener, et auteur d’une thèse sur la monoparentalité et le travail. Dès qu’on a un petit amoureux, on devient un fraudeur social.» En clair, il déplore que les droits sociaux reposent sur les foyers plutôt que les individus.
«Toutes les femmes questionnées dans le reportage –à l’exception d’une– disent avoir l’attrait du travail. Mais il faut que le travail assure un niveau de vie significativement augmenté à ces personnes.»
Car c’est bien une question d’individus, et surtout du nombre d’individus, puisque 75% des dossiers de CPAS destinés à des parents s’adressent à des familles monoparentales, selon une étude réalisée par Martin Wagener notamment. «Et le taux d’emploi des familles monoparentales diminue en fonction du nombre d’enfants à charge, note le chercheur. C’est logique, s’il n’y a pas de grands-parents, ou une solidarité qui est d’ailleurs souvent féminine, il est difficile de travailler tout en s’occupant de ses enfants.» Surtout à Verviers, poursuit en substance Martin Wagener, où les offres de travail sont plus rares, qu’il faut souvent quitter la ville pour bosser, ce qui implique de trouver une crèche, d’espérer un job aux heures qui conviennent à la garde des enfants, et de garder la santé pour l’assumer.
«Qui sait vivre avec un salaire de 1.500 euros net par mois ?»
Pourtant, des mères célibataires qui bossent et qui souffrent du boulot, il en existe un paquet. Elles y sont cependant parfois contraintes, puisque seulement un ex-conjoint sur 150 verse des pensions alimentaires pour les enfants dont elles ont la garde principale. «Je constate que toutes les femmes questionnées dans le reportage –à l’exception d’une– disent avoir l’attrait du travail, souligne Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Mais il faut que le travail assure un niveau de vie significativement augmenté à ces personnes. Changer de mode de vie, c’est une prise de risque considérable. C’est pourquoi il faut assurer que le travail soit plus rémunérateur, ce qui n’est pas toujours le cas. Qui sait vivre aujourd’hui avec un salaire de 1.500 euros net par mois ?» D’autant plus que le travail peut exclure du statut de Bénéficiaire d’Intervention Majorée (le statut BIM) qui permet des réductions tarifaires dans les services publics payants, et donc fait retomber le travailleur dans la pauvreté, assure la militante, qui milite pour un abaissement du plancher d’accès.
Martin Wagener, de son côté, plaide pour un retour graduel au travail, en passant d’abord par des temps partiels, comme c’est souvent le cas pour les retours de burn-out afin de préserver la santé de ceux qui réintègrent le système. Et puis, il faut des employeurs prêts à confier du boulot et en payer le prix. «L’article 60 (NDLR: qui permet à un allocataire du CPAS de travailler, y compris dans une entreprise privée, tout en étant payé par le CPAS et de conserver ainsi ses droits au chômage notamment) est un bon outil mais il aboutit difficilement à un vrai contrat après un stage, note Martin Wagener. Il faut que les personnes arrivent au travail dans un contexte convenable, et accentuer la formation au travail. L’Allemagne a fait un programme en ce sens lors de l’arrivée massive des Syriens; ça a été du bonus pour tout le monde.»
Par ailleurs, pointe Christine Mahy, le non-recours aux droits sociaux représente un volume bien plus important que la fraude. Au-delà de la fraude, entre 37% et 51% des personnes ayant droit au revenu d’intégration sociale (le RIS, versé par le CPAS) n’y font pas appel. Mais ça, c’est moins sexy et sensationnel que des images floutées de la rue de Dison à Verviers.

