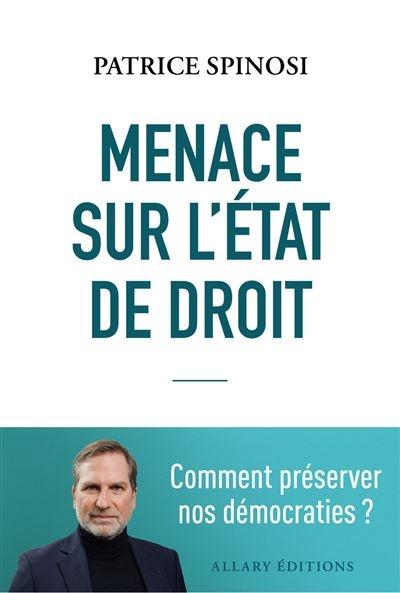L’avocat Patrice Spinosi s’inquiète de la multiplication des attaques contre l’Etat de droit opérées «de l’intérieur» des démocraties. Il faut conforter le rôle des contre-pouvoirs.
Donald Trump «ne tolérera pas» la poursuite du procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Tel est le message que le président américain a cru pouvoir adresser à la justice israélienne le 28 juin au lendemain de la décision d’un tribunal de rejeter la demande du chef de gouvernement israélien de suspendre les auditions de son procès en raison des «développements dans la région et le monde». Donald Trump avait même réclamé auparavant l’annulation du procès arguant que «les Etats-Unis dépensent des milliards de dollars par an […] pour protéger et soutenir Israël» et expliquant qu’une grâce devrait être accordée à ce «grand héros».
Avec l’accession au pouvoir de dirigeants populistes, les attaques contre les principes de l’Etat de droit, dont l’indépendance de la justice, sont de plus en plus fréquentes. Donald Trump y a donc ajouté une tentative d’atteinte transnationale à l’Etat de droit. L’avocat français Patrice Spinosi, amené à plaider régulièrement devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, s’inquiète de cette tendance dans Menace sur l’Etat de droit (1) et explique, de façon pédagogique, en quoi elle est extrêmement dangereuse.
Quand s’est imposé le concept d’Etat de droit, et que recèle-t-il?
C’est l’idée selon laquelle un gouvernement ne peut pas être entièrement libre et doit se soumettre à des règles. L’Etat de droit, en tant que tel, a été pensé par les juristes du XIXe siècle. Mais son incarnation telle qu’on la connaît aujourd’hui a véritablement été mise en œuvre à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il a été pensé comme une nécessité pour éviter les excès auxquels un certain nombre de pays européens avaient pu se livrer pendant cette période. Les pères fondateurs de l’Europe voulaient signifier que la démocratie, ce n’est pas que l’élection, c’est aussi un accord de principe sur certaines libertés essentielles: liberté d’expression, liberté d’aller et venir, droit à un procès équitable… Pour être une démocratie, il faut au moins garantir ces libertés-là. C’est l’Etat de droit dans lequel nous vivons encore aujourd’hui.
Vous citez des exemples de pays où les infractions à l’Etat de droit sont nombreuses. Les Etats-Unis sont-ils celui où elles sont les plus inquiétantes?
J’ai décrit la mécanique de l’instauration de l’Etat de droit il y a 70 ans. Un certain nombre de personnes éprouvent une lassitude à l’égard de cette notion et soutiennent des formations politiques qui proposent autre chose. Ce sont des partis populistes qui n’aspirent plus à une démocratie libérale telle qu’elle existait mais à ce qu’on appelle une démocratie illibérale. Ce n’est pas vraiment une dictature; ce n’est pas vraiment une démocratie; c’est une sorte d’entre-deux. Elle existe depuis quinze ans en Hongrie. Elle a eu cours pendant dix ans en Pologne avec le gouvernement du parti Droit et justice (PiS). Et elle s’installe très clairement aux Etats-Unis depuis le deuxième mandat de Donald Trump. Les Etats-Unis livrent un exemple frappant de la manière dont un leader populiste peut, par sa volonté politique, dévitaliser les contre-pouvoirs qui s’opposent à lui avec une grande efficacité et une extrême violence. Il est très inquiétant de voir à quelle vitesse la démocratie américaine que l’on pensait être un modèle a été fragilisée par un dirigeant populiste…

Ce qui est étonnant d’observer à la lecture de votre livre, c’est qu’il y arrive sans commettre d’actes illégaux, en apparence. Nos démocraties ne sont-elles pas armées pour éviter ces dérives?
C’est toute la subtilité des démocraties illibérales. On n’est plus face à un risque de renversement d’un gouvernement par une dictature. Aujourd’hui, le danger vient de l’intérieur. Des personnes légitimement élues comme Donald Trump ou Viktor Orbán utilisent les pouvoirs qui sont à leur disposition –dans le cas du premier, les «executive orders»–, leur donnent une portée qu’ils n’ont pas, et, une fois ces actes posés, considérent que toute action judiciaire qui peut être exercée contre leur politique est illégitime. De la sorte, ils dénaturent la démocratie.
Une fois élus, les populistes refusent la contradiction politique. A partir de ce moment-là, nous ne sommes plus dans des régimes démocratiques. Parce que la démocratie est un régime qui, certes, est assis sur le fait majoritaire, mais qui garantit aussi le respect des minorités. Ce n’est pas le cas aujourd’hui aux Etats-Unis où Donald Trump refuse toute opposition à son action. Il refuse le contre-pouvoir des juges, gardiens de l’Etat de droit. Il les décrédibilise quand il ne refuse pas purement et simplement à certains moments d’appliquer leur décision.

«En cosignant cette lettre, la Belgique montre que les demandes des dirigeants populistes ne sont pas illégitimes.»
Cette offensive contre l’Etat de droit dépasse-t-elle le cadre des partis populistes? Neuf Premiers ministres de pays européens, pas tous populistes, dont la Belgique, ont mis en cause la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, estimant qu’elle rendait impossible l’application de leur politique migratoire…
Le populisme peut prendre plusieurs formes. De droite, avec le Rassemblement national en France ou le Vlaams Belang en Belgique. De gauche, avec La France insoumise. Et puis, il y a le populisme d’opportunisme, que l’on retrouve au centre de l’échiquier politique. Il existe en France chez le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui déclare que l’Etat de droit n’est ni intangible ni sacré, et, de la même manière, en Belgique. C’est très dangereux. Que la Belgique ait été signataire de cette lettre où plusieurs gouvernements s’opposent à la Cour européenne des droits de l’homme en remettant en cause sa légitimité démontre que l’on est bien face à une forme de populisme d’opportunisme. La Belgique n’est pas le leader de cette initiative. Elle émane de gouvernements beaucoup plus engagés dans des démarches populistes, qu’il s’agisse de celui de Giorgia Meloni en Italie ou de celui de Mette Frederiksen au Danemark. Mais en cosignant cette lettre, la Belgique, qui a une grande tradition de respect des libertés et une proximité intellectuelle avec la Cour européenne des droits de l’homme, montre que les demandes de ces populistes ne sont pas illégitimes puisque même elle est prête à y adhérer.
Les réactions à la condamnation de Marine Le Pen ont-elles marqué un tournant à cet égard en France?
Certainement. Remettre en cause une décision de justice dans le chef d’une personnalité politique, c’est un signe de populisme et c’est faire le jeu de l’illibéralisme. La mécanique des gouvernements populistes consiste à s’attaquer systématiquement aux décisions de justice rendues à leur encontre en décrédibilisant l’autorité judiciaire. Il est parfaitement légitime de critiquer une décision de justice. On peut s’opposer à la décision, mais pas au juge. Après la condamnation de Marine Le Pen, on a assisté à une mise en cause de la juridiction en tant qu’institution qui, selon Marine Le Pen et un certain nombre d’autres personnes, n’aurait pas eu la compétence pour pouvoir la condamner. On en arrive ainsi à une inversion des valeurs puisque Marine Le Pen affirme que cette condamnation a été contraire à l’Etat de droit alors même qu’elle n’est que l’illustration de la mise en œuvre de ce même Etat. Il y a aussi là un enjeu de rapport au réel et à la vérité qui est souvent biaisé par les populistes. C’est le cas évidemment de Marine Le Pen et aussi de Donald Trump qui en a fait une arme de gouvernement.
Ces attaques ont-elles été favorisées par des mesures d’exception prises pendant les périodes de crises liées aux attentats islamistes et à l’épidémie de Covid?
Le populisme d’opportunisme des gouvernements républicains en France encourage cette tentation de développer des législations d’exception. Le fait que ce type de gouvernement y ait recours légitime a posteriori l’attitude des populistes s’ils arrivent au pouvoir. S’ils veulent rétablir l’état d’urgence, par exemple , ils peuvent arguer qu’il n’y a pas d’atteinte à l’Etat de droit puisque des gouvernements dits «républicains» l’ont fait précédemment. Ce faisant, les états d’urgence, les législations antiterroristes, les mesures prises en matière de surveillance et de contrainte se généralisent. Et on assiste à une banalisation des atteintes aux libertés des citoyens.

Mettre la sécurité comme une priorité politique absolue, est-ce un danger pour l’Etat de droit, comme vous le suggérez dans votre livre?
Il est certain que la sécurité est importante. Il n’y a pas de doute qu’un gouvernement doit garantir au citoyen sa sécurité. Ce qui est beaucoup plus discutable, c’est l’instrumentalisation qui est faite de l’opposition entre la sécurité et la liberté. On peut garantir la sécurité et la liberté, heureusement. C’est le principe même d’une démocratie. S’il fallait abandonner toute liberté pour garantir la sécurité, cela voudrait dire que les dictatures seraient les pays les plus sûrs du monde. Cela n’est pas le cas. La réalité est qu’il est tout à fait possible de combattre de façon efficace la délinquance et l’insécurité sans pour autant rogner sur les libertés de l’ensemble des citoyens.
Quelles seraient les conséquences, pour l’Etat de droit, d’une accession au pouvoir du Rassemblement national?
L’opposition entre le pouvoir et les juges aboutirait à un conflit de légitimité qui, en réalité, serait voulu par le pouvoir politique avec un gouvernement qui considérerait que les décisions rendues par les juges ne doivent pas être appliquées parce qu’ils ne représentent pas le peuple souverain, contrairement à eux. On en arriverait à une crise institutionnelle entre le juridique et le politique. Il y aurait aussi très certainement une opposition aux autres contre-pouvoirs que sont notamment la presse avec des restrictions à la liberté d’expression, ce que l’on appelle des «procédures-ballons» à l’égard de certains journalistes, etc. Nous sommes susceptibles d’être confrontés à ces éléments si demain le Rassemblement national arrivait au pouvoir en France.
Dans les solutions que vous suggérez, fondamentaliser certains droits essentiels en les inscrivant dans la Constitution est-elle une piste importante?
C’est du moins une des voies que je propose. L’idée est de mettre à l’abri des gouvernements populistes certains droits essentiels. On l’a fait en France avec le droit à l’avortement aujourd’hui constitutionnalisé. C’est ce que l’on pourrait faire avec le droit au secret des sources, qui est une garantie pour les journalistes. Autre piste, assurer une meilleure indépendance des contre-pouvoirs, comme l’autorité judiciaire. Un exemple: en Allemagne, en raison du risque de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, le Parlement a modifié les règles d’organisation et de nomination des magistrats à la Cour suprême constitutionnelle. Ce type de mesures peut mieux armer les contre-pouvoirs face à la montée des populistes.
«On peut garantir la sécurité et la liberté, heureusement.»
Le législateur devrait toujours garder à l’idée la façon dont la réforme qu’il envisage est susceptible d’être mise en œuvre par un gouvernement populiste, écrivez-vous. Les politiques actuels n’en ont absolument pas conscience?
Le but de ce livre est d’en faire prendre conscience aux citoyens pour qu’ils poussent les politiques. Ceux-ci ont aujourd’hui une vision très court-termiste de leur action. Ils n’envisagent absolument pas la manière dont les législations qu’ils votent seraient susceptibles d’être instrumentalisées par d’autres politiques bien moins attachés aux libertés fondamentales qu’ils ne le sont. C’est un vrai danger. Il serait extrêmement important pour notre démocratie qu’ils prennent cet élément en considération et que ces questions fassent l’objet d’un débat public.
Vous tablez beaucoup sur les citoyens, les associations, la société civile. N’êtes-vous pas trop optimiste sur leur pouvoir?
Je crois à la démocratie comme étant un bienfait du peuple pour le peuple. Je ne pense pas que le peuple se jettera volontairement dans la limitation de ses propres libertés. Il faut essayer de faire prendre conscience à certaines personnes du caractère très éphémère et précaire des libertés. Les gens sont plus attachés aux libertés qu’on ne le croit. Il n’y a aucune fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à aller vers le populisme. Tout au contraire, des exemples comme Donald Trump montrent le risque auquel nous sommes confrontés. Le débat public est le meilleur moyen en démocratie de faire avancer les choses vers le bien général.
(1) Menace sur l’Etat de droit, par Patrice Spinosi, Allary, 242 p.