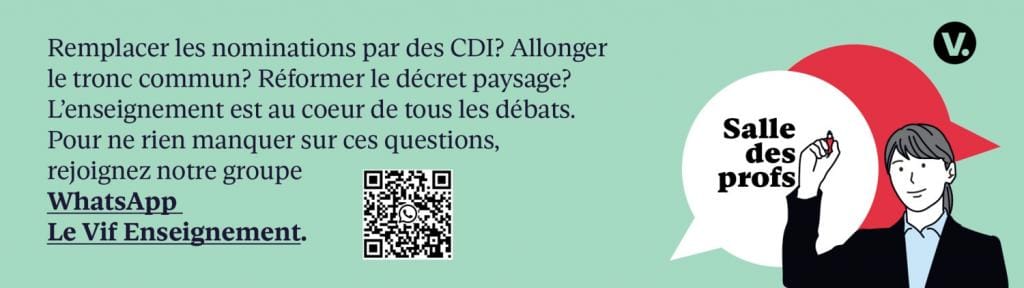Le Vif a lancé «Salle des profs», un espace de dialogue centré sur les préoccupations des enseignants. Au menu de cette première table de discussions: le triangle relationnel «professeurs-parents-élèves». Compte-rendu.
«Quand on lit certains commentaires sur Facebook, on a juste envie de déchirer son diplôme de prof!» La petite phrase, lâchée par Ludovic après 60 minutes de débat, traduit le malaise dans lequel sont plongés de nombreux enseignants en 2025. A contre-courant de ce «prof-bashing» alimenté par les réseaux sociaux, Le Vif a lancé «Salle des profs» (1), une initiative qui réunit un panel d’enseignants pour discuter des préoccupations du secteur.
Lors de la première édition, neuf professeurs du primaire et du secondaire étaient invités à s’exprimer sur le triangle relationnel entre enseignants, parents et élèves. Comment appréhender cette forme de coéducation, aux enjeux pourtant différents? Quelle place doit occuper l’enfant au sein de ce «partenariat» familial et scolaire?
La complexité de la réponse varie généralement selon le degré d’implication des parents. Cléo, enseignante dans un institut technique, confie avoir «très peu de contacts avec eux». «Mes élèves sont âgés de 16 à 22 ans, et certains sont en internat la semaine, donc beaucoup s’autogèrent naturellement», justifie-t-elle. Mais même aux réunions de parents, l’enseignante avoue être confrontée à de nombreuses absences.
Un problème moins courant en primaire, où la proximité parents-profs fait légion. Devant la grille de l’école, à la garderie ou à la fancy-fair, «les contacts sont quasi permanents», confirme Nicolas, instituteur dans une petite école de village hainuyère. Une communication directe et régulière qui permet de «désamorcer les conflits» et d’«éviter les différends». Si tout n’est pas toujours rose, Aurélie, institutrice à Schaerbeek, confirme que «plus le parent participe régulièrement aux activités, plus il devient partie prenante de notre vision pédagogique».
Cette transition entre les degrés primaire et secondaire est d’ailleurs parfois difficile à appréhender, observe Johan, enseignante d’arts plastiques dans un établissement provincial. Comme leurs enfants, les parents qui arrivent «à la grande école» doivent subitement faire face à un contexte différent, plus anonyme et moins intimiste. Et accepter que leur voix sera parfois moins entendue.
De son côté, Brigitte relève les obstacles linguistiques qui empêchent parfois de maintenir (voire d’initier) un lien avec les parents d’élèves. «Certains ne comprennent pas un mot de français, ce qui complique l’entretien d’une véritable relation», confie l’enseignante dans un athénée bruxellois. Pour réduire ce fossé, l’établissement met en place toutes sortes d’initiatives et fait notamment appel à des traducteurs lors des réunions de parents. «Même si ça ne fonctionne pas toujours, les parents sont en général très reconnaissants de ce que l’école met en place pour eux», assure la sexagénaire.
Accessible en un clic
Et si la clé pour pallier ces difficultés résidait dans une implication renforcée de l’élève dans ce triangle relationnel? Florie, professeure dans un collège bruxellois, plaide pour ce modèle plus inclusif. Son établissement a d’ailleurs mis en place une initiative originale: à chaque fin de trimestre, le journal de bord n’est remis à l’élève qu’en présence d’un parent. «C’est l’enfant, et pas l’enseignant, qui présente ses résultats à son papa ou à sa maman et qui évoque ses difficultés éventuelles, précise la professeure. Ça permet de rendre l’élève acteur de ses apprentissages, sans parler de lui à la troisième personne.»
«Dans notre école, c’est l’enfant qui présente ses résultats à ses parents. Il est ainsi acteur de ses apprentissages.»
Si, par le passé, les échanges avec les parents se résumaient aux remarques dans le journal de classe, ils passent aujourd’hui massivement par les canaux numériques. Une évolution qui a laissé de nombreux parents au bord de la route, qu’ils soient insuffisamment formés à ces nouvelles technologies ou simplement peu enclins à les utiliser. «Chez nous, on est passé au tout-numérique du jour au lendemain, se remémore Johan. Mais on a rapidement remarqué que beaucoup de parents ne se connectaient jamais et manquaient des informations importantes. C’est pourquoi on a remis en place un carnet de liaison papier.» Une solution intermédiaire entre l’ancien et le nouveau modèle.
Dans les écoles à faible indice socioéconomique, ces outils numériques sont d’autant plus complexes à appréhender, rappellent Brigitte et Ludovic. «Aujourd’hui, notre politique est de recentrer la communication uniquement sur les messages importants», précise le second. Pour faciliter la compréhension, son établissement a même traduit une partie de ses règlements en «Falc» (Facile à lire et à comprendre), une expression de langage simplifiée, qui bannit par exemple l’usage de métaphores.
L’apparition des nouveaux outils a rendu l’enseignant «disponible en un clic». Tom, professeur d’éducation physique dans un enseignement à pédagogie active, en a observé les dérives. «Quand on a commencé à utiliser la plateforme numérique Smartschool, certains parents envoyaient un e-mail à 20 heures et s’étonnaient de ne pas avoir de réponse le lendemain à 7 heures», se remémore-t-il. Face à une situation «intenable», l’établissement a instauré une charte d’utilisation, fixant un délai de réponse de quatre jours ouvrables maximum.
«Notre politique est de recentrer la communication avec les parents uniquement sur les messages importants.»
Trop is te veel?
L’essor de ces canaux a malgré tout permis de renforcer le lien avec les parents, estime Aurélie, qui utilise l’application Classdojo dans son établissement. «On partage des anecdotes, des résumés de nos activités, des photos, et on remarque que les parents sont très demandeurs, souligne l’institutrice. On peut communiquer avec eux directement via des chats, ce qui est très utile pour les petits rappels quotidiens.» Mais ces canaux ne sont pas toujours utilisés aussi intensivement par chaque membre de l’équipe enseignante, pointe Nicolas, qui souligne un «choc des générations». Ce qui crée parfois une déception chez certains parents, habitués à un échange régulier avec tel professeur, puis désarçonnés par une absence de nouvelles l’année suivante avec un autre.
Mais pour Cleo, trop de communication tue la communication. «Entre l’école en ligne pour le bulletin, les e-mails, le site Internet de l’école, la page Facebook, le parent finit par s’y perdre, regrette l’enseignante. D’autant que toutes ces plateformes nécessitent des mots de passe différents, que certains oublient parfois. Bref, cette surabondance de lieux où chercher l’information nuit à la qualité des échanges.» Sans parler de la jungle des acronymes qui rend le jargon éducationnel particulièrement complexe à appréhender. «Il faudrait peut-être envoyer un glossaire aux parents», sourit Laurent, professeur d’anglais dans la province du Luxembourg.
Plusieurs enseignants confient s’être rendu compte de cette surcharge d’informations quand leurs propres enfants ont commencé à être scolarisés. «Ce n’est pas évident d’être parent avec le rythme effréné et ultraconnecté d’aujourd’hui, concède Florie. C’est pourquoi on a décidé, dans notre établissement, que l’enfant devait rester notre interlocuteur premier. On intègre le parent dans la boucle uniquement en cas de préoccupation plus importante.»
La maternité a également influencé Aurélie dans son approche relationnelle avec les parents d’élèves. Elle a notamment appris à intégrer le bagage émotionnel que transportent certains pères ou certaines mères. «Au début de chaque réunion de parents, j’essaie de les questionner sur leurs ressentis propres, de sonder leur contexte familial», confie l’institutrice. Une manière également de briser la glace et de rassurer les parents qui ont «parfois peur du jugement». «Certains ne sont pas à l’aise, ils pensent que si leur enfant est violent, c’est de leur faute, et qu’on va juger leur éducation. Or, on est là pour coconstruire un cadre bienveillant avec eux.»
«Si le prof doit pallier les manquements éducatifs des parents, la qualité de de l’enseignement risque d’en pâtir.»
Collectif vs individuel
Un bagage émotionnel parfois difficile à prendre en compte, par manque de temps ou faute de sensibilisation. «J’ai quitté ma formation sans avoir été préparé à la dimension relationnelle, regrette Nicolas. Cela fait quinze ans que j’enseigne et c’est seulement maintenant que je commence à réussir à décoder le profil des parents, à adapter ma communication au cas par cas et à lire entre les lignes lorsqu’ils s’adressent à moi.»
Un sens du feeling loin d’être inné, qui s’avère pourtant primordial pour désamorcer les potentiels différends avec les familles. Car, comme Florie le rappelle, les parents et les professeurs, bien qu’alliés potentiels, évoluent dans un système qui ne répond pas aux mêmes enjeux: «L’école est une institution collective, rappelle-t-elle. Or, le parent répond davantage à une logique individuelle. S’il voit son enfant en souffrance, il voudra intervenir. Alors qu’un peu d’altérité est parfois nécessaire pour aider l’enfant à interagir en société. Et donc, finalement, cette individualité risque de mettre en péril la structure collective.»
D’où l’importance d’instaurer une confiance à tous niveaux. Interrogée sur le profil du «parent idéal», Aurélie insiste: «Un bon parent, c’est un parent qui fait confiance à tout le monde. A la fois à l’école dans laquelle il a inscrit son enfant, mais aussi à l’enseignant et à son projet pédagogique. Sans oublier à l’enfant, qui est finalement le premier acteur concerné.»
Et Laurent de compléter: «Un bon parent, c’est également celui qui éduque son enfant au vivre-ensemble, aux règles de politesse. Cette éducation se fait aussi à l’école, mais si le prof doit pallier tous ces manquements de base, la qualité de l’instruction et des apprentissages risque d’en pâtir.»
Bref, le parent devrait à la fois baliser le cadre éducatif de son enfant, indispensable à son épanouissement scolaire, tout en laissant la liberté à l’école d’y apposer son regard pour le faire coïncider à son projet collectif, conclut Cléo. Un idéal salué par de nombreux hochements de tête.
(1) Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin.