Alors que la «coéducation» est prévue depuis 2009, les parents peinent toujours à trouver leur place à l’école. Ce qui génère des tensions. Les profs, eux, se plaignent de parents trop présents ou absents. Enquête sur ce paradoxe.
«Y aura-t-il des sorties cette année?» Ce parent ne s’en doute pas au moment de lever innocemment la main à la réunion de rentrée: sa question a le don d’irriter les enseignants. «Dans ces moments-là, je me dis que les parents n’en ont rien à faire de notre pédagogie», déclare Cécile, institutrice. Pourtant, cette année, comme depuis douze ans, elle a souri, forcément, et répondu «oui, trois sorties scolaires sont prévues».
Sur le malentendu entre les parents et les enseignants, les anecdotes sont légion. La preuve? La littérature abondante qui lui est consacrée. Ici, ce sont des profs qui livrent des conseils pour «communiquer sereinement avec les parents», «se préparer à un entretien avec des parents d’élèves» ou des «kits pour gérer les relations parent-prof-élève». Là, comme pour leur répondre, ce sont des parents eux-mêmes qui proposent un «manuel de survie à l’usage des entretiens parents-profs» ou une «méthode pas à pas pour communiquer avec un enseignant».
Y aurait-il un tel monde, entre l’école et hors de ses murs, pour qu’il faille des leçons pour parler «le prof»? Il semblerait que oui. Même si, depuis 2009, la «coéducation» est un mot d’ordre, une volonté politique, prônée dans le Pacte pour un enseignement d’excellence. Et qu’une certaine défiance commune existe toujours. «Les profs ont peur du jugement des parents, et réciproquement, admet Cécile, institutrice. Moi-même, quand j’ai débuté, je me cachais un peu des parents. Je craignais qu’ils me trouvent trop jeune. Certains d’ailleurs m’en avaient fait la remarque.»
A qui en attribuer la faute? D’abord aux parents et aux évolutions sociétales, répond le monde enseignant. En témoigne la récente enquête internationale Talis, présentée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L’institution a sondé quelques 280.000 enseignants et chefs d’établissement du secondaire inférieur dans 55 systèmes éducatifs. Le résultat est sans appel: en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), moins de 50% des profs se disent valorisés par les parents de leur école, contre une moyenne de 65% au sein de l’Union européenne. Dans une étude sur le climat et le bien-être scolaire, menée en 2022 et 2023, des chercheurs de l’UCLouvain et de l’ULiège ont notamment interrogé les enseignants sur leur perception du lien école-parents. En primaire, les profs attribuent un score de 7,8 sur une échelle de 10 quant à l’existence d’un «dialogue constructif et attentif avec les parents». En secondaire, il est de 6,7 sur une échelle de 10.
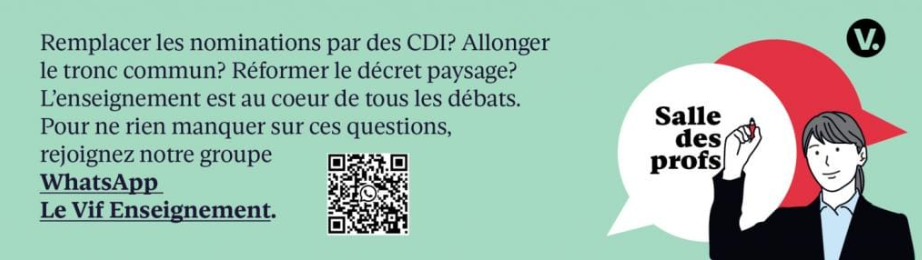
Au-delà des chiffres, il y a aussi les constats dressés par le «terrain». Individualisme, consumérisme, démission face aux écrans, punitions jugées «injustes» ou «abusives», hyperattention concernant leur enfant, forcément «dys», «hyperactif» ou «HPI». «Le prof est souvent la cible des parents qui le jugent responsable de tous les problèmes d’éducation de leurs enfants. Ils donnent systématiquement la priorité à leur parole», poursuit ce préfet. Les contentieux portent principalement sur les questions d’échec, l’orientation et les règles disciplinaires.
Essor d’un «individualisme expressif»
Ces contestations de l’expertise alimentent le sentiment de dévalorisation chez les enseignants. Sans compter l’explosion des recours visant les décisions du conseil de classe. Entre 2013 et 2023, leur nombre a grimpé de 50% dans le secondaire. Alors que durant la même période, la population scolaire, en secondaire, a augmenté de 5,2%. «Que les fonctions d’autorité souffrent n’est pas neuf. C’est vrai pour le prof comme pour le médecin qui se fait contredire ou pour le pompier que se fait agresser, observe Marc Romainville, professeur en sciences de l’éducation (UNamur). L’essor de « l’individualisme expressif » (chacun a le droit de se prononcer sur tout et de le faire sous une forme plus expressive) est un mouvement général qui remet en cause l’autorité qui autrefois été associée au statut. Désormais, c’est par l’action, et non plus la fonction, que l’on obtient l’autorité.» Cet individualisme expressif a également multiplié la capacité des élèves à contester, à remettre en question.
«Désormais, c’est par l’action, et non plus la fonction, que l’on obtient l’autorité.»
A première vue, il y a de quoi s’en réjouir. Seulement, dans les classes, ce n’est pas toujours simple. Du côté «adverse», le malaise est tout aussi perceptible. Dans la même étude sur le climat et le bien-être scolaire, seule la moitié des parents a le sentiment d’être bien accueillie dans l’école de leur enfant. Ils sont autant à se dire plutôt ou tout à fait d’accord avec l’affirmation «les membres du personnel de l’école communiquent bien avec les parents». «En réalité, les relations entre les enseignants et les parents n’ont jamais été simples. Ils ont tendance à se rejetter mutuellement les responsabilités, dans une sorte de match de ping-pong», relève Marc Romainville.
Au cours des dernières décennies, le rapport école-parents a lui aussi évolué. «Historiquement, l’institution scolaire s’est construite sur la mise à distance des familles. Mais on n’en est plus là, constate Jean-François Guillaume, professeur en sociologie de l’éducation à l’ULiège. A la fin des années 1990, les missions de l’école ont été fortement élargies par décret: l’enseignement doit veiller à l’épanouissement personnel de l’élève, à sa socialisation, à sa citoyenneté… Ce qui va conduire l’enseignant à non plus seulement instruire, mais aussi éduquer, un rôle jusque-là réservé aux familles. Les grilles se sont ouvertes. Et certains parents se montrent plus intrusifs. «La coéducation exige un partage des rôles marqué, insiste Jean-François Guillaume. L’enseignant transmet des savoirs communs et forge du collectif. Le parent met l’enfant en position de travailler. Chacun son rôle.»
Voilà pour la théorie. Sur le terrain, cette logique de coéducation se heurte à de multiples réalités: l’individualisme, la numérisation, la décomposition et recomposition des familles, les inégalités socioéconomiques.
Des intérêts divergents
«Globalement, d’après mon expérience et celle de mes collègues, la relation est bonne, surtout dans le fondamental. En tout cas, ce n’est pas l’état de guerre», note Véronique de Thier, codirectrice de la Fédération des associations et des parents de l’enseignement officiel. Même sentiment du côté de l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec). «L’école n’échappe pas aux maux de la société, mais l’immense majorité des parents n’en reste pas moins respectueuse du cadre», note Bernard Hubien, son secrétaire général.
Il suffit pourtant de peu pour que le ton monte. Au-delà de conflits plus ou moins graves et rares, la multitude de petites tensions quotidiennes mine les rapports entre le corps enseignant et les parents. C’est cette enseignante titulaire qui reçoit des courriers «des parents mécontents parce qu’elle et l’équipe éducative ont simplement décidé de séparer leurs garçons trop bavards l’an prochain». Elle doit aussi faire face à cette mère qui l’accuse «d’isoler affectivement» son enfant après l’avoir changé de place.
Les parents d’élèves et les enseignants ont en fait des intérêts divergents: «Les premiers ne réfléchissent souvent qu’en termes d’intérêt personnel, tandis que les seconds doivent œuvrer pour le bien collectif. Forcément, ça fait des étincelles», regrette Bernard Hubien. L’attitude des familles trahit évidemment une inquiétude croissante. La peur du chômage et du déclassement social met à rude épreuve les nerfs des parents mais aussi ceux de l’école, qui fait plus que jamais fait office de garde-fou. «Ce n’est pas étonnant dès lors que notre système éducatif repose sur le processus de sélection sociale interne, ce qui revient à dire que ce qui se passe à l’école qui décide de votre avenir social», précise Marc Romainville.
Si les fédérations des parents admettent que ce n’est pas le conflit permanent, elles ne donnent pas non plus un blanc-seing au corps enseignant. De fait, parmi les parents qui s’adressent à leurs représentants, on retrouve des familles qui se plaignent d’être très peu informées des progrès ou des difficultés de leur enfant et, surtout, beaucoup de parents d’enfants à besoins spécifiques qui tous, ou presque, déplorent la capacité d’adaptation aléatoire de l’école.
De son côté, l’école a, elle aussi, intensifié ses attentes par rapport aux parents, qu’elle accuse d’être tantôt «démissionnaires», tantôt «intrusifs» ou «consuméristes». «Elle leur en demande trop et l’institution peut se montrer intrusive ou jugeante à leur égard, avance Véronique de Thier. Dans le contexte anxiogène actuel, on sait par ailleurs que les ados sont plus stressés. Or, la façon dont l’école fonctionne amplifie leur mal-être.» En général, les tensions s’accroissent au fur et à mesure que l’élève progresse dans sa scolarité. En maternelle, le parent est bienvenu jusque dans la classe. En primaire, il est toléré jusque dans la cour de récréation. Enfin, en secondaire, il est souvent prié de ne pas franchir la grille. La rencontre « parents-profs » consiste parfois, en tout et pour tout, à s’entendre dire par l’enseignant que « tout va bien ».
Or tout est fait pour faciliter un rapprochement. «Toutes les structures sont pensées pour que les parents soient présents», note Véronique de Thier. Plusieurs textes ont renforcé les droits des parents, qui devenaient «membres de la communauté éducative», notamment au sein du conseil de participation, obligatoire dans chaque établissement. «D’une école à l’autre les situations sont différentes, avance Bernard Hubien, mais nombre de conseils de participation ne fonctionnent pas comme ils devraient, parce les élèves n’osent pas y participer, parce que les parents n’y sont pas investis ou encore parce que les enseignants y sont absents. Nous devons être en permanence dans un travail de sensibilisation pour réexpliquer l’apport des parents.»
Face à une confiance aveugle en l’école, la déception est d’autant plus forte si l’élève se retrouve en échec.
Aujourd’hui, les enseignants ne sont toujours pas formés aux relations avec les parents, notamment au seul public qui se montre encore inhibé face à l’institution scolaire: les classes (très) populaires. Des «parents invisibles, éloignés de l’école», à tel point que certains ont renoncé à franchir la grille de l’établissement. «Contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas démissionnaires. Beaucoup ont une confiance aveugle en l’école. Leur déception sera d’autant plus forte, et les réactions, potentiellement plus violentes, si l’élève se retrouve en échec», tempère Marc Romainville.
Faire ce travail d’approche n’a rien d’impossible. De nombreux personnels enseignants l’entreprennent. Ainsi Cécile, institutrice, prévoit chaque année une semaine sans écrans avec des ateliers auxquels les parents peuvent participer, un bal de fin d’année, des contes hebdomadaires qu’ils sont invités à lire. «Il s’agit d’éviter de les voir uniquement lors des convocations, c’est-à-dire quand ça va mal.» Ou comme Sébastien Wille, directeur, dont l’établissement a ouvert, à côté de l’école, un «espace-parents» qui regroupe une salle à manger, une cuisine, un salon, une salle informatique et, pour les plus jeunes, un coin de jeu. Parents et enseignants s’y retrouvent dans un cadre neutre et différent. Ce contexte extrascolaire peut aussi aider à régler différents problèmes en privilégiant la discussion.
«Les ressources sont nombreuses, mais les moyens manquent pour les mettre en application à grande échelle, relève Jean-François Guillaume. Il faut que l’école et les parents s’accordent sur des finalités communes et s’inscrivent dans un « nous ».» Pour Véronique de Thier, c’est aussi tout un changement d’état d’esprit à amorcer: «Instaurer un dialogue respectueux et constructif passe par respecter la légitimité et la posture de chacun.» Pour tous les observateurs, cela mettrait fin au gâchis, sachant que les systèmes éducatifs où les échanges entre profs et parents sont les plus fluides –les pays scandinaves, l’Ecosse, …– sont ceux qui, dans les grandes enquêtes statistiques, comptent parmi les plus performants.
Les systèmes éducatifs où les échanges entre profs et parents sont les plus fluides sont les plus performants.

