Le philosophe et romancier surdoué Tristan Garcia revient avec Ames, premier tome d’une trilogie au projet ultra-ambitieux et désespéré, roman multiple sur l’histoire de la souffrance… Rencontre.
Il y a dix ans, le philosophe normalien Tristan Garcia décrochait le prix de Flore avec son premier roman, La Meilleure Part des hommes. Depuis, il mène une double carrière de front : celle d’enseignant-chercheur en philosophie (à Lyon-III), ponctuée d’essais ( Forme et objet. Un traité des choses en 2011, La Vie intense : une obsession moderne et Nous en 2016) ; celle de romancier, avec des ouvrages stylisés dans la forme et conceptuels dans le fond, de plus en plus salués par la critique et les jurys ( Faber en 2012 ; 7 en 2015). Ames, épais premier tome d’une trilogie romanesque consacrée à » l’histoire de la souffrance « , constitue un nouveau projet colossal entamé sans fanfare, un pari ambitieux relevé sans frémir : à 37 ans, jeune père, Garcia livre une série de récits incarnés autour de la thématique de la souffrance des créatures vivantes, des origines de l’Univers à l’an 869, du ver originel aux Aborigènes d’Océanie, en passant par les grands empires, voire la Judée d’un certain » prophète nazaréen « . Le tout avec finesse et humour, en suivant quatre » âmes » perdues dans le temps puis réincarnées, qui se croisent et se perdent pour tisser une histoire aux dimensions infinies. Assurément, un inépuisable objet précieux, dont on attendra impatiemment les suites.
Je me représente souvent le passé lointain comme l’authentique cadre de l’enfer.
Ce premier tome de la trilogie annoncée couvre les origines du monde jusqu’au ixe siècle. Comment s’inscrira-t-il dans un ensemble consacré à rien moins que l’histoire du monde ?
Le projet romanesque est de montrer comment quatre âmes dont je suis la trajectoire se trouvent ou se ratent. Dans l’idée, ce tome-ci constitue une sorte d’enfer laïcisé, avec des masses de chairs souffrantes, des secrétions corporelles et une violence brute. Je me représente souvent le passé lointain comme l’authentique cadre de l’enfer, bien plus que ce qui pourrait nous attendre après notre mort » si on a été méchant » : quand on pense à la masse de corps, de souffrances accumulées avant notre naissance… on peut la voir comme une sorte d’ » humus » de l’histoire. Si vous ne croyez pas en un dieu, la masse de tortures infligées par les êtres vivants à eux-mêmes est vertigineuse. Après cet enfer, le deuxième tome couvrira ce que j’appelle » notre modernité » : le présent au sens large – une forme de purgatoire, la foi qui se déplace vers la possibilité de la connaissance adossée à la technique, à partir du monde arabo-andalou. Et le troisième se projettera, de manière science-fictionnelle, dans l’avenir proche et lointain, en quête d’une sorte de paradis contrarié, d’une humanité qui vise une suspension de l’enfer par l’abandon progressif de la douleur physique.

Comment définir simplement la souffrance ?
D’un point de vue électrochimique, elle est la traduction d’une séparation dans un organisme (ou de la possibilité d’une séparation) par un message nerveux, lui-même traduit par un message chimique. A ce titre, le livre est très matérialiste : la souffrance naît d’une séparation initiale à partir de laquelle je fais débuter l’histoire. La vie apparaît avec la première de ces impulsions électrochimiques. Et pour moi, le but de l’entreprise en tant que romancier est d’être à la fois ultradistant pour regarder de très loin la vie et tout ce qui a souffert, souffre et souffrira, tout en étant à chaque époque au plus près des corps qui éprouvent de la douleur, à travers l’exercice de l’empathie. J’ai aussi veillé à construire mes récits sur le principe de l’immanence : j’ai évité au maximum la transcendance du romancier, en plaçant le lecteur dans une situation de tâtonnement au début de chaque chapitre. Il est ainsi au plus près du langage et des conceptions de l’époque concernée, à la découverte de ce nouveau monde. Même si cela peut le dérouter dans un premier temps.
Les » âmes » dont nous suivons les trajectoires et interactions, à des époques et en des lieux divers, se rattachent chacune à une couleur. Que signifient-elles, et faut-il y voir un lien avec la théorie des quatre humeurs de la médecine antique ?
Le défi était d’incarner les âmes en couleur, sans trop systématiser ni imposer une lecture sommaire au lecteur : comment présenter des entités reliées mais pourtant installées à des époques différentes, qui ne vont avoir ni le même sexe, ni le même âge, ni le même nom, ni forcément la même espèce ? J’avais au départ testé un modèle plus sonore ou musical, comme si chaque âme était une tonalité, ou se distinguait entre majeure et mineure, quelque chose comme ça – mais ça ne fonctionnait pas. Finalement, ces couleurs correspondent effectivement aux quatre humeurs de la tradition médicale. » Bleu » est le mieux défini dans le livre : c’est celui qui croit à la possibilité de revenir à l’océan commun, à la fusion primordiale ; c’est Jésus, c’est Buddha, c’est un individu mystique ou religieux porté par l’idée que l’horizon d’une réunification générale est envisageable. » Rouge » est le contraire, c’est l’être qui, sous l’impulsion de la colère, vit le scandale irrémédiable de la souffrance, et y répond en l’infligeant à son tour. » Jaune » est plus intellectuel, mélancolique, automnal et saturnien – il s’installe souvent plutôt du côté des puissants, mais reste rongé par la bile. Quant à » Vert « , c’est celui qui pousse comme un végétal, qui fait avec ce qu’il y a de vie à un moment donné. Beaucoup moins intellectuel, il prend souvent la figure d’un jeune être encore impulsif. » Vert » est toujours sous l’autorité d’un(e) » Bleu(e) » ou d’un(e) » Rouge » ; plus naïf, il est curieux, aime croire aux histoires. Dans le deuxième tome, les couleurs renverront plutôt aux tissus de la médecine moderne ; puis aux molécules de la biochimie, dans le dernier. D’autres couleurs vont aussi apparaître au fur et à mesure, qui sont seulement esquissées, comme le noir, le blanc ou le gris.
La littérature est le seul endroit où l’on puisse essayer d’appréhender une vision grandiose de la vie.
Ces » âmes » s’attirent et se repoussent, aussi, sentent parfois qu’elles ont quelque chose en commun, sans pouvoir déterminer quoi…
Oui, c’est une manière de mettre le doigt sur ces atavismes dont nous sommes tous les sujets, comme ces colères individuelles ou sociales mues par des impulsions qu’on ne saurait définir. D’où vient votre haine du puissant, par exemple, sinon de l’impression vague d’avoir été floué ? De fait, les rois vous ont toujours volé quelque chose (rires). C’est en deçà de la raison, ça suscite des principes d’affinité ou d’inimitié, de reconnaissance de complémentarité bien plus profonds, voire antérieurs à notre seule expérience existentielle.
Pour autant, faites-vous vôtres ces théories de la métempsycose ou de la réincarnation ?
Non, pas du tout, j’en use comme d’un simple principe narratif. C’est aussi pour moi une manière de lutter contre ma propre tendance matérialiste à penser que quand c’est fini, il ne reste rien. Et si, et tant qu’il reste des êtres sensibles, il demeurait dans les mémoires des résidus de ce qui est passé ? Les âmes seraient alors le seul principe d’explication de cet état de fait déroutant, qui viendrait charger les êtres de pulsions qui les dépassent.
Comment questionner la vie sans s’abandonner soit à une lecture religieuse soit à une vision froidement scientifique ?
Par la littérature. Elle seule permet, par exemple, de tenter de raconter avec vraisemblance la souffrance d’un ver de terre comme d’un vagabond du premier siècle sans verser ni dans un discours moral et normatif, ni dans une évacuation froide, et donc dangereuse, de la notion d’individu sensible. La littérature est à mon sens le seul endroit où l’on puisse essayer d’appréhender une vision grandiose de la vie, d’être juste avec chaque forme d’individu humain ou non humain. Ce n’est ni le cas dans le discours religieux, ni dans le discours scientifique, et encore moins dans la vie de tous les jours. Dans les premiers chapitres, je déroule un récit qui ne propose ni une cosmogonie religieuse, ni le prologue d’un manuel de théorie de l’évolution. Car il existe une troisième manière, littéraire, de raconter le monde, avec un point de vue qui ne vise ni la pure objectivité – évacuant l’empathie -, ni une subjectivité passant par un Etre de tous les êtres que nous serions contraints de présupposer. La littérature permet d’insérer un coin entre ces deux grands récits qui nous prennent en tenaille. Qui plus est, l’exercice permet de rendre hommage à la richesse de tous les grands textes et récits produits par l’homme : le Ramayana, L’Iliade et l’Odyssée, les grands livres chinois, médiévaux… Les deux plus longs chapitres du deuxième tome, que je suis en train d’écrire, sont consacrés l’un aux Mongols – à mon sens, les premiers qui mondialisent, avec l’invention des relais-postes, des armées de traducteurs…-, l’autre à la Conquista, de la découverte et du sac sauvage de l’Amérique du Sud par les Espagnols.
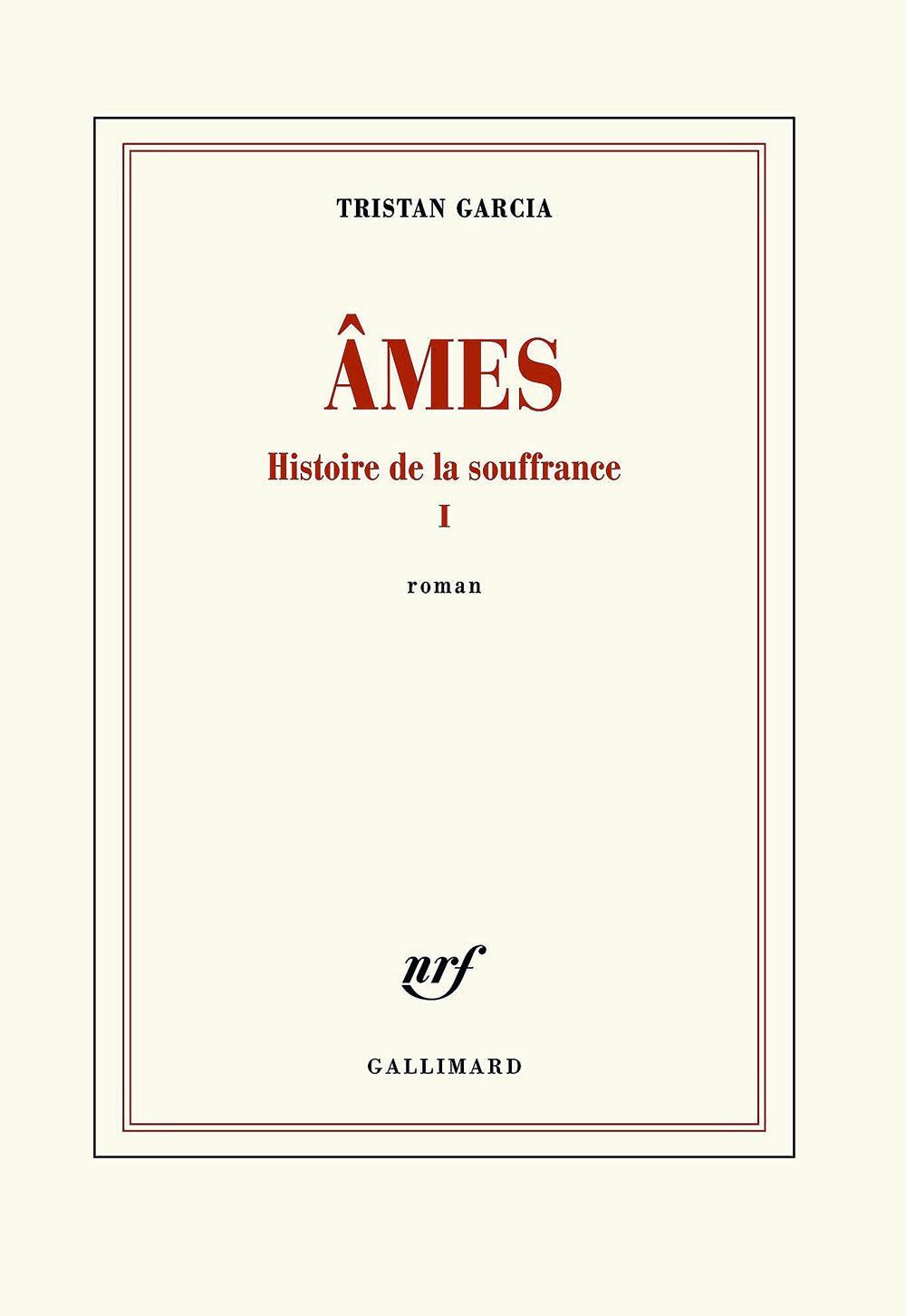
Avec, toujours, un soin particulier apporté à une narration portée par les » vaincus « , les victimes – petit peuple, esclaves, femmes, communautés persécutées. A la manière de l’Ecole des Annales ?
Tout à fait. J’essaie aussi de ridiculiser l’héroïsme tel qu’il apparaît dans les récits épiques, colportés toujours par les vainqueurs, sinon par les langues et les cultures de ceux qui l’ont emporté – le point de vue impérialiste. Ici par exemple, quand les guerriers grecs reviennent de leur victoire troyenne, je préfère les montrer comme ce qu’ils sont vraiment : des nobles violents, soucieux de leur gloire, cupides et prêts à toutes les compromissions pour accéder à un pouvoir qu’ils estiment leur dû. Qui plus est, le fait de m’intéresser aux recoins de l’histoire, d’aborder l’Egypte ancienne sans évoquer Ramsès II, permet de s’attaquer à des récits pour lesquels la documentation est plus faible, et d’offrir par conséquent plus de place au champ littéraire.
