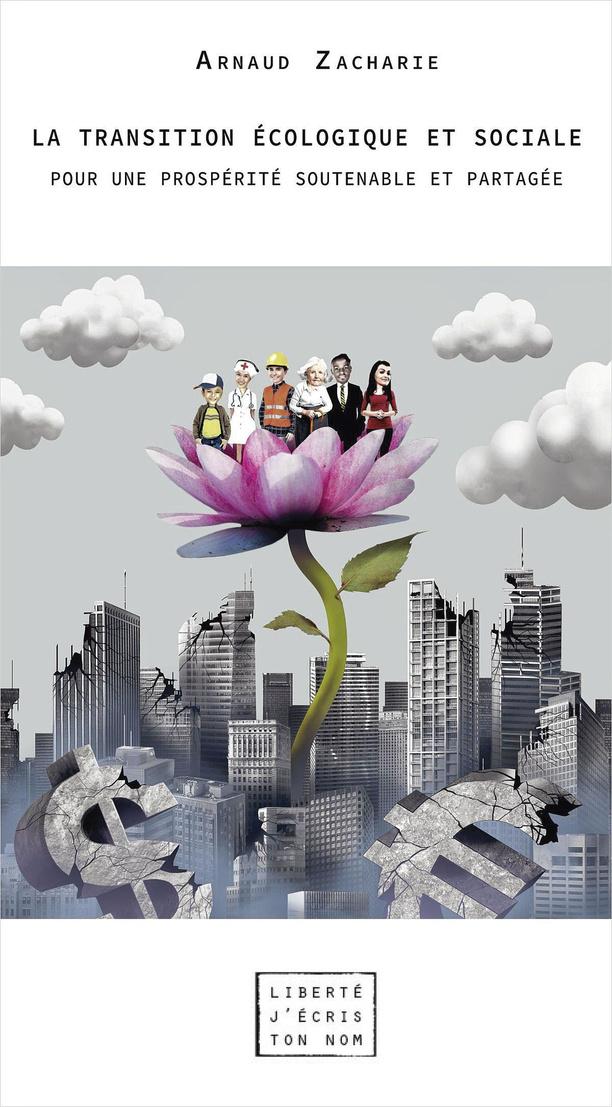Saurons-nous profiter de la crise planétaire pour instaurer un new deal écologique mais aussi social et réveiller ainsi nos démocraties? Dans un livre court, dense, inspirant, Arnaud Zacharie donne des clés.
Dans le marasme sanitaire et économique actuel, le livre d’Arnaud Zacharie exhale une bouffée d’espoir. Bardé de diplômes, enseignant à l’ULB et l’ULiège, le patron du CNCD (1) n’a rien d’un naïf ni d’un idéaliste candide. Plutôt un clairvoyant engagé, désireux de faire bouger les lignes. Justement, la pandémie de Covid-19 est une opportunité inédite pour amorcer ou accélérer des changements, pour que le « monde d’après » ne soit pas la copie conforme du « monde d’avant ».
« Le choc que nous vivons est tout à fait inédit, constate Arnaud Zacharie. La société mondiale dans son ensemble, pas seulement l’économie, est solidement mise à l’arrêt à cause d’un minuscule virus qu’on n’a pas vu venir et qui crée la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. On ne pourra pas relancer le système à l’identique comme on l’a déjà fait après une crise traditionnelle, notamment celle de 2008. »
Covid, puissant révélateur
Le coronavirus est « un puissant révélateur des crises globales de notre temps », diagnostique d’emblée, dans son dernier ouvrage (2), ce docteur en sciences politiques et sociales pour qui « les leçons à tirer ne se limitent pas seulement au domaine de la santé ». Le choc de la pandémie révèle d’abord une crise environnementale car il s’agit d’une zoonose, une maladie transmise de l’animal à l’homme. « Or, on sait que les zoonoses, qui sont à l’origine de trois quarts des maladies infectieuses de ces dernières années, sont favorisées par la destruction des écosystèmes et de la biodiversité. »
Le virus a aussi exacerbé une crise sociale déjà patente. Les plus pauvres sont les premières victimes du confinement. « Une étude de l’ONU indique que 8% de la population mondiale risque de tomber dans la pauvreté à cause des retombées de la pandémie. Lesquelles ont entraîné, en Belgique, une chute de revenus de 30% pour les catégories les plus vulnérables. Or, plus de 40% des Belges n’avaient déjà plus d’argent à la fin du mois », nous déclare le directeur du CNCD, qui ajoute: « Les questions environnementales et climatiques sont intimement liées à celle des inégalités. Elles en sont même le reflet, puisque les 10% les plus riches de la planète produisent 50% des émissions de gaz à effet de serre, contre 7% d’émissions pour les 50% les moins nantis. »
On a besoin de leaders qui fixent un cap et qui s’y tiennent.
Green New Deal transatlantique
D’où sa proposition d’un Green New Deal, inspiré du projet outre-Atlantique du même nom, dont la députée démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez a fait son cheval de bataille et que Joe Biden a intégré partiellement dans son programme. Soit une transition écologique et sociale. A ne pas confondre avec le Green Deal lancé par la Commission européenne, qui est exclusivement environnemental. « Viser les seuls objectifs climatiques sans tenir compte de leurs effets sociaux risque d’alimenter le discours national- populiste des Trump et Bolsonaro ou de provoquer des mouvements comme les gilets jaunes qui dénonçaient justement la taxe sur les carburants, alors que le gouvernement français venait de supprimer l’impôt sur la fortune », prévient Arnaud Zacharie.

Pour ce dernier, la transition écologique ne sera pas possible ni acceptée sans davantage de justice fiscale et sans réduction des inégalités sociales. Dans son opus, truffé de références, il rappelle que l’OCDE elle-même a observé que la hausse des inégalités avait eu un effet négatif de 8% sur la croissance, entre 1990 et 2010. « Une société plus égalitaire aura un effet positif sur la croissance de secteurs comme les énergies renouvelables, alors que vont décroître des secteurs comme les énergies fossiles appelées à devenir des actifs échoués, qui s’effritent sous l’effet de l’évolution des marchés et des décisions des gouvernants », assure-t-il. Et, pour lui, le PIB, soit l’addition de la valeur ajoutée des biens et services produits, ne doit pas rester l’unique indicateur des politiques. En congelant si vite l’économie, la Covid montre que d’autres indicateurs sont nécessaires: tel un indicateur sur le respect de l’écosystème ou un indicateur santé, une population en bonne santé faisant mieux tourner les entreprises.
Entre risques et opportunités
La crise sanitaire et le « grand confinement » constituent une opportunité exceptionnelle pour repenser le « monde d’après ». D’autant que le choc est mondial. « Mais il n’y a pas de fatalité. Pour cela, on a besoin de leaders politiques qui fixent un cap et qui s’y tiennent, avertit Arnaud Zacharie. Ce n’est pas par hasard qu’on se réfère, ces derniers temps, à Roosevelt. Personne n’imaginait, à l’époque, qu’il deviendrait le père du New Deal à l’origine de l’Etat- providence. » Rien n’est jamais écrit dans les astres. La crise de la Covid comporte également des risques, notamment en exacerbant le repli identitaire et l’obsession sécuritaire dont se nourrissent les leaders populistes qui ont de plus de plus le vent en poupe, de la Suède à l’Espagne en passant par la Belgique et l’Autriche, pour ne parler que de l’Europe.

Pour Zacharie, la meilleure manière de répondre au nationalisme populiste est de renforcer la coopération internationale et européenne, comme les politiques l’ont fait justement après la Seconde Guerre mondiale. Cette coopération est aussi indispensable « pour permettre aux Etats de réguler les acteurs transnationaux, comme les multinationales, à qui profite le rapport de force actuel, et d’enrayer la course au moins-disant social, fiscal et environnemental », écrit-il dans son livre. Il cite une étude du Bureau international du travail qui montre que, loin d’être une charge pour l’économie, la protection sociale est un facteur de productivité économique. Pour preuve, plus un pays est développé, plus ses dépenses sociales sont importantes. La pandémie montre, par ailleurs, que la protection sociale permet d’amortir les chocs des crises les plus graves.

Réveiller nos démocraties libérales
« Le problème est que les gouvernements sont liés à la discipline des marchés. Ils ont perdu l’habitude de leur dicter les choix démocratiques pour lesquels ils ont été élus, surtout depuis le tournant néolibéral des années 1980. La crise sanitaire est, pour eux, une solide occasion de reprendre la main », insiste le patron du CNCD pour qui le diagnostic de la fatigue démocratique est double: il s’agit à la fois d’un problème de légitimité et d’efficacité. La légitimité peut être ravivée en développant la démocratie interactive et délibérative, comme le fait, par exemple, la Communauté germanophone de Belgique, qui, l’an dernier, s’est dotée d’une assemblée citoyenne. L’efficacité, elle, dépendra du retour de l’Etat stratège et régulateur, de sa capacité à prendre des décisions qui garantissent la sécurité sociale – au sens large – des populations, selon Arnaud Zacharie.
La crise Covid comporte des risques, notamment en exacerbant le repli identitaire.
Ce dernier se montre néanmoins circonspect: « On annonce le come-back de l’Etat keynésien, mais on assiste surtout, pour l’instant, au réveil de l’Etat pompier qui, comme pour le sauvetage des banques en 2008, est en train de s’endetter pour maintenir artificiellement en vie l’économie. On est juste occupé à colmater les brèches et à exacerber les problèmes du « monde d’avant ». Dès lors, le risque est grand d’un retour à l’austérité, comme en 2011, trois ans après la crise bancaire. » Problème: dans la crise de la Covid, « les banques centrales soutiennent les acteurs économiques, de manière indifférenciée, sans faire de distinction entre les activités durables ou non », lit-on dans le livre. Greenpeace a ainsi relevé que la Banque centrale européenne (BCE) a injecté 7,6 milliards d’euros dans les énergies fossiles entre mi-mars et mi-mai 2020. Pas très cohérent avec le projet de Green Deal de l’UE…

Le financement, nerf de la transition
On est évidemment dans l’urgence. Mais, rapidement, les politiques d’investissement et de financement des Etats et des banques centrales devraient, ou devront, tenir compte de ce que la Banque des règlements internationaux (BRI) a appelé les « cygnes verts », soit les risques climatiques susceptibles d’engendrer à terme d’importantes pertes financières. « Il existe aussi déjà des solutions concrètes pour doper la finance durable comme la taxonomie européenne qui, depuis cette année, permet de distinguer sûrement les investissements verts des investissements polluants, note Arnaud Zacharie. Il faudrait que cet outil de sélection, imposé aux grandes entreprises, dans leurs publications, et aux Etats membres, soit généralisé à tous les produits financiers. »
Pour l’auteur de La Transition écologique et sociale, il est urgent que l’Union européenne développe une fiscalité propre, comme avec la taxe sur les déchets plastiques non recyclés qui verra le jour le 1er janvier prochain, afin de financer le Green Deal sans dépendre du bon vouloir des Etats membres qui risquent de rechigner à mettre la main au portefeuille. Le CNCD défend depuis longtemps la taxe sur les transactions financières (TTF), soit un léger prélèvement sur les ventes d’actions et obligations et encore plus léger pour les produits dérivés. « Pas encore abouti, le projet a été édulcoré depuis son lancement en 2011, signale Arnaud Zacharie. Il y a tout de même six familles politiques qui le soutiennent au sein du Parlement européen.
Il y a donc des raisons d’espérer… « D’autant qu’on a désormais une Commission UE beaucoup plus pro- active que les précédentes, pas seulement sur le Green Deal. », sourit Arnaud Zacharie. Quant aux citoyens, le dernier sondage effectué par le CNCD révèle que 8 Belges sur 10, flamands comme francophones, soutiennent le renforcement de la protection sociale, la justice fiscale, la transition écologique, etc. Reste à adapter l’offre politique…
(1) A l’origine de l’Opération 11.11.11., en cours en ce moment, le CNCD est une coupole d’ONG actives dans la coopération au développement et la défense d’un monde juste et durable.