Une fois par mois, l’écrivaine Caroline Lamarche sort de sa bibliothèque un livre qui éclaire notre époque.
Il est loin le temps où les chasseurs d’or craignaient de se faire croquer par une meute affamée. Loin le génie de l’écrivain qui, il y a cent treize ans, parvenait à nous plonger dans l’esprit de Croc-Blanc (1), au point qu’avec lui nous sortions de la caverne natale, avec lui nous tuions notre première proie, avec lui nous survivions au plus grand prédateur de tous les temps : l’homme. A chaque époque ses récits. Lorsqu’une espèce et son biotope disparaissent, ne survivent-ils pas dans les livres ? Consolation fragile. Car si les oraisons funèbres sont belles, elles mourront avec notre propre espèce, la seule qui parle, raconte, poétise et, le jour où il n’y aura plus à inscrire que les chiffres des pandémies et les degrés de la température planétaire, se taira.

Le dernier loup d’Estrémadure a été tué dans les années 1980, un siècle plus tard que le dernier de Belgique dont aucune ode funèbre n’a salué la disparition. Il est vrai qu’alors il n’était pas courant de se pencher sur le sort des bêtes, sauf si l’on s’appelait Jack London et que l’on scrutait sans relâche l’exploitation de l’homme par l’homme et l’exploitation des bêtes par le même. La fin de ce loup est contée par Laszlo Krasznahorkai (2) dans un mince ouvrage qui ne contient qu’une phrase unique, comme un souffle qui galope, fuit puis s’éteint. Invité par une fondation espagnole à visiter l’Estrémadure pour rédiger le compte-rendu de son essor économique, le narrateur, un ancien professeur, constate qu’au lieu de l’informer sur la modernisation de leur région, ses interlocuteurs reviennent obsessionnellement sur cette traque ultime. Le destinataire du récit du professeur est un barman berlinois qui l’écoute d’une oreille distraite. Mais si le lecteur, parfois distrait lui aussi, est en droit de se demander où l’auteur veut en venir et pourquoi il nous balade entre l’Espagne et Berlin, il se trouvera hanté, au terme de ce livre, par une impression aussi tenace que celle dont nous imprègne la comète Melancholia du film de Lars von Trier.
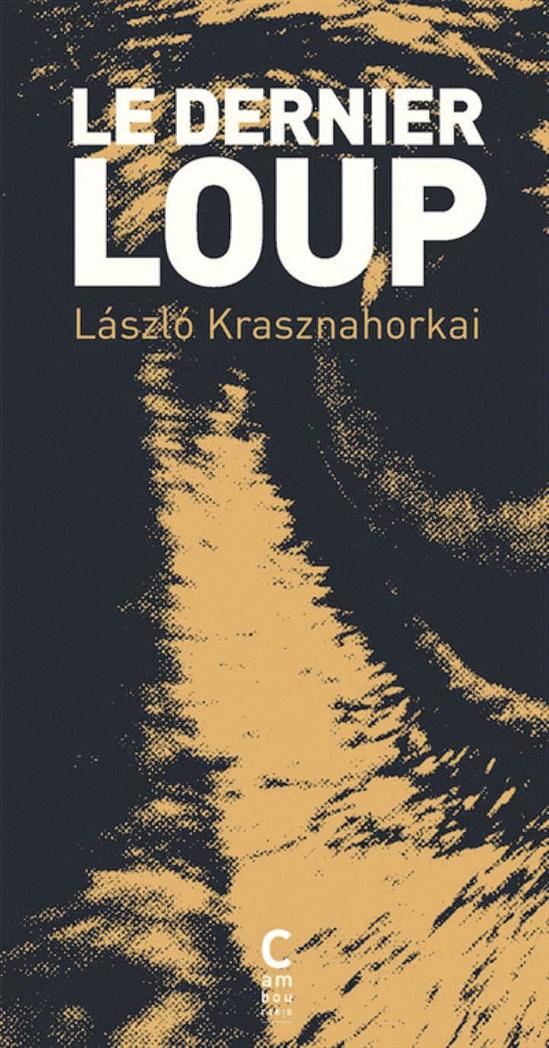
Car la forme même du récit de Krasznahorkai, cette course sans autre but que sa propre fin, est la métaphore d’une fin des temps. Certes, son intrigante beauté pourrait peut-être suffire à nous consoler de la perte. Mais si on relit Croc-Blanc en parallèle, on comprendra que ce que nous avons perdu, c’est non seulement le loup, mais la capacité d’endosser sa peau et sa pensée, son énergie et ses jeux, bref d’ être le loup, ce grand vivant utile et libre qui reléguait l’homme à la place modeste de cohabitant. Oui, les derniers loups ont été exterminés par des hommes dont l’histoire ne dit rien, sinon qu’ils avaient des fusils. Oui, nous n’avons plus rien d’autre à raconter que cette disparition, en regard de laquelle la promotion du Progrès n’a plus le moindre sens. Car, sans le loup, semble nous dire Krasznahorkai, l’avenir n’existe plus. N’existe que le souvenir qui déroule, en une longue phrase mélancolique, sa course éperdue vers l’abîme devenu notre maison.
(1) Croc-Blanc, par Jack London, 1907, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville et Antoine Cazé, Folio Gallimard, 2018.
(2) Le dernier loup, par Laszlo Krasznahorkai, traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly, Cambourakis, 2019.
