Une fois par mois, l’écrivaine sort de sa bibliothèque un livre qui éclaire notre époque.
Un livre dont l’action se passe en milieu urbain. Paris. Londres. Puis Paris à nouveau. Un chapitre intitulé » Ile de la Cité « . Il n’en fallait pas plus pour que je relise Quai des Grands-Augustins pour y traquer Notre-Dame de Paris comme on traque, ailleurs, dans les romans russes par exemple, le vacarme grisant des chants d’oiseaux. Il y a un avant et, déjà, un après l’incendie du 15 avril 2019. Il n’y aura peut-être pas d’après pour ce qui vole et chante. Et lorsqu’ils deviendront si rares que le ciel paraîtra vide, il y aura des gens pour poster sur Internet les textes où ça parlait des oiseaux, comme on poste aujourd’hui les pages écrites sur Notre-Dame. » Et la cathédrale ne lui était pas seulement la société, mais encore l’univers, mais encore toute la nature » (Victor Hugo sur Gallica.bnf.fr).
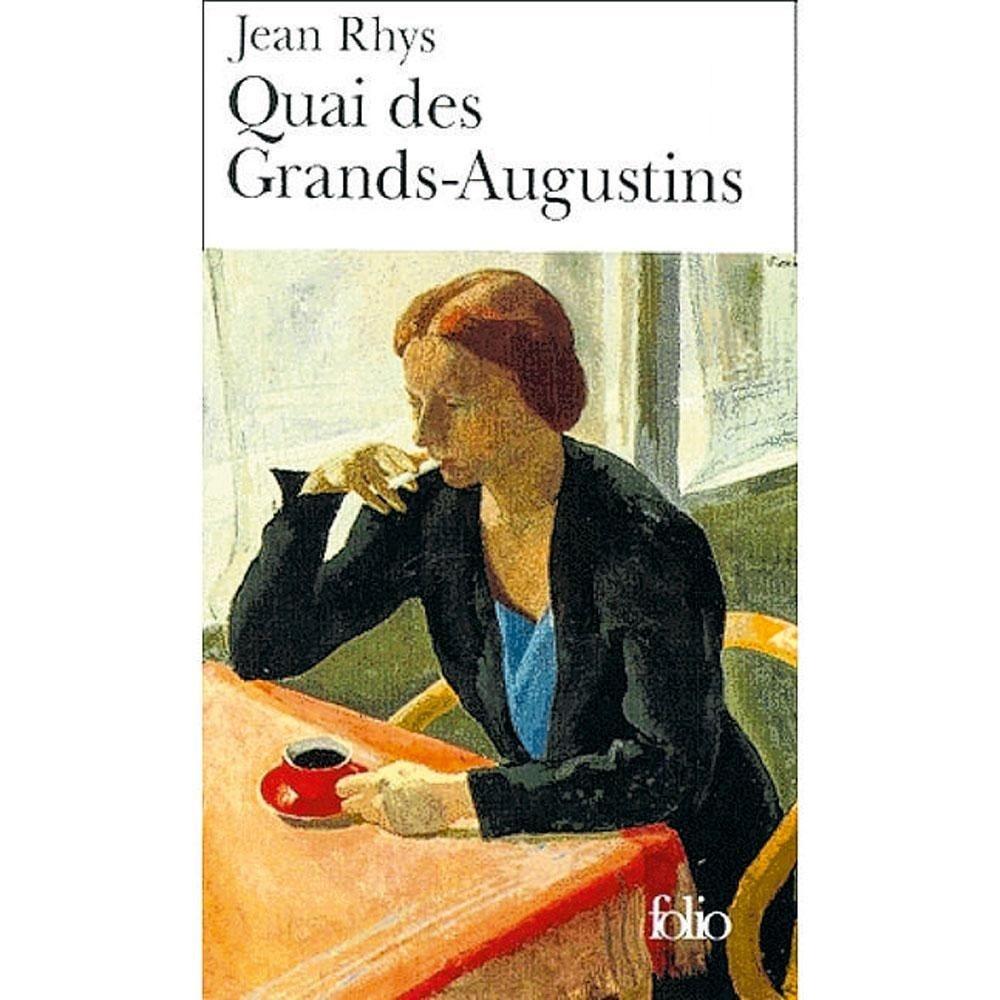
Le lyrisme, l’exaltation de l’âme, n’est pas exactement la manière de Jean Rhys (née en 1894, morte en 1979 après avoir vécu entre Paris et Londres). C’est une écriture laconique, une narration mine de rien. Soit la vie sans éclat d’une femme ordinaire – on pense à la Jeanne Dielman d’Akerman – minutieusement mise en scène au départ de quelques détails. Et, justement, parmi les détails du chapitre » Ile de la Cité « , rien n’apparaît de la silhouette de Notre-Dame. Juste l’angle d’un café, une table de bistrot, un bout de quai, la tapisserie d’une chambre bon marché. Et cela dit le refus de l’exotisme, de l’idéal, de la beauté, même, au profit de la description d’une existence banale, celle de Julia qui fut entourée (disons) par les hommes et qui, peu à peu, perd les protections indispensables à sa survie dans un monde où les nantis ont pour règle de » ne jamais s’engager trop loin ni trop profondément « . Cela parle de la pauvreté ordinaire. Des effets de l’âge sur les femmes. De leur vulnérabilité qu’a désertée la fraîcheur. De ce que cela fait aux hommes – pourtant si bien intentionnés ! – qui passent, à leur égard, de l’attraction à la commisération. Dans cette discrète dégringolade, Julia, malgré sa lassitude, témoigne d’une radicalité qui signe son refus d’être considérée comme un objet de pitié. Cela parle donc de liberté malgré tout. Et aussi du moment où le désir de vivre s’épuise, où le ressort se casse, mais où l’on continue cependant. Cela ne se termine même pas » mal « . Aucun coup de théâtre, aucun espoir in extremis, mais pas non plus de suicide. Cela se termine sur le gris. Ou plutôt – car ces deux cents pages sont sculptées d’ombres et de reflets – sur » cette heure qu’on appelle : entre chien et loup « .

Ils sont trop rares les livres qui, pulvérisant les évidences – inégalités sociales, inégalité des sexes -, nous laissent dans un trouble qui se prolonge bien au-delà de leur lecture. Ceux dont l’on ne pourrait retirer un seul mot sans faire vaciller l’édifice. Et vers lesquels on revient plusieurs fois par vie. Non pour leurs péripéties ou un quelconque message. Parce qu’il y a là » un livre sur rien « , comme disait Flaubert, » qui se tient par la force interne de son style « .
