Avec les événements liés à la résistance, à la collaboration et à la répression qui ont suivi, la Seconde Guerre mondiale demeure, aujourd’hui encore, un chapitre sensible de l’histoire belge. La flamme du souvenir rend-elle justice à chacun de ses protagonistes?
Les guerres font des victimes. Des soldats, des militaires, mais aussi des civils. Des gens qui ont payé de leur vie leur volonté d’opposition. Leurs enfants héritent d’un passé tragique. Y compris les enfants des collaborateurs. La guerre crée des traumatismes qui se prolongent pendant des générations. Les souvenirs et le point de vue de toutes les victimes diffèrent. Est-il dès lors possible d’obtenir que justice soit faite pour tout le monde?
« Dans une politique de la mémoire, par définition, justice ne peut pas être faite à toutes les parties », constate Evert Peeters. « Ne fût-ce que parce qu’une « réconciliation » oblige à « renoncer » à la réparation de certains crimes, alors qu’une restauration absolue équivaut en définitive à perpétuer la guerre. Il y a donc toujours une tension entre les intérêts des victimes et ceux de la société ou de la communauté politique. La « justice transitionnelle » – un terme technique désignant ce qu’un système juridique doit faire s’il se produit une telle coupure politique – a son prix, et il y a toujours quelqu’un qui paie. Cette logique vaut au Chili et en Espagne, mais aussi ici. »
La question fondamentale est donc : pourquoi la guerre ne finit-elle jamais? Pourquoi ne se résout-elle pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas la laisser derrière nous?
EVERT PEETERS : « Dans Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours (1), le livre qu’il a consacré au régime collaborationniste, Henry Rousso a écrit que c’est « un passé qui ne passe pas ». Pourquoi en est-il ainsi? En premier lieu, la réponse dépend du caractère irréparable du dommage causé. C’est toujours pareil. On ne peut pas clore les faits qui ont eu lieu, alors que l’histoire revient précisément à les positionner dans le passé. Le traumatisme de la guerre ne peut pas être « clos » parce que, si cela se fait, on écarte ainsi les victimes. Cela équivaut à leur dire : « C’est fini ». Comme on s’adresse aux enfants : « Taisez-vous maintenant ». Si les dommages sont trop graves, on ne peut pas les classer dans le passé.
Le deuxième élément de la réponse a trait à la manière dont la société gère de tels chocs. C’est dans ce type de réactions que l’entreprise affiche ses désaccords intérieurs. C’est évidemment aussi le cas en Belgique. Le choc qu’a causé la guerre a accentué toute une série de lignes de faille qui existaient déjà dans le pays. Et, inversement, la guerre (ou la façon dont on l’a décrite) est ensuite devenue une « arme » qui a permis de défendre ses propres positions sur ces lignes de faille. On ne peut pas parler du traumatisme de la guerre sans qu’il en apparaisse de nombreuses versions très divergentes. Chacun a sa propre vérité, comme dans toutes les familles. Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut ou qu’on ne doit pas, en tant qu’historien, chercher ce qui s’est réellement passé. La recherche menée par l’historien n’est pourtant qu’un seul trajet parmi d’autres dans une quête sociétale beaucoup plus complexe de la signification du passé. Cette quête est une transaction. Elle produit une image négociée de ce qui est réellement survenu. »
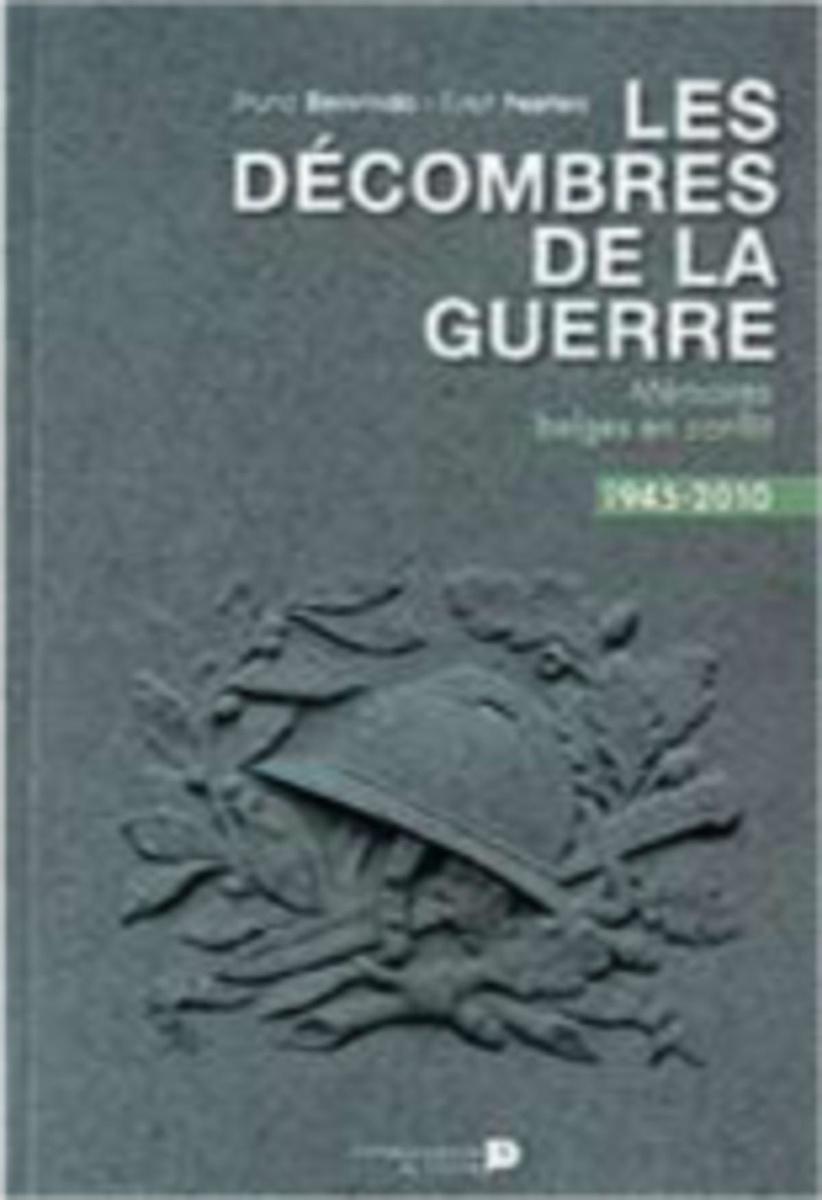
Cela s’est-il déroulé autrement en Belgique que dans nos pays voisins?
« Cette négociation a en effet connu en Belgique un cheminement très particulier. La réconciliation sociale a un rapport avec le rétablissement de l’ordre d’avant-guerre, le rétablissement de l’Etat de droit et de l’ordre juridique. En Belgique, la justice a relativement bien fait cela. Non sans faute ni déraillement, mais compte tenu des circonstances et de l’importance des crimes à punir, la justice belge a finalement accompli assez convenablement sa tâche, sans violence excessive, en adoptant une approche assez cohérente qui a été suivie à partir de 1945. Ce qui est étrange, c’est qu’à partir des années 1950, divers groupes sociaux colportent des récits différents sur ce qui s’est passé pendant et après la guerre. En Belgique – et particulièrement en Flandre – il y a eu une frange de la population qui, durant un certain temps, s’est vu refuser le droit de parole, mais a progressivement réussi à devenir une voix dominante. Ce groupe, c’étaient les collaborateurs flamands. Dès lors, la véritable injustice est peut-être le manque de gratitude pour ce que les résistants ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait est qu’on les a traités injustement pendant septante ans. On les a même diabolisés. On n’a manifesté aucune forme de reconnaissance pour les choix justes et difficiles que ces personnes ont faits. Dès après la guerre, oui, on les a honorés en leur attribuant par exemple des noms de rues. Mais cela n’a pas duré bien longtemps (à peine jusqu’au début des années 1950). A partir de la fin des années 1950, l’inverse a gagné en influence. En Flandre s’est dessiné alors un mouvement réellement unique en Europe : la réinsertion sociale des anciens collaborateurs. »
Quelle est l’origine du revirement qui s’est produit à partir des années 1950?
« Ce n’est pas très simple à expliquer. Il faut remonter au tout début. Il y a eu deux instants déterminants. Le moment d’abord où l’élite politique a voulu restaurer l’ordre et, ensuite, celui où les victimes sont revenues au pays. A partir de septembre 1944, quand les Anglais et les Américains pénètrent dans Bruxelles, l’élite politique veut rebâtir une Belgique neuve et meilleure. C’est alors la ferveur de la libération, un nouvel enthousiasme belge largement partagé. Les élus veulent reconstruire la Belgique mieux encore qu’elle ne l’était. Or, six mois plus tard, les victimes reviennent au pays. Les gens voient arriver dans les gares de longues colonnes de personnes émaciées. Ils sont à la fois stupéfaits et fascinés par ce qui s’est passé dans l’Est. Ils ne se rendent que progressivement compte de la réalité de l’histoire. Quant au judéocide, il faudra encore plus de deux décennies pour que sa reconnaissance fasse son chemin dans la conscience sociale. Une espèce de fusion se produit entre les nouvelles ambitions sociales de l’élite politique et l’idée qu’il faut rendre justice aux résistants et aux prisonniers politiques. Sur la base de cette fusion se développe graduellement un belgicisme qui rallie tant des socialistes et des libéraux que des catholiques progressistes. On obtient ainsi les bases d’une « Belgique unie », relativement solide et largement soutenue. Ce mouvement propose une vision démocratique probelge relative aux années de guerre, un règlement de comptes à l’égard de l’antibelgicisme qui a mal tourné en Flandre à partir des années 1930. Il considère comme inacceptable ce qu’ont fait les collaborateurs du nord et du sud du pays, complices d’un régime antidémocratique. Cela suppose qu’une espèce d’entente mutuelle se développe entre francophones et néerlandophones. Ce point de vue, on ne cesse de l’expliquer : « comme dans la Résistance ». De cette façon, la Résistance prend soudain une couleur politique. Mais la collaboration également. Cette nouvelle tendance politique ne tient pourtant pas longtemps la route. Elle éclate en morceaux en 1950, lors de la Question royale. Les désaccords entre progressistes et conservateurs, entre la droite et la gauche et entre la Flandre et la Wallonie refont alors lourdement surface. Il n’existe plus de support politique pour un mouvement collectif dans lequel une nouvelle Belgique – et une appréciation pour la Résistance – puisse se montrer dominante. »
Dans votre livre Les Décombres de la guerre. Mémoires belges en conflit, 1945-2010, vous écrivez qu’après la guerre, aucune politique de mémoire n’est venue du pouvoir. Et que ce laissez-faire des autorités a donné lieu à une fragmentation de la mémoire.
« Le gouvernement d’unité nationale qui a directement suivi la guerre a tenté de créer une Belgique plus consensuelle sur les ruines de la tour de l’Yser. Une Belgique où Flamands et Wallons se rassembleraient et où la Belgique serait démocratique. Il n’y est pas parvenu. Ce qui s’est passé, c’est que la politisation visant à recueillir en un mouvement global la mémoire de la Belgique après la Seconde Guerre mondiale a donné lieu en Flandre à un contre-discours accompagné d’une réaction antibelge. Il n’est pas tellement facile de modifier la forme de la narration des souvenirs, même si tout le monde sait qu’elle est fausse. La Question royale et la disparition des espoirs en faveur d’une Belgique nouvelle ont rendu impossible la « justice pour tous ». On se trouve face à une société qui veut progresser. C’est aussi ce que veulent les victimes, mais elles doivent alors payer le prix fort : elles ne reçoivent pas la reconnaissance qu’elles méritent et dont elles ont besoin pour avancer. La période de reconnaissance a eu lieu, mais elle a été trop courte. »

C’est surtout la répression qui figure à la base de la mémoire collective. Les sanctions prises au lendemain de la guerre ont-elles été plus dures ou plus sévères que celles prises plus tard? Et ont-elles été différentes en Wallonie et en Flandre?
« Ces sanctions n’ont jamais été exceptionnellement dures ou cruelles, et certainement pas dans une perspective internationale – en comparaison par exemple avec la France ou les Pays-Bas, ou plus encore avec l’Italie, la Yougoslavie ou la Grèce. Dans un premier temps, il n’y a pas non plus sous cet angle de distinction sensible entre la Flandre et la Wallonie. Et, dans la deuxième moitié des années 1940, de nombreux Flamands, surtout les non-catholiques, ont trouvé ces sanctions trop laxistes, et pas du tout trop dures. Le fait que ces condamnations aient pris une telle place dans la « mémoire collective », surtout en Flandre, n’a aucun rapport avec les événements réels, mais bien avec le « champ de mémoire », l’infrastructure. Nous parlons ici de lieux de commémoration comme le fort de Breendonk et la tour de l’Yser où l’on ravive le souvenir de la guerre et des sanctions. Ce « champ de mémoire » était déjà polarisé sur le plan communautaire dès les années 1920. Et une masse de flamingants étaient déjà disposés à intégrer la nouvelle guerre dans un format défaitiste et antibelge qui était prêt également.
Il n’y a pas de politique du souvenir venue d’en haut. Seul Breendonk est érigé comme monument de la guerre. Pour le reste, les deux guerres mondiales sont positionnées sur une même ligne, considérées dans une espèce de souvenir romantique comme « la » guerre. On se contente d’ajouter une date sur les monuments existants : « 1914-1918 » y figurait déjà, et on a simplement ajouté « 1940-1945 ». C’est efficace, pour les finances comme pour la narration. Sur une même ligne contre les Allemands. Les décideurs ne se sont pas foulés. Quand il s’est agi de se souvenir activement, les autorités belges n’ont pas été indifférentes, mais absentes. Pour les enfants des collaborateurs comme pour ceux des résistants, le laissez-faire d’en haut est le grand problème dans l’histoire de la mémoire. S’il n’y a pas d’histoire officielle – et il n’y en a jamais eu une en Belgique – les enfants des collaborateurs se trouvent face à un problème, plus encore que dans les autres pays. Mais que s’est-il passé, finalement? Ce n’est pas que leurs parents leur racontent une histoire autre que l’officielle. C’est que l’Etat ne propose rien du tout. C’est là le problème. Cela provoque au minimum une certaine confusion. Et les enfants des combattants de la Résistance pensent : pourquoi mon (grand)-père ou ma (grand)-mère ne reçoit-il/elle pas la reconnaissance méritée? Où a disparu le respect? Les flamingants expliquent, du moins dans les versions radicales de leur histoire : « On nous ment ». Mais on ne les leurre pas. On n’a simplement rien dit. Dans la culture de la lamentation qui voit le jour dans les années 1950, c’est le groupe flamingant marginal, mais radical, qui – curieusement – prend le dessus dans l’histoire collective. Ces flamingants qualifient la répression comme « la fête de la haine ». »
Malgré les horreurs qui se sont produites, le thème des Juifs semble avoir joué un rôle mineur dans l’histoire belge de la mémoire collective et dans la recherche sur la Seconde Guerre mondiale.
« Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce point de vue. Je crois qu’il s’est passé autre chose. Il s’agit de cadrages narratifs, de commémoration, de cadrages patriotiques qui opposent résistants et nationalistes flamands, d’histoires patriotiques romantiques dont chacune a un autre contenu, mais dont la forme reste comparable. Dans les années 1980, les droits humains et le récit de l’Holocauste deviennent le cadre dominant. Il en résulte la création de nouveaux lieux de souvenir comme, chez nous, la caserne Dossin. Enfin !, car ce lieu de commémoration aurait dû exister depuis près d’un demi-siècle. Et c’est là que l’histoire juive trouve sa place. C’est une communauté qui veut aussi raconter son histoire, et elle a raison de le faire car il lui a fallu attendre longtemps. De plus, il se passe là quelque chose d’unique, d’exclusif que l’on voit maintenant dans les discussions relatives au musée de la caserne Dossin.

L’histoire de la persécution des Juifs est traitée comme différente. Elle n’est pas présentée comme l’histoire d’une nation, mais plutôt comme un problème sur les droits humains. C’est là le fondement de cette histoire. A mesure qu’elle est dévoilée, on découvre une façon totalement différente d’envisager cette guerre. L’histoire a soudain trait à tout autre chose. Et c’est, une fois de plus, très injuste envers les résistants. Il ne s’agit plus d’eux, des communistes ou des catholiques conservateurs qui ont caché des gens et dissimulé dans les bois des réfractaires au travail forcé. Alors qu’on fait enfin de la place pour une iniquité qui est restée trop longtemps occultée, d’autres personnes sont exclues du cadre. Aussi compréhensible que soit cette situation, c’est une fois encore une source de douleur. Ce qui est très important, c’est que le contexte politique et les cadrages narratifs font encore valoir leur influence. Ces cadrages ne sont pas purement politiques. Ils sont basés sur des groupes d’intérêt, des communautés commémoratives. Ils entretiennent le traumatisme parce que c’est souvent la seule manière de faire reconnaître une injustice qui est elle-même irréparable. »
Est-il encore possible, après tant d’années, d’adapter les souvenirs collectifs au sein d’un cadre où un espace est réservé à la mémoire de ce qu’a fait la Résistance?
« C’est ce que les historiens doivent faire maintenant. Et c’est possible. En Espagne, les fosses communes de la guerre civile sont ouvertes par les petits-enfants. Mais il faut que cela se fasse. Même si c’est polarisant. D’une certaine façon, cela fait peur à tout le monde car c’est un sujet très sensible. Il est parfois horrifiant de voir quelles émotions cela suscite.
Il existe dans le passé de la Belgique un groupe de personnes qui n’ont toujours pas leur place dans la société, à savoir ceux qui étaient dans la Résistance. Il est crucial que cela se produise encore. Les autorités ont à cet égard un rôle déterminant. Elles doivent faire en sorte que l’on raconte honnêtement tout ce qui s’est passé pendant la guerre. Dans ce contexte, il faut que certains groupes puissent prendre la parole, les groupes précisément qui ont eu trop peu d’occasions de se manifester. Sans pour autant que l’on y donne automatiquement un contenu politique. Qu’est-ce que cela signifie concrètement? Cela témoigne qu’il est désormais possible de faire des reportages à la télévision, de dédier un nouveau monument aux résistants. Il faut donner à ces gens l’espace nécessaire pour s’exprimer et aider leurs proches avec compétence. Pour que leur récit ne soit pas ridiculisé, mais qu’il devienne « science publique ». Il existe des institutions qui peuvent s’en occuper : le Cegesoma (Centre d’étude guerre et société) et le Service archives des victimes de guerre. Le gouvernement peut faire plus pour que tout cela soit connu et réellement accessible. Evidemment, et c’est typiquement belge, on n’ose pas continuer à pousser si l’on est confronté à des activistes. Mais il faut se permettre d’être attentif à tous les récits. »
