L’avortement est dépénalisé partiellement depuis 30 ans. Après trois décennies, s’il semble admis que la femme a le droit de disposer de son corps, la pratique d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) reste taboue. « Les femmes n’en parlent pas. Personne n’en parle », relève Emilie Saey, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial.
« L’avortement reste sujet à un tabou moral qui imprègne encore trop souvent les femmes », pointe Julie Papazoglou, juriste et membre de l’association féministe Fem & Law. Les femmes qui avortent « gardent ce sentiment de culpabilité, comme si elles avaient raté quelque chose ou commis une faute ». La société juge que la femme qui décide de ne pas garder son enfant n’aurait pas dû tomber enceinte et n’a « sûrement pas bien pris sa contraception. Or, nous sommes fertiles de 16 à 50 ans environ, il est évident qu’on peut tomber enceinte sans avoir foiré sa contraception », souligne Mme Papazoglou.
Clause de conscience
Le tabou moral est aussi « issu de quelque chose de plus structurel lié à la société patriarcale dans laquelle on vit et qui considère qu’une femme doit avoir des enfants », poursuit-elle. Le tabou, tout comme les sanctions pénales qui restent d’application, pèse aussi sur les épaules des professionnels de la santé. « Les médecins, quand ils sont en soirée chez des amis, ne vont pas dire qu’ils pratiquent l’avortement. Ils ne veulent pas casser l’ambiance », ironise Caroline Watillon, chargée de mission à la Fédération laïque des centres de planning familial (FLCPF). « C’est un sujet que l’on ne veut pas aborder, il y a une certaine distanciation », souligne-t-elle.
Aux yeux d’Emilie Saeay, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial, le tabou est « sociétal. (…) En termes d’acte médical, c’est un acte comme un autre. En termes d’éthique, c’est différent« , explique-t-elle. « La loi prévoit une clause de conscience chez les médecins », leur permettant de ne pas pratiquer d’IVG si cela entre en contradiction avec leurs valeurs. « Pourquoi refuser certains actes médicaux sous prétexte que le praticien ne soutient pas le choix de la patiente? « , s’interroge-t-elle.
Apprentissage trop faible
D’autant que, selon Caroline Watillon, « nous faisons face à une pénurie de médecins qui acceptent de pratiquer l’avortement« . En cause notamment: « quasiment aucune heure de cours n’est donnée sur la question en médecine généraliste et les trois-quarts du peu de théorie est axé sur les sanctions pénales », pointe la référente « avortement » à la FLCPF. « Ca ne donne pas envie de pratiquer l’avortement et c’est quelque chose qui inquiète vraiment les médecins », insiste-t-elle. « L’apprentissage à l’IVG fait seulement partie de deux cursus dans les facultés de médecine en Belgique: à l’Université libre de Bruxelles et à Liège. Ce n’est pas suffisant », abonde Emilie Saey. « Nous demandons à ce que cela soit intégré, ainsi que la contraception, dans tous les cursus médicaux dans toutes les universités. »
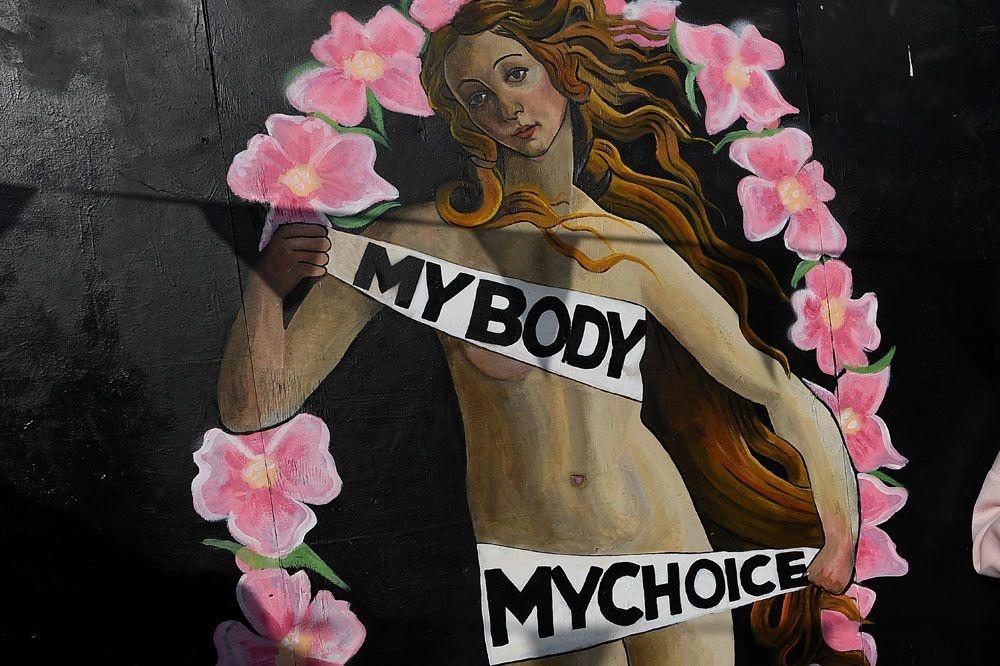
Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a d’ailleurs inclus sa volonté d’inscrire les techniques d’interruption volontaire de grossesse dans le cursus des études de médecine.
Même si la majorité des femmes ont accès à l’IVG, des obstacles subsistent
L’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) reste soumis à « de nombreux obstacles », estime Hafida Bachir, secrétaire politique de l’association féministe Vie féminine. Ceux-ci peuvent être d’ordre géographique ou financier, ou encore liés aux conditions de la pratique de l’avortement. « L’avortement est accessible en Belgique. Il coûte 3,5 euros en planning familial et il en existe une multitude en Belgique« , souligne d’emblée Julie Papazoglou, juriste et membre de l’association féministe de Fem & Law. Toutefois, des entraves peuvent exister. « Certaines femmes ont du mal à y accéder comme les femmes migrantes qui n’ont pas de mutuelles », illustre-t-elle.
Il « subsiste encore de nombreux obstacles dans l’accès des femmes à l’avortement », selon Hafida Bachir. Les femmes peuvent ne pas avoir accès à un médecin pratiquant l’IVG dans leur région, par exemple. Certaines « ne savent pas où s’adresser ou sont confrontées à un refus de pratiquer l’avortement », liste encore la secrétaire politique de Vie féminine. « L’accès peut aussi être entravé à cause des délais longs avant le premier rendez-vous » ou parce que la femme se retrouve hors délais. Depuis 1990, l’avortement n’est plus poursuivi pénalement à condition que certains critères soient respectés, comme le délai dans lequel l’acte est pratiqué – avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou 14 semaines d’aménorrhée (absence de règles) actuellement.
Extension du délai
Le dépassement du délai arrive « en particulier aux femmes les plus vulnérables: jeunes, précarisées, migrantes, victimes de violences… » qui découvrent tardivement leur grossesse « à cause d’un manque d’informations, d’une contraception déficiente… », précise Mme Bachir. C’est pourquoi Vie féminine, ainsi que les plannings familiaux, plaident pour une extension de ce délai à 18 semaines. « Cela permettrait de prendre en charge les femmes qui se rendent aux Pays-Bas pour avorter parce qu’elles ont dépassé les 12 semaines » de grossesse, explique Caroline Watillon, chargée de mission pour la Fédération laïque des centres de planning familial (FLCPF). En 2017, 472 femmes se sont ainsi rendues chez nos voisins néerlandais pour une IVG, selon les chiffres de la Commission nationale d’évaluation interruption de grossesse.

Toutes les femmes qui ont souhaité avorter alors qu’elles étaient hors délai n’ont toutefois pas pu le faire, souligne Mme Watillon, référente avortement pour la FLCPF. « Il y a toutes les femmes qui ne le font pas pour une question de budget – ça coûte 1.000 euros quand même -, parce qu’il faut se déplacer, qu’il y a la barrière de la langue… Il y a un chiffre noir qui n’est pas connu« , signale-t-elle. Elle plaide pour l’extension du délai qui permettra à ces femmes d’acter leur décision. « Les femmes ne vont pas attendre pour le plaisir d’attendre. Au Canada, il n’y a pas de semaines maximum et on voit que les femmes avortent le plus tôt possible. Au Québec, les trois quarts le font à la neuvième semaine d’aménorrhée », illustre-t-elle.
Proposition de loi
Une proposition de loi comprend cette extension. Elle doit toutefois repasser par la case Conseil d’Etat après le dépôt d’une série de nouveaux amendements à la Chambre à la mi-mars. La nouvelle loi veut également réduire le délai de réflexion, soit un laps de temps entre le premier rendez-vous médial et l’IVG, à 48 heures au lieu de six jours actuellement. « Nous nous opposons à cette position paternaliste qui sous-entend que la femme va commencer à réfléchir au moment où elle rencontre le médecin », dénonce la chargée de mission. Quarante-huit heures restent toutefois nécessaire pour « permettre une prise en charge médicale dans de bonnes conditions ».
Caroline Watillon dénonce aussi que le médecin doive discuter des « alternatives » avec la femme qui sollicite une IVG. « Cela signifie parler de l’adoption alors que ce n’est pas une alternative à la grossesse, c’est une alternative à l’éducation », pointe-t-elle. La proposition de loi abolit également les sanctions pénales à l’encontre des médecins et des femmes. « L’accessibilité à l’IVG doit être renforcée et pour toutes les femmes« , conclut Hafida Béchir.
