Le diplomate Frans van Daele a travaillé toute sa vie pour que des accords internationaux soient conclus « pour mieux s’en sortir ensemble ». Ce système de multilatéralisme est actuellement menacé, mais la position de Van Daele n’a pas changé d’un iota: « Une Union européenne forte est le meilleur rempart dans un monde imprévisible et très dangereux ».
Frans van Daele est préoccupé par l’état du monde. C’est pourquoi il travaille sur un livre intitulé Schaken met de macht ( jouer au échec avec le pouvoir). « Non pas pour mettre en avant ma propre carrière », dit-il, « mais pour utiliser mon expérience pour expliquer l’importance d’un projet comme l’Union européenne ou d’une alliance transatlantique entre l’Europe et les États-Unis. »
Lorsqu’il avait une vingtaine d’années, il a appris les ficelles du métier auprès de l’un des diplomates belges de l’époque, le jeune Étienne Davignon. Il a ensuite travaillé pour l’Union européenne, Washington, l’OTAN et les Nations Unies – même au Conseil de sécurité. Dans ces cénacles du pouvoir, il a été confronté à tous les grands conflits des 40 dernières années. Une expérience qui l’a guéri d’un optimisme naïf. Van Daele n’a pas, pour autant, sombré dans le pessimisme. Je ne sais pas si nous pouvons comparer cette époque avec les années 1930 ou 1940. Je pense que le projet européen survivra. Ce qui m’inquiète le plus, c’est la question du climat. C’est ça le plus gros problème de notre époque.
Plus que la Chine, Vladimir Poutine, le terrorisme islamique ou la migration ?
Van Daele : Oui, parce que le climat lui-même peut avoir toutes sortes d’effets déstabilisateurs. Pour y faire face, vous avez besoin de coopérer. Et c’est bien cela qui m’inquiète, car le monde est moins stable qu’avant. Il y a de nouveaux paramètres et des guerres de pouvoir insolites. Rien que pour cette seule raison, une Union européenne forte est souhaitable. Pour le reste, j’espère que nos dirigeants garderont l’esprit clair. Mais c’est aussi ce qu’ils espéraient en 1940.
Êtes-vous pessimiste ?
Pas vraiment. Je ne me complais pas dans le mal du pays et la nostalgie. Les choses sont ce qu’elles sont et nous devons faire ce qui est nécessaire pour encourager la stabilité et le progrès. Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour savoir quelle est la meilleure garantie pour y arriver: le multilatéralisme. Un minimum d’ordre mondial. Certes, cela signifie que tout le monde renonce à un peu d’autonomie, mais c’est le prix à payer. Un certain nombre de pays qui ont une expérience du multilatéralisme doivent prendre l’initiative. Tout comme l’Europe l’a fait avec l’accord nucléaire avec l’Iran, qui, malheureusement, a depuis été mis au frigo. Ou en ce qui concerne la question du climat : nous n’en avons certainement pas encore fait assez, mais sans l’UE, cela aurait été encore moins. Nous devons continuer à plaider en faveur d’un minimum d’ordre international, et ce serait bien si cela pouvait se faire avec les Américains. Mais pour l’instant, ce n’est pas un franc succès.
Selon une résolution de la Chambre des représentants, les actions du président américain Donald Trump sont racistes. En Europe aussi, la politique de la Maison-Blanche semble susciter plus de remous que jamais.
Pendant la deuxième guerre du Golfe, les tensions avec le gouvernement de George W. Bush étaient déjà très vives. Et contrairement à aujourd’hui, l’Europe était alors fondamentalement divisée. Certains États membres comme l’Allemagne, la France et nous étions opposés à cette guerre. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal, estimaient que la solidarité transatlantique devait primer. Aujourd’hui, il y a une plus grande cohésion en Europe sur la politique américaine. Même le Royaume-Uni est sur la même longueur d’onde si l’on en croit les télégrammes de l’ambassadeur Kim Darroch (qui avait qualifié Trump d' »incompétent » dans des notes confidentielles, NDLR).
Cela vous étonne ?
En fait, oui. Ce n’est pas souvent que des notes confidentielles fuitent. Je connais bien Kim Darroch: il représentait le Royaume-Uni à l’UE lorsque j’étais chef de cabinet du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Darroch est un excellent professionnel. Ce qu’il a fait n’est pas en soi une erreur : un ambassadeur doit rendre compte aussi fidèlement que possible à sa capitale. Sinon, il ne vaut pas un sou. Mais il est parfaitement possible d’utiliser un langage codé. J’avais l’habitude de relire mes notes en pensant : quel serait l’effet de ces phrases si elles fuitaient? Apparemment Kim Darroch ne l’a pas fait: ses piques sont restées dans ses notes. Et quand ce genre de notes sortent, il est certain que vous aurez des problèmes.
En tant qu’ambassadeur de Belgique à Washington, vous vous êtes également retrouvé dans une position difficile. En 2003, année de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, vous avez même été rappelé à l’ordre.
(Rire) En effet, le seul ambassadeur belge aux Etats-Unis. Dans ma profession, être convoqué n’est pas rien. Cela signifie que vous devez venir parce qu’il y a un très gros problème entre les deux pays. De plus, les néoconservateurs de l’administration Bush – comme Richard Perle, alors président du Comité consultatif du Conseil de la politique de défense, ou Paul Wolfowitz, le sous-ministre de la défense – ne voulaient tout simplement plus nous parler. Ce qui est bien sûr ennuyeux pour un diplomate puisque notre seul moyen d’action est de parler et de négocier.

Comment en était-on arrivé là ?
Les relations avec les Américains ont commencé à se détériorer lorsque la Belgique s’est opposée en 2003 à la guerre avec l’Irak. Rien que cela a mis nos relations sous pression. Et puis il y a eu la loi sur le génocide. Elle stipulait que désormais, tous les auteurs présumés de génocide ou de crimes contre l’humanité impunis, dans le monde, pourraient être arrêtés et jugés en Belgique. Et ce, qu’il y a, ou non, un lien avec notre pays. En outre, il y avait quelque chose qui n’avait de prime à bord aucun rapport : la loi Franchimont. Elle permettait à toute personne, même sans lien avec le crime, de porter plainte et de prendre part à une action civile. Diverses organisations ont saisi cette loi pour porter plainte contre le père et le fils Bush, le ministre des Affaires étrangères Colin Powell et feu le général Norman Schwarzkopf. Or de nombreux Américains importants passent régulièrement par Bruxelles. A Washington, on m’a dit qu’ils n’acceptaient pas le fait qu’ils risquaient d’être arrêtés en Belgique.
Le problème a finalement été résolu en modifiant la loi sur le génocide. Si l’accusé a un lien plus fort avec les pays de l’OTAN ou de l’UE, le juge renvoie désormais l’affaire. Cela empêche les citoyens américains, entre autres, d’être poursuivis en Belgique pour des actes qu’ils auraient commis ailleurs.
Pensez-vous qu’une coopération transatlantique étroite peut être maintenue sous Trump ?
C’est difficile à dire. Pour commencer, on ne sait si Trump sera réélu. Et puis de toute façon viendra bien un moment où les États-Unis ressentiront, eux aussi, à nouveau le besoin d’avoir des bonnes relations avec l’Europe. Je suis convaincu que seuls l’Europe et les États-Unis disposent ensemble d’une masse critique suffisante pour pouvoir faire face aux problèmes mondiaux. Si nous nous suivons des chemins séparés ce sera plus difficile. Mais je pense et j’espère que l’Europe et les États-Unis comprendront que tous deux ont tout intérêt à établir une entende cordiale. Et cela ne peut se faire qu’en laissant les diplomates faire leur travail.
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la « politique de l’arrière-salle « .
Je ne connais aucune démocratie ou organisation internationale qui puisse se passer de ce genre de pourparlers préparatoires. J’étais membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour la Belgique. Les décisions ne sont pas prises dans cette pièce avec les chaises bleues que vous voyez à la télévision. Là, on ne prend que formellement la décision; les véritables négociations ont eu lieu précédemment. Et chaque décision subit ce test décisif: y a-t-il suffisamment de personnes et de groupes qui se reconnaissent dans la décision et qui veulent en promouvoir les conclusions ? Si c’est le cas, c’est une bonne chose.
Cela vaut-il également pour la manière dont Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne ? Le système des spitzen candidats a été décrit comme un » triste spectacle « .
Je ne trouve pas que sa nomination était de la politique d’arrière-boutique. Le système des candidats désignés était une tentative unilatérale du Parlement européen, jamais discutée avec le Conseil européen et la Commission européenne, d’étendre son influence et son pouvoir aux dépens des deux autres membres de la trias politica européenne. Conformément aux traités européens, le Conseil nomme le président de la Commission, qui est ensuite ratifiée par le Parlement à la majorité absolue. Le système des spitzen candidats visait à garantir le fait qu’ils resteraient un membre important du parlement européen. Fair enough. Telle est l’éternelle tension entre les différentes institutions. La dernière fois, avec Jean-Claude Juncker, cela a marché. Mais pas cette fois. Et je ne vais pas verser une larme pour cela. Une question beaucoup plus essentielle est la suivante : la machine décisionnelle européenne se montre-t-elle suffisamment concernée par les problèmes qui touchent les personnes, de l’immigration au progrès socio-économique, pour s’assurer du soutien de la population au projet européen ?
Et c’est le cas ?
Apparemment, ça l’est. Le dernier Eurobaromètre d’avril montre que le projet européen est plus populaire que jamais. Et cela a été mesuré séparément dans chacun des États membres. De plus, le taux de participation aux élections européennes n’a jamais été aussi élevé. Également chez les jeunes. Cela montre que le projet européen a une base. Il n’a fallu que quelques années à l’opinion publique européenne pour comprendre qu’une Union européenne forte est le meilleur rempart dans un monde très imprévisible et très dangereux. Les mots de François Mitterrand, qui datent d’il y a 30 ans, restent d’actualité : « Que recherchent les citoyens de l’Union européenne ? L’Europe qui protège. ‘
La nomination de von der Leyen indique-t-elle qu’on ne craint plus autant une hégémonie allemande ?
Les Allemands ne se disent pas seulement pro-européens, ils agissent en conséquence. Mais surtout, ils ne veulent pas donner l’impression qu’ils discutent entre eux du processus décisionnel européen. J’ai souvent vu les Allemands nous demander de lancer un ballon d’essai à leur place. Ce n’était pas qu’une question de tactiques. Les Allemands trouvent l’avis des pays du Benelux très important. Ils prennent toujours en compte ce que l’on dit.
L’image est que les Allemands et les Français arrangent les choses entre eux et que les plus petits pays ne peuvent qu’acquiescer …
Si les trois pays du Benelux au sein du Conseil européen s’unissent, ils ont collectivement autant de poids que la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni prit individuellement.
La chute du gouvernement Michel sur le pacte migratoire de l’ONU a-t-elle coûté à notre pays son poids diplomatique ?
Je n’ai rien remarqué à ce sujet. La résistance de la N-VA était néanmoins inattendue, car elle est arrivée plutôt tard. Et il est crucial pour les petits pays comme la Belgique qu’il y ait une continuité dans la politique. Le système n’aime pas l’imprévisibilité. Néanmoins, je pense que les autres États membres considèrent toujours la Belgique comme un pays de bon sens qui cherche toujours un compromis. Notre réputation est certainement restée intacte. Vous avez vu qui a été nommé président du Conseil européen ?
Cette nomination est-elle le mérite de Charles Michel ou celui de la diplomatie belge ?
Dans tout bon cocktail, il est presque impossible de distinguer les différents ingrédients. La Belgique jouit d’une bonne réputation, ce qui nous a aidés avec la nomination d’Herman Van Rompuy il y a dix ans. Charles Michel n’a cessé de poursuivre et de défendre cette ligne pragmatique et pro-européenne. Ses collègues ont vu que Michel a un sens naturel de l’équilibre, qu’il tient compte de tout le monde et qu’il est capable de rassembler le groupe et de le garder ensemble. La combinaison du soutien personnel de Michel et de la bonne réputation de notre pays a mené à sa nomination. Bien sûr, faut-il encore que les choses tombent bien.
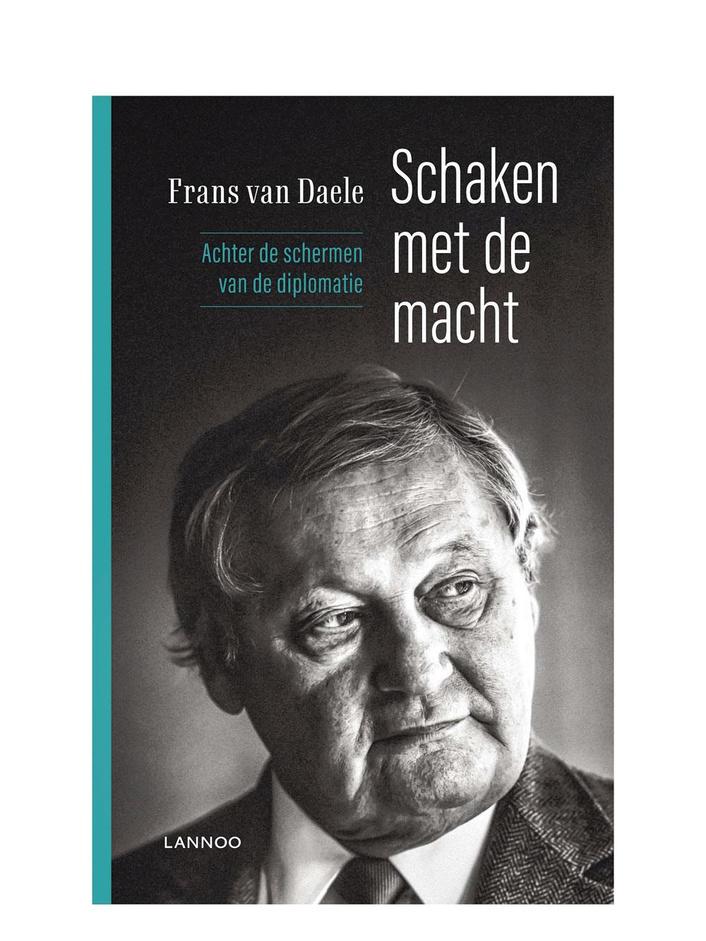
Didier Reynders a été moins gâté : Dans son cas est-ce qu’on peut parler de malchance ?
Van Daele : (hésitant) mwouis, un manque de chance. Parfois, c’est effectivement le cas. Comme je l’ai dit, il faut que les choses tombent bien.
Vous avez été chef de cabinet du Roi Philippe. Ce n’est pas illogique, car la Belgique est qualifiée de « conférence diplomatique permanente ».
On parle souvent des négociations pour le gouvernement belge, mais je peux vous dire qu’aux Pays-Bas les négociations ne sont pas plus simples. En réalité, elles ne sont pas plus difficiles en Belgique qu’ailleurs. C’est un pays démocratique multipartite, et c’est juste un casse-tête qu’il faut résoudre. La difficulté lors des longues négociations gouvernementales en 2010 et 2011, c’est qu’on ne devait pas seulement former un gouvernement, on devait en former un qui avait une majorité des deux tiers pour qu’il puisse faire adopter une réforme de l’État.
Le 26 mai, l’extrême droite et l’extrême gauche ont gagné et le centre politique a implosé. Cela a-t-il un impact sur la formation d’un gouvernement ?
Ce ne serait mauvais que si le résultat d’une élection n’avait aucun effet sur la formation d’un gouvernement, n’est-ce pas ? Les possibilités de combinaison sont ce qu’elles sont, tout comme le nouveau rapport de force.
André Molitor, chef de cabinet du roi Baudouin, a écrit La fonction royale en 1979, une sorte de manuel sur les possibilités et les limites de la famille royale dans un pays complexe comme la Belgique. Il avait un conseil : sans consultation, le roi ne réussira jamais.
C’est toujours le cas. Le roi Philippe voit le Premier ministre tous les lundis. Le Premier ministre lui rend compte de ce qui a été décidé le vendredi précédent lors du Kern et du conseil des ministres. Le roi donne ensuite son avis au Premier ministre.
Le chef de cabinet est-il présent ?
Non. Pendant cette longue formation de 541 jours, le roi Albert a demandé au chef de cabinet Jacques van Ypersele de Strihou d’être présent, pour garder une trace. Mais dans des circonstances normales, le roi s’entretient en privé avec le Premier ministre. C’est comme ça que ça devrait être. Le roi voit en moyenne quatre dirigeants politiques par semaine : les Premiers ministres des gouvernements régionaux, les ministres, les chefs de groupe …. Il sait beaucoup et ressent donc bien les choses. Cela permet au roi d’agir de manière assez autonome. Revenons à Molitor, qui dit qu’il faut utiliser le pouvoir, l’autorité et l’influence avec sagesse. La règle de base est simple. Si le roi prend une décision importante pour le fonctionnement de la démocratie dans notre pays, elle doit être d’une nature telle que chacun dise : « Je l’aurais fait pareil à sa place ». La nomination de Didier Reynders et Johan Vande Lanotte à titre d’informateurs en est un bel exemple.
Qui aurait pu prédire il y a dix ans que la performance du roi Philippe serait à peine contestée ?
J’ai toujours pensé que le Prince Philippe était parfois traité injustement. Cela a commencé par une interview de l’ancien greffier Herman Liebaers dans De Morgen en 1991. Le titre – » Il ne peut pas le faire » – a donné le ton pendant des années. Heureusement, tout cela est maintenant du passé. Avec ou sans moi, le Roi Philippe a apporté une contribution substantielle au fonctionnement de l’Etat belge. Les choses ont véritablement changé lorsque Philippe a donné son discours de couronnement en 2013. Un discours personnel et sage. Depuis lors, le roi a prouvé qu’il traite son pouvoir, son autorité et son influence d’une manière réfléchie.
Considérez-vous le » lancement » de ce roi comme le point culminant de votre carrière ?
J’y ai contribué et je l’ai fait avec plaisir, mais ce n’est pas à moi de juger si j’ai si bien fait. Ce que j’espère par-dessus tout c’est que, tout au long de ma carrière, j’ai aidé mon pays à aller de l’avant. Je ne suis pas non plus insatisfait de mes quatre années européennes avec Herman Van Rompuy. Il s’agissait de sauver la monnaie européenne, de manoeuvrer au bord du gouffre. Bien que romaniste de formation, j’ai fini par parler comme si j’étais gouverneur de la Banque Nationale. (Il rit avant de réfléchir un instant) Au début de l’interview, nous avons fait quelques comparaisons historiques. Bien sûr, omnis comparatio claudicat, toute comparaison est imparfaite. 1890 ou 1930 : vous trouverez des parallèles partout. La situation actuelle me rappelle, par exemple, l’Europe du XIXe siècle, où les superpuissances ont essayé de maintenir la paix grâce à un équilibre des pouvoirs. Ils ont estimé qu’un tel équilibre volontaire et mutuel était la meilleure garantie de paix et de prospérité dans le monde. Les choses se sont passées différemment. Un équilibre des forces entre les acteurs du monde est donc un instrument de paix et de prospérité moins efficaces que des structures internationales fortes. D’où ma conviction qu’il n’y a pas d’autre voie que celle de la coopération internationale. En fin de compte, l’Union européenne est le seul projet qui nous permettra de vivre une vie sûre et prospère dans un monde instable. Notre Union européenne est-elle parfaite ? Non, elle ne l’est pas. La perfection n’est pas dans ce monde. Et cela explique peut-être pourquoi elle trouve encore tant d’appuis pour continuer dans cette voie.
