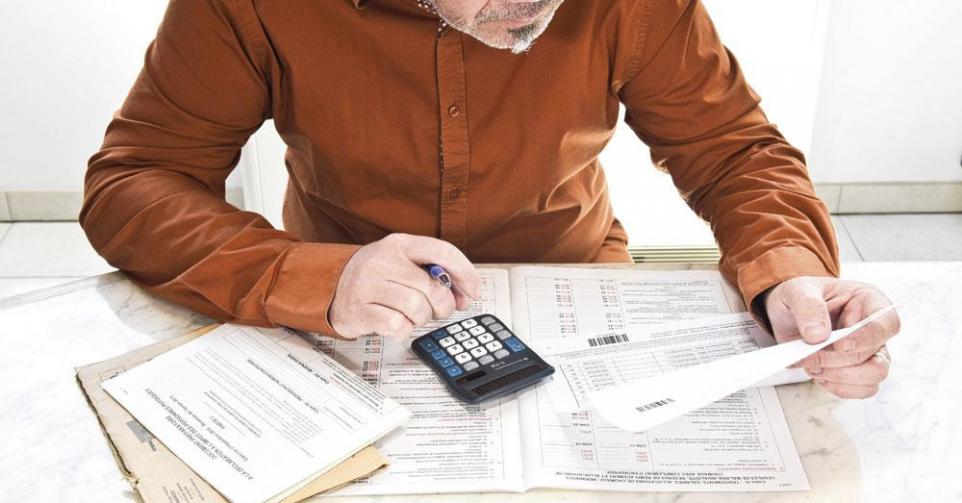Près de sept millions de nouvelles déclarations fiscales vont bientôt arriver au fisc. Quels contribuables seront ciblés pour un contrôle ? Pour quels résultats ?
Avant de lécher la patte de l’enveloppe brune ou d’effectuer le dernier clic sur Tax-on-web pour expédier votre déclaration d’impôt au fisc, ne vous êtes-vous jamais demandé si tout était bien rempli et, surtout, si vous risquiez un contrôle ? Et si ce devait être le cas, pourquoi vous ? Pourquoi le contrôleur du fisc vous choisirait-il ? Depuis plusieurs années, l’administration générale de la fiscalité (Agefisc), au sein du SPF Finances, tente d’optimaliser les contrôles en garantissant un traitement équitable entre contribuables, qui doit se traduire notamment par une probabilité égale d’être contrôlé. Dans ce but, elle a élaboré une politique visant à sélectionner les dossiers à contrôler de manière centralisée et objective, donc moins locale. Le plus possible, en tout cas.
Un contrôleur a suffisamment de nez pour choisir lui-même ses dossiers.
Cette politique est basée sur ce qu’on appelle la » gestion des risques » centralisée. Au sein de l’Agefisc, le puissant service TACM (Tax Audit & Compliance Management) l’organise concrètement, en dressant, chaque année, une liste de profils de risque pour les piliers P (particuliers, chefs d’entreprise) et PME (indépendants, professions libérales) : il s’agit, par exemple, du chiffre d’affaires dans le secteur de l’Horeca, de la déclaration de revenus étrangers, des restitutions de TVA mensuelles, des charges professionnelles réelles… Une partie de ces sélections sont automatisées, via le datamining.
Sur la base de cette analyse de risques, le service TACM établit une série d’actions de contrôle à réaliser, en définissant une approche et un suivi pour chacune de ces actions, toujours dans un but de traitement équitable. Une partie de ces contrôles ciblés est impérative, une autre est indicative. En outre, à côté de cette sélection centrale, existe une sélection locale des dossiers, établie par chacun des centres régionaux du fisc : on compte près d’une quinzaine de centres pour les particuliers et la même chose pour les PME. La règle qui figure dans les instructions de planification des tâches veut que 75 % des contrôles proviennent de la sélection centrale et 25 % de la sélection locale.
Le SPF a tenté, un moment, d’imposer un rapport 80-20 pour rendre les contrôles davantage équitables, mais les syndicats des agents du fisc s’y sont opposés, arguant qu’un contrôleur avait suffisamment de nez pour choisir lui-même ses dossiers. Dans les faits, il semble que seulement quelques centres font de la recherche ciblée localement. Les autres se contentent de la sélection centrale ou remplissent leur quota de contrôles locaux en y inscrivant les contrôles de suivi découlant d’un dossier ouvert en sélection centrale (par exemple, lorsqu’une chaîne de facturations entre sociétés a été ciblée à partir d’une société de départ par la sélection centrale et requiert ensuite le contrôle des autres sociétés de la chaîne).
Cela rapporte-t-il à l’Etat ?
Si cette politique globale de sélection de contrôles fâche moins – en théorie – les contribuables, est-elle pour autant efficace et productive sur le plan des rentrées fiscales ? L’administration et le gouvernement y veillent. Le contrat d’administration des Finances 2019-2021, qui est établi en accord entre le SPF et le ministre concerné, affiche des objectifs chiffrés assez clairs. Le dernier contrat en date, négocié fin 2018 et publié en interne du fisc après les élections de mai, établit ainsi un objectif de 60 % de contrôles productifs pour l’Agefisc. » Productif » signifie : qui se termine par un supplément de revenus imposables quel que soit le montant. Notez que ce supplément peut encore être contesté par le contribuable.
Pour fixer cet objectif, le SPF Finances a pris un indicateur de référence, soit la performance enregistrée en 2017 qui est de 65,2 % de contrôles productifs pour l’Agefisc. Constat : l’objectif est moins ambitieux que la performance antérieure… C’est d’autant plus étonnant que l’objectif fixé pour l’Inspection spéciale des impôts (ISI) est, lui, supérieur : 50 % de contrôles productifs, alors que sa performance de 2017 était de 41,8 %. L’objectif global de l’Agefisc n’est, par ailleurs, pas décliné par piliers, » particuliers » ou » PME « . Or, fin mai dernier, Le Vif/L’Express avait révélé les résultats de productivité des centres de contrôle PME, très disparates entre la Flandre et la Wallonie (de 42 % de contrôles productifs à Mons et 69 % à Hasselt).
Dans l’Horeca, de nombreux établissements restent en infraction.
En outre, si l’on reprend les chiffres du rapport 2017 du SPF Finances, on observe un décrochage au niveau de la sélection locale en matière de contrôles PME (indépendants, professions libérales…) : les années précédentes, le contrôle local rapportait des montants moyens de majoration de revenus supérieurs à ceux rapportés par le contrôle central. Un schéma logique, également vérifié pour les particuliers, qui rend la sélection locale nécessaire. Or, en 2017, ce n’est plus le cas. De manière inexpliquée, le résultat moyen du contrôle local des PME est inférieur à celui du contrôle central. Et le résultat moyen du contrôle global des PME est aussi inférieur à celui des particuliers. Ne faut-il pas, dès lors, fixer des objectifs distincts pour le contrôle des particuliers et celui des PME ? Si le résultat en sélection locale ne se redresse pas pour les PME (certains centres ont pris des mesures pour cela), n’est-il pas préférable d’augmenter les dossiers de sélection centrale ?
Enfin, remarquons que le contrat d’administration 2019-2021 ne retient pas la problématique des caisses enregistreuses des restaurants parmi les objectifs du SPF Finances et ne fixe donc aucun palier à atteindre pour les centres PME en matière de contrôles de ce secteur. Ce système a été institué en 2016 pour lutter contre le travail au noir endémique dans l’Horeca. Or, de nombreux établissements restent en infraction, surtout à Bruxelles et en Wallonie (entre 20 et 30 %), comme l’a montré un rapport de la Cour des comptes publié en mars dernier. Et ce alors qu’en Flandre, la quasi-totalité des restaurants sont équipés de ces machines intelligentes. Les pourcentages plus faibles à Bruxelles et en Wallonie sont surtout dus à l’opposition des fédérations régionales de l’Horeca, note la Cour des comptes, qui recommande aussi d’évaluer l’incidence de l’implantation des caisses enregistreuses sur les recettes fiscales.