Dématérialisé, Internet? Vert, Internet? Et si c’était tout le contraire? Dans L’Enfer numérique, Guillaume Pitron mène l’enquête du côté des tréfonds matériels du réseau – et leur invraisemblable coût énergétique et écologique.
Lorsqu’il publie La Guerre des métaux rares, en 2018, le journaliste Guillaume Pitron est parmi les premiers à lever le voile sur un des non-dits les plus sidérants de la transition énergétique: sa dimension matérielle. Soudain, les discours iréniques sur le passage à l’énergie verte, aux villes intelligentes et à une culture numérique qui nous ferait quitter le monde de la matière et ses coûts environnementaux insupportables étaient remis en face d’une réalité solide: celle de l’extraction brutale et polluante des métaux rares qui assurent le fonctionnement de nos smartphones et de nos ordinateurs – sans parler des panneaux solaires et des voitures électriques. Son second livre, L’Enfer numérique (1) , enfonce le clou. Deux ans d’enquête, de la Laponie aux Appalaches, d’Abu Dhabi à Montréal, d’ Amsterdam à la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, à la recherche de l’infrastructure sans laquelle le numérique n’est qu’un peu de plastique mort le confirment: le futur énergétique et écologique de la planète passera par une manière neuve d’envisager notre relation à Internet et aux objets qui nous y connectent. Une manière qui remet au premier plan ce qui les conditionne: l’immense réseau de câbles, de bases de données, de routeurs et d’antennes dont la discrétion masque mal l’importance économique, et même stratégique.
Bio express
- 1980: Naissance à Paris.
- 1999: Etudes de droit à Paris, puis Washington.
- 2007: Devient journaliste.
- 2017: Prix de l’enquête décerné par Le Monde.
- 2018: Publie La Guerre des métaux rares, traduit en 12 langues et couronné de nombreux prix.
- 2020: Réalise La Face cachée des énergies vertes, pour Arte.
Quel a été le point de départ de votre investigation?
En 2017, deux serveurs d’un des leaders mondiaux du stockage de données – la compagnie française OVH, On Veut Héberger – ont connu une panne quasi simultanée. Elle entraîna aussitôt le blocage d’une série de services commerciaux et administratifs vitaux. Ce fut une manifestation particulièrement visible du fait que, au contraire de ce qu’on continue à imaginer trop souvent, le bon fonctionnement d’Internet exige une quantité incommensurable de câbles de transmission, de systèmes électriques, de dispositifs de refroidissement, etc. Plutôt qu’un cloud détaché de la réalité du monde, Internet en constitue au contraire une des manifestations les plus évidentes, mais aussi les plus fragiles. A l’heure où les débats sur la 5G vont bon train, il est capital de s’en rendre compte – car les exigences matérielles de la révolution qu’elle prétend accomplir seront colossales.
Il faudrait inverser l’ordre des priorités: partir d’un meilleur mix énergétique pour aboutir ensuite à une réflexion sur les usages des données, puis leur consommation.
C’est quoi, au fond, Internet?
C’est la question fondamentale, même si personne ne se la pose vraiment. Les usagers d’Internet, surtout, la trouvent incongrue. Nous vivons l’âge du triomphe d’un récit qui cherche à nous faire croire que le Web prendrait la forme d’un nuage éthéré et sans forme. Ce récit repose sur le fait que notre accès principal à Internet se résume le plus souvent au téléphone portable et à l’ordinateur. Demain, d’autres objets, comme les lentilles connectées ou les puces sous- cutanées, les remplaceront peut-être. Mais le principe restera le même. Notre expérience sensorielle d’Internet se résume à quelques interfaces dont la caractéristique principale est la beauté, la fonctionnalité, la simplicité. Lorsque Steve Jobs lance l’iPhone, il le fait en s’inspirant de l’esthétique des temples zen, en abolissant les touches et en en purifiant la forme au maximum. C’est pourquoi la seule vision d’Internet que nous ayons est celle de cette beauté. Or, comment quelque chose de beau pourrait-il être sale? Ce serait un oxymore. De sorte que nous sommes empêchés de poser la question de ce qu’est Internet par cela même qui nous y connecte.
Quelle serait cette saleté, alors?
Internet est d’abord une question d’architecture et de géographie. C’est l’infrastructure la plus vaste et la plus complexe jamais construite par l’homme. Prenez un e-mail, qui n’est somme toute qu’un simple bloc de données. Pour atteindre son destinataire, il va devoir quitter votre téléphone ou votre ordinateur pour rejoindre une borne relais, puis accomplir des milliers de kilomètres à travers une myriade de câbles à fibre optique terrestres ou sous-marins et transiter par une série de data centers situés aux quatre coins de la planète (voire des satellites comme ceux du projet Starlink d’Elon Musk) dont le bon fonctionnement repose sur tout un réseau énergétique. Il s’agit donc d’une structure d’abord physique, dont les innombrables éléments sont d’une extrême difficulté à gérer. Le problème est que nous désirons l’immédiateté, le temps réel. Nous refusons la latence, car il suffit d’une simple seconde de retard lorsque nous sommes occupés à consulter Google Maps pour que nous loupions notre sortie d’autoroute. De sorte qu’une bonne définition d’Internet pourrait être: une infrastructure qui gère l’urgence à travers un réseau toujours plus rapide et plus redondant de systèmes de transmission – puisqu’à côté de l’immédiateté, nous voulons aussi la sécurité. C’est ce double désir qui fait, par exemple, que l’e-mail que nous avons envoyé peut se trouver copié jusqu’à six ou sept fois dans six ou sept data centers différents à travers le monde. De cette façon, notre courriel sera toujours à proximité d’un port de destination possible – et sera protégé au cas où un serveur tomberait en panne.

Une telle infrastructure pollue…
Enormément. Mais il faut distinguer deux impacts écologiques. Il y a d’abord celui de la fabrication des matériaux qui la constituent: le cuivre des câbles, les cinquante ou soixante métaux différents qui entrent dans la fabrication des téléphones, des ordinateurs ou des serveurs des data centers. Internet consomme des quantités folles de matières premières, en particulier la quasi-totalité des métaux dits « rares ». Puis il y a l’impact des données. Plus on en recueille, plus il faut d’algorithmes pour les traiter. Or, cette masse d’informations doit être stockée quelque part – et ce stockage a un coût, lié à la consommation des ressources énergétiques qui alimentent, entre autres, les systèmes de refroidissement des serveurs, car ceux-ci génèrent une chaleur énorme. Ces deux coûts se répondent et sont pris dans une spirale ascendante. Avant la pandémie, la numérisation du monde avait déjà colonisé la totalité de notre vie quotidienne, accompagnant le récit capitaliste qui veut que notre monde ne pourrait être sauvé que par la dématérialisation. On voit combien un tel récit est mensonger. Avant la Covid, les experts estimaient que, d’ici à 2025, la consommation électrique de l’infrastructure d’Internet atteindrait 20% de la production mondiale, tandis qu’elle deviendrait à elle seule responsable de 7,5% des émissions de CO2. La Covid aura sans doute encore accéléré le mouvement.
Faut-il alors considérer Internet comme un désastre écologique?
Il y a un apport, tout de même. Si à la place de prendre l’avion, je me contente d’une réunion Zoom, Internet diminue mon empreinte écologique. Il faut aussi reconnaître que l’industrie, surtout celle du stockage de données, recherche des solutions aux menaces environnementales qu’elle suscite, ne fût-ce que pour diminuer ses propres factures d’électricité. Mais nous ne disposons pas de chiffres clairs sur la réalité de cette diminution, et le recours accru aux services de stockage engendre un effet rebond. D’un côté, l’industrie optimise sa consommation d’énergie mais, de l’autre, parce qu’elle se trouve en pleine croissance, une course de vitesse naît entre ces gains écologiques et l’explosion mondiale de la demande en biens et services numériques. Et il y a fort à parier que cette course est en train d’être perdue par les tenants de l’optimisation.

Comment s’opère cette optimisation?
Très souvent par l’exploration d’autres ressources énergétiques que celles nées des technologies thermiques telles que les centrales à pétrole ou à charbon. Le problème de ces ressources – les barrages hydroélectriques, les panneaux solaires, etc. – est que si elles produisent une énergie dont l’impact carbone est réduit, voire nul, elles n’en suscitent pas moins des conséquences parfois dramatiques. Un barrage, par exemple, peut bouleverser des écosystèmes, détruire des paysages et influencer l’existence de communautés entières, comme ce fut le cas de ceux qui alimentent les data centers de Facebook établis dans la petite ville de Luleå, dans l’extrême-nord de la Suède. Souvent, aussi, l’industrie suggère que si les modes de consommation des utilisateurs changeaient, la difficulté se réglerait d’elle-même, de sorte que la question énergétique se trouve reléguée au rang de simple variable d’ajustement. Il faudrait inverser l’ordre des priorités: partir d’un meilleur mix énergétique pour aboutir ensuite à une réflexion sur les usages des données, puis leur consommation.
Je ne suis pas très optimiste, car je constate que la « génération climat », si elle remet en question les modes de consommation de ses parents, se montre aussi très gourmande en numérique.
Vous disiez qu’à cet égard, la 5G pourrait marquer un point de rupture.
A l’époque où l’ouest et l’est des Etats-Unis étaient reliés par le chemin de fer, on ignorait qu’au bout du trajet, un jour, on trouverait la Silicon Valley. La 5G, c’est la même chose: on ne sait pas très bien à quoi elle pourra servir. La seule chose qu’on sait, c’est qu’elle constitue un rouage indispensable dans le déploiement de ce qu’on appelle l’Internet des objets, c’est-à-dire un réseau holistique qui permet aux objets de communiquer entre eux, ce qui rendrait possible l’avènement d’hôpitaux connectés, de voitures sans chauffeur, jusqu’au monitorage en temps réel de populations d’animaux ou de plantes. Un tel scénario pourrait entraîner une multiplication à court terme du trafic des données par quarante-deux. Depuis 2012, les algorithmes produisent davantage de données que les êtres humains. Avec l’Internet des objets, les plafonds biologiques de la consommation humaine de services numériques seront périmés, puisqu’un robot est capable de tourner en permanence – de sorte que la consommation de données pourrait presque devenir infinie.
Certains vont même plus loin et imaginent un Internet quasi conscient…
Tout à fait. On rejoint la science-fiction, mais c’est une science-fiction qui en dit long. Des experts tels que Lex Coors, un des gourous de l’industrie des data centers, soutiennent que lorsque Internet aura atteint une masse critique de 175 zettaoctets de données, soit 175 trilliards d’octets, une intelligence artificielle dite « forte » pourra émerger, qui sera capable de gérer à notre place notre avenir écologique et énergétique. La lutte pour la survie de l’humanité pourra alors se passer de l’humanité. Peu importe la réalité de ce scénario. Ce qui compte, c’est que de telles réflexions posent la question de notre responsabilité face aux générations futures. On y observe une tendance à déléguer cette responsabilité à des machines – ce qui revient à nous dédouaner de nos propres actions. Cependant, une telle stratégie est déjà mise en oeuvre dans le monde de la finance passive qui, parce qu’elle a délégué à des algorithmes le soin d’assurer ses transactions boursières, ne se considère plus tenue par les résultats auxquels ils peuvent aboutir. Surtout, un scénario comme celui-ci permet de justifier encore davantage l’accélération numérique du monde, puisque, pour survenir, il requiert précisément une augmentation colossale des flux de données.
Et qu’en est-il des enjeux géopolitiques qui se cachent derrière toute cette infrastructure?
Je pense que le divertissement est la continuation de la guerre par d’autres moyens. Derrière les couleurs d’école maternelle des applications qui se font concurrence pour capter notre attention se cachent des batailles bien réelles. Ces batailles impliquent non seulement les entreprises comme les Gafam, mais aussi les Etats qui les contrôlent plus ou moins. On sait que, par l’intermédiaire de ses câbles, Google pompe des données en France ou en Belgique qui sont ensuite traitées par la NSA aux Etats-Unis ; on sait aussi que le futur câble chinois Peace, reliant la France et le Pakistan, fera de même, au profit de la Chine. De telles mines d’informations sont la source potentielle d’immenses bénéfices en termes financiers comme de pouvoir. Or, au fur et à mesure que la Chine rattrapera son retard dans ce domaine, et donc menacera la suprématie actuelle des Etats-Unis en la matière, il y a fort à parier que les tensions autour de la captation des données nourriront la course en avant à laquelle nous assistons.
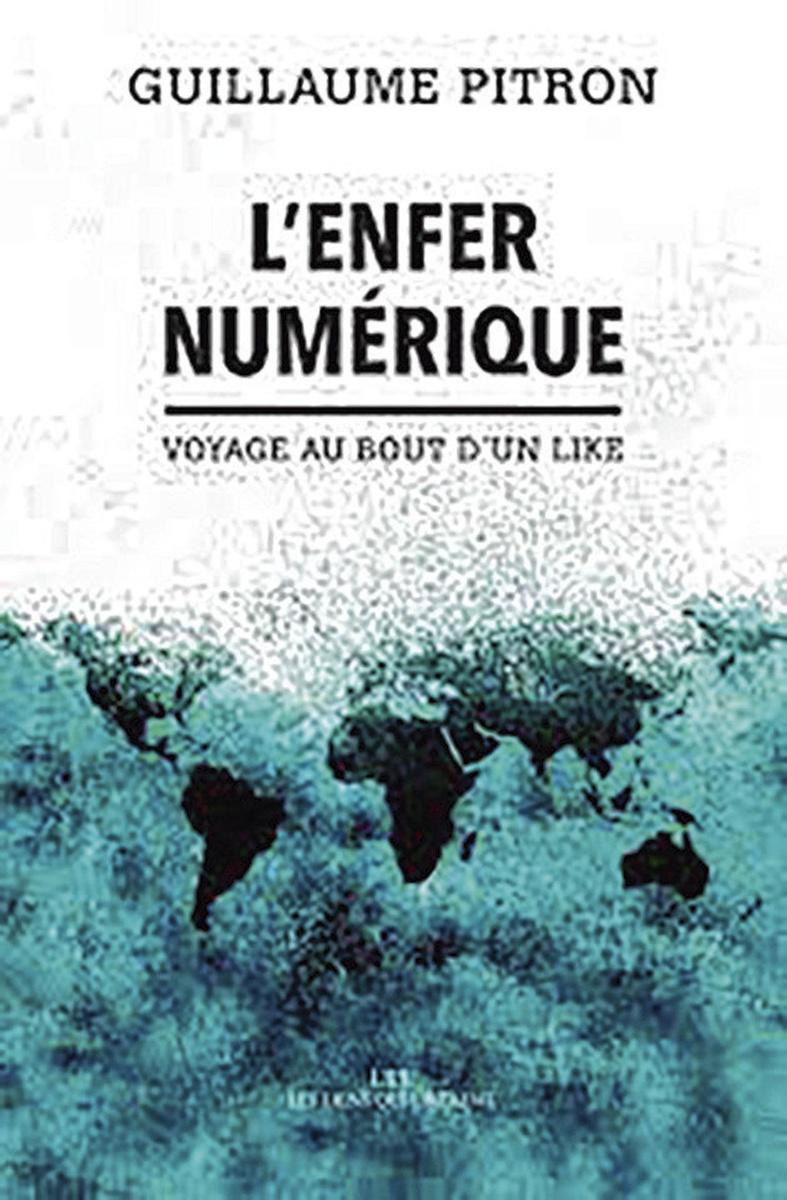
Y a-t-il tout de même des perspectives de solutions à tout cela?
Bien sûr. On peut même dire qu’il existe aujourd’hui autant de propositions de solutions qu’il existe d’experts dans le domaine. On peut les classer en quatre catégories. Il y a ceux qui, comme Lex Coors, croient qu’il faut aller vers une optimisation technologique accrue. D’autres, au contraire, insistent sur la réparation, le recyclage ou la relocalisation des réseaux à l’échelle des communautés d’usagers. Entre les deux, il existe des personnes qui cherchent un équilibre de type « people planet profit », défendant une optimisation mesurée, contrebalancée par, notamment, une fiscalité calibrée en fonction de la pollution. Puis, il y a ceux qui plaident pour un Internet moins libre et moins ouvert, où les fonctions sociales les plus importantes recevraient la priorité et auquel l’accès serait payant. Nous verrons qui l’emportera. Pour ma part, je ne suis pas très optimiste, car je constate que la « génération climat », si elle remet en question les modes de consommation de ses parents, se montre aussi très gourmande en numérique. Un jeune Européen de 18 ans a déjà possédé, en moyenne, cinq téléphones portables. Or, on l’a vu pendant le coronavirus: plus on recourt aux services numériques, plus ceux-ci se traduisent par une réalité physique – comme la multiplication des livreurs. La balle est dans leur camp: la génération climat sera-t-elle cohérente, ou pas, avec les idéaux qu’elle défend?
Peut-on l’y aider?
Sans doute. Les choses deviendraient peut-être plus simples si nous substituions à l’image du nuage dématérialisé celle de la réalité sensible d’Internet. Nous devons apprendre à voir, goûter, sentir et entendre l’infrastructure qui le constitue. Si nous le faisons, nous réaliserons qu’Internet a un goût, une odeur, une texture et même un son. Ce goût, c’est celui du sel sur les câbles sous-marins, l’odeur, celle du beurre rance, le bruit, celui de la stridence des serveurs dans les data centers et la couleur, le vert des données qui transitent. Nous avons besoin d’être éduqués au fait qu’Internet est avant tout une chose comme les autres.
