Guerre à la « désinformation » : comment la suédoise se glisse subtilement dans le sillage des gouvernements qui ont toujours traqué les porteurs de nouvelles « fausses » ou simplement gênantes. Par des procédés douteux.
La chasse à l’infox est officiellement ouverte. Charles Michel (MR), au nom du gouvernement fédéral, a pris sur lui d’annoncer le début de la traque aux fake news, cette bête aussi redoutable que malfaisante qui n’en finit plus de proliférer. Impossible de ne pas saluer le geste fort : un million et demi d’euros seront débloqués pour financer une croisade en faveur du fact checking ou vérification des faits. L’argent, nerf de la guerre à la désinformation. L’heure est grave. Sus aux colporteurs de mensonges et marchands d’illusions, a martelé le Premier ministre. Des noms ? A quoi bon. Lancé à la face d’une opposition parlementaire en clôture de la déclaration gouvernementale lue, début octobre, à la Chambre, l’effet d’annonce a ciblé sans le nommer le camp des odieux désinformateurs. Et les paris ont été aussitôt pris sur qui affolera les compteurs : » Je crains que ce budget ait déjà été épuisé par monsieur Di Rupo « , s’est gaussé séance tenante Peter De Roover, chef de groupe N-VA, au bout de la tirade antisuédoise du député-leader PS.
Un ministre à ses collègues, en 1970 : « Le gouvernement peut aisément critiquer les boums (sic) de l’information. Il est mieux outillé qu’il ne le croit.
S’armer contre la désinformation et en démasquer les auteurs ne sera donc pas qu’une question de survie démocratique. Ce sera aussi un moyen commode de discréditer » l’autre « , celui qui doute des paroles et des actes d’un gouvernement jusqu’à oser les qualifier de mensongers. A Alexander De Croo (Open VLD) de jouer. Au ministre de l’Agenda numérique de donner vie et corps à l’intention. En commençant par tuer dans l’oeuf toute suspicion : cette mission de séparer le bon grain de l’ivraie dans le flux d’informations pourra relever d’une ONG, d’une start-up, de représentants du monde académique ou de journalistes, triés sur le volet par un jury. Mais jamais, au grand jamais, il n’appartiendra aux autorités publiques de prétendre démêler le vrai du faux. Fake news ? Alexander De Croo n’aime pas trop le concept. Sa cible, c’est plus précisément l’information volontairement fausse que l’on répand dans le but de déstabiliser. Quelqu’un, une organisation, la société. Peut-être l’Etat. Pourquoi pas, un gouvernement.
Hors de question donc de créer une officine gouvernementale de lutte contre la fausse nouvelle. Encore moins de ressusciter un ministre belge de l’Information. La fonction a existé dans le gouvernement en exil à Londres de 1940 à 1944 et s’est perpétuée jusqu’en juin 1945. Mais c’était la guerre puis la Libération. Une époque tourmentée où le pouvoir gouvernemental s’autorisait à intervenir contre la subversion. Pour suspendre des journaux, comme, au printemps 1945, La Voie de Lénine et Le Gaulois, quotidien de gauche et d’action wallonne, pour des articles » de nature à favoriser l’ennemi ou à ébranler le moral des armées et des populations « . Pour frapper l’organe trotskiste Le Pouvoir aux travailleurs au motif d’ » incitation à la grève générale « . Ou encore pour crosser, par ministres communistes interposés, la rédaction du Drapeau rouge pour information inexacte sur une prétendue » grève à la gendarmerie bruxelloise « . C’était au temps où un gouvernement songeait à créer un corps de réviseurs qui seraient chargés de scruter la comptabilité des journaux et de déterminer ainsi l’origine de leurs fonds. Un temps où l’opportunité de créer un ministère de l’Information n’était pas écartée. A la guerre comme à la guerre.
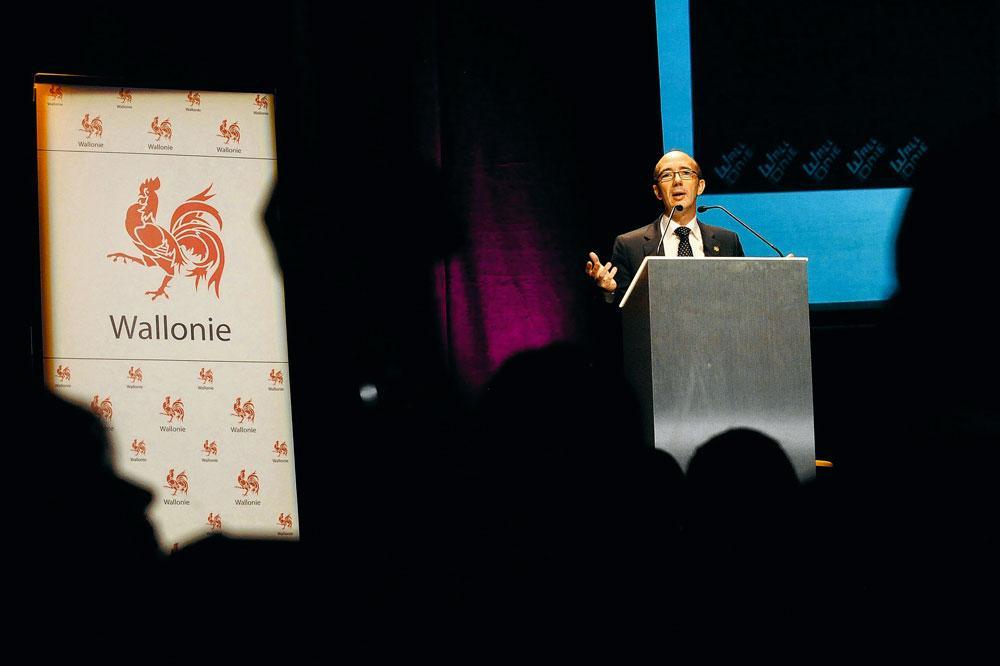
« Fausse nouvelle », haute trahison
Sauf que la menace disparue, on ne renonce pas facilement à la tentation de tenir à l’oeil toute information qui déplaît au pouvoir en place et de mettre au pas ceux qui la colportent. Les procès-verbaux des conseils des ministres (accessibles jusque 1987) témoignent de la bataille pour une maîtrise de l’info qui se livre dans les coulisses gouvernementales. Ils attestent de l’agacement qu’y provoquait la » mauvaise information » qui chasse toujours » la bonne « , de préférence l’officielle. Ils révèlent le recours à des procédés impensables aujourd’hui.
Un gouvernement pouvait avoir la main lourde à l’égard de tout qui n’informait pas » correctement « . Ainsi au printemps 1948, théâtre d’un gros clash entre la coalition Spaak II (socialistes – sociaux-chrétiens) et l’agence de presse Belga : une rumeur liée au cours du franc belge, relayée par dépêche, a le don de mettre les ministres dans tous leurs états. » Tout se passe comme si l’agence Belga participait volontairement à un plan concerté d’attaque contre le franc « , fulmine le Premier Paul-Henri Spaak (PS) en présence de ses collègues. Lâ-chée parmi d’autres » fausses nouvelles « , l’information relève quasi de la haute trahison. Les sanctions gouvernementales pleuvent sur le vilain désinformateur : boycott de l’agence par les ministres, suppression de tous les subsides publics, expulsion de Belga des locaux appartenant à l’Etat. Mesures de rétorsion levées dès juin 1948 après que le gouvernement eut reçu de la part du nouvel actionnaire majoritaire de l’agence, un groupe de propriétaires de journaux, les assurances que ceux-ci » nourrissent envers le gouvernement les meilleures intentions « …
Le pouvoir ne baisse jamais la garde quand il y va des intérêts supérieurs de l’Etat, à moins que ce ne soit ceux de la coalition aux affaires. Janvier 1964, un numéro de l’hebdomadaire Pourquoi pas ? est saisi sur décision gouvernementale. L’affaire est jugée gravissime : y paraît une interview de Moïse Tshombe, dirigeant du Katanga sécessionniste, lequel » mouille » le président du Congo Kasavubu dans l’assassinat de Patrice Lumumba. Infox, intox ? En tout cas, offense au chef d’un » Etat ami » et gros danger pour les 60 000 Belges toujours présents dans l’ex-colonie, décrète le gouvernement socialiste – social-chrétien de Théo Lefèvre. L’information doit savoir s’effacer quand » la paix publique et les bonnes relations avec l’étranger » sont en jeu.
Un bon client s’invite régulièrement au conseil des ministres. La RTB au rapport, cible privilégiée et facile puisque longtemps détentrice du monopole public sur l’information radio-télévisée. Les comptes à rendre et les coups de latte ne sont pas rares. Une émission sur la Question royale est dans l’air, au printemps 1973 ? Très mauvaise idée, s’irrite le Premier ministre Edmond Leburton (PS) qui confie à ses collègues tout le potentiel déstabilisateur de ce programme qui » risque de raviver les passions et de ranimer les querelles communautaires « . Consigne sera donc donnée pour que les personnalités pressenties pour prendre part à l’émission se désistent. Un passage jugé » diffamatoire » pour le roi Baudouin à l’occasion d’un » soi-disant concours d’épitaphes pour le général Franco « , le dictateur espagnol récemment décédé ? C’est une faute de très mauvais goût que vient là de commettre la RTB-Liège en décembre 1975 aux yeux de Leo Tindemans (CVP), Premier ministre, qui pose crûment à son équipe la question du maintien de » la maîtrise effective de la Radio et de la Télévision entre les mains d’un certain nombre d’irresponsables, avec les conséquences qui pourraient en résulter au 0,cas où le pays connaîtrait des jours difficiles. » Une mise au pas s’impose.

« La vérité si je mens » à la télé
Les porteurs de nouvelles gagnent à être connus pour être mieux déjoués. En février 1970, Albert Parisis (PSC), ministre de la Culture française, instruit longuement ses collègues du bon usage en matière d’informations radiophoniques et télévisées. L’objectivité est un temps fort de sa leçon : » Elle est souvent mal reçue par les cercles politiques du gouvernement et de l’opposition « , concède le ministre, qui incite à ne pas désespérer : » Le gouvernement, mieux renseigné que les reporters et ayant une vue d’ensemble de la situation, peut aisément critiquer les boums (sic) de l’information. Le gouvernement est mieux outillé qu’il ne le croit » pour reprendre la main et le contrôle.
Il dispose d’ailleurs d’un moyen facile de prêcher » la bonne parole » s’il veut contrer une » fausse nouvelle » : la communication gouvernementale, qui permet de s’adresser directement à la population par le biais des ondes du service public. Sans avoir à craindre la contradiction, à une heure de grande écoute puisqu’immédiatement après un journal parlé ou télévisé, tout ministre a parfaitement le droit de venir gratuitement monologuer à la radio ou à la télé sur un objet d’intérêt général ou sur des mesures gouvernementales prises ou sur le point de l’être : budget, pensions, économies d’énergie, politique des prix, baisse d’impôts, grève des médecins ou des pharmaciens, nouveautés scolaires à la veille d’une rentrée des classes.
La formule a eu son petit succès dans les années 1970 et 1980, » jusqu’à vingt à trente communications par an « , se souvient Simon-Pierre De Coster, conseiller juridique de la RTBF et professeur de droit des médias (Ihecs). Elle a disparu des radars, victime de l’air du temps. Le dernier à avoir activé le mécanisme à la RTBF est Rudy Demotte (PS), ministre-président wallon, pour une intervention de quatre minutes trente secondes calibrée sur les Fêtes de Wallonie en septembre 2010. Nul ne se risquerait encore à de tels morceaux de propagande gouvernementale qui feraient hurler de colère et surtout de rire.
Dopée par l’avènement de la Toile et des réseaux sociaux, la menace s’est métamorphosée et démultipliée. On voit des fake news partout, et jusque dans les programmes électoraux des partis. A tel point que le Parlement s’en est ému et a recommandé que soient enfin chiffrés en toute objectivité les vrais coûts de tant de promesses. Désigné volontaire pour la mission, le Bureau du plan s’y est jusqu’à présent cassé les dents. C’est dire si le danger exige de la subtilité dans la riposte. Les dirigeants politiques délaissent l’attaque frontale pour privilégier la réplique par la bande. Façon suédoise, par le recours externalisé à des détecteurs de mensonges.
Quel avenir pour les communications gouvernementales, par Simon-Pierre De Coster, revue Auteurs & Médias, Larcier, 2003.

