
Régis Jauffret » Une inextingui ble soif de père «
Dans Papa, Régis Jauffret ravive une histoire familiale traversée par l’absence. Entre l’écrivain et le fils qui se souvient, le récit autobiographique devient roman pour combler le vide d’un père qui lui a échappé.
En 2018, Régis Jauffret découvre à la télévision un documentaire intitulé La Police de Vichy. Reconnaissant l’immeuble où il a passé toute son enfance à Marseille, il aperçoit deux gestapistes sortant avec un homme menotté, poussé dans une voiture. D’après le commentaire, nous sommes en 1943, quelques mois après l’invasion de la zone libre par les nazis. Dans le visage du jeune homme terrorisé, l’auteur reconnaît médusé son père décédé trente ans plus tôt. Après l’effarement commence l’enquête et le mystère s’épaissit : personne n’a souvenir de ces événements. » La réalité me nargue. Moi, le conteur, le raconteur, l’inventeur de destinées, il me semble soudain avoir été conçu par un personnage de roman. » Et Jauffret de partir à la redécouverte d’Alfred, cet homme sourd, bipolaire, assommé de médicaments, qu’il a si peu connu. D’après les maigres indices en sa possession, cette pincée de papa ensevelie dans sa mémoire, l’auteur de Microficitions évoque, parfois avec causticité, souvent de manière touchante, la rencontre de ses parents, le mariage, leur voyage de noces en Italie. Se servant de l’estompe et de la gomme, Jauffret reconstruit, rafistole, répare l’absence. Par l’invention d’un souvenir lumineux, le fils se réapproprie ce père qui lui a échappé toute sa vie. Ou comment sept secondes de film ont réveillé l’enfant tapi, lui donnant » une inextinguible soif de père « .
La vie, vous la prenez comme une torgnole dans la gueule.
Vous partez à la redécouverte de votre père à la suite des sept secondes surgies d’un documentaire sur la police de Vichy.
J’aperçois d’abord la maison de mon enfance, à Marseille, dont je vois sortir un homme menotté, arrêté par deux gestapistes, qu’on pousse dans une voiture… Je reviens en arrière et je reconnais mon père. J’étais d’autant plus effaré qu’à ma connaissance, mon père n’a jamais été résistant et que, surtout, jamais il n’a été arrêté. Or, ce tournage, qui a dû nécessiter au moins une demi-journée avec une équipe de cinéma de l’époque, personne n’en a souvenir. Alors que les Allemands ne filmaient jamais les arrestations, pourquoi auraient-ils mis en scène et filmé celle-là ? Ça ne me paraît pas invraisemblable que ce soit une image de propagande.
Cette énigme s’est-elle imposée comme un matériau qu’il vous fallait traiter ?
Pas vraiment. Au départ, tout le monde me disait : il faut faire un livre. Ce n’était pas du tout dans mes intentions. J’ai été déçu parce que ce que je voulais écrire, c’était une enquête, retrouver ce qu’avait fait mon père durant la guerre. Je ne cherchais pas du tout à parler de mon enfance. Je me suis retrouvé à parler de lui, à parler de moi, alors que j’aurais aimé découvrir qu’il avait été résistant, fait partie d’un réseau… Malheureusement, je n’ai rien trouvé et j’ai donc fait ce chemin vers mon enfance.
Au coeur du livre, il y a cette relation père-fils avec celui que vous appelez Alfred, à la fois présent mais aussi fort absent.
Mon père était là : sourd, bipolaire et sous Haldol. L’Haldol est un médicament antidélire qu’on donnait aux dissidents en Union soviétique, qui réduit la personne et la pensée des gens. A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de médicaments pour soigner la bipolarité. Je ne l’ai pas connu autrement qu’éteint. De souvenirs de conversations avec lui, de choses que nous aurions pu faire ensemble, je n’en ai guère trouvé : peut-être cinq ou six, je les numérote dans le livre.
C’est pourquoi vous vous penchez sur la rencontre de vos parents, le voyage de noces en Italie, la relation de couple ?
Oui, c’est un peu comme la salade grecque : vous faites avec ce que vous avez. J’ai fait avec ce que j’avais sur mon père, mes parents… J’ai essayé de faire surgir ce passé, ce père tel qu’il était avant que je sois né, à une époque, en quelque sorte, où il existait réellement. J’ai essayé de trouver le plus d’existence sociale possible. A sa mort, un de ses frères a déclaré : » Il est mort comme il avait vécu, sans faire de bruit. » On aurait dit qu’il n’avait pas existé, pour personne en fait. J’ai essayé de le faire exister en tant que père, en tant qu’individu, en tant que personne. J’ai retrouvé en réalité l’enfant que j’étais à l’époque, à qui la vie avait infligé un père qui était là sans être là, sans avoir la capacité d’être là. La quête du livre a été d’essayer de le retrouver, de le trouver alors que je ne l’avais pas perdu. D’avoir ce père que je connaissais très bien mais que je n’avais jamais eu.
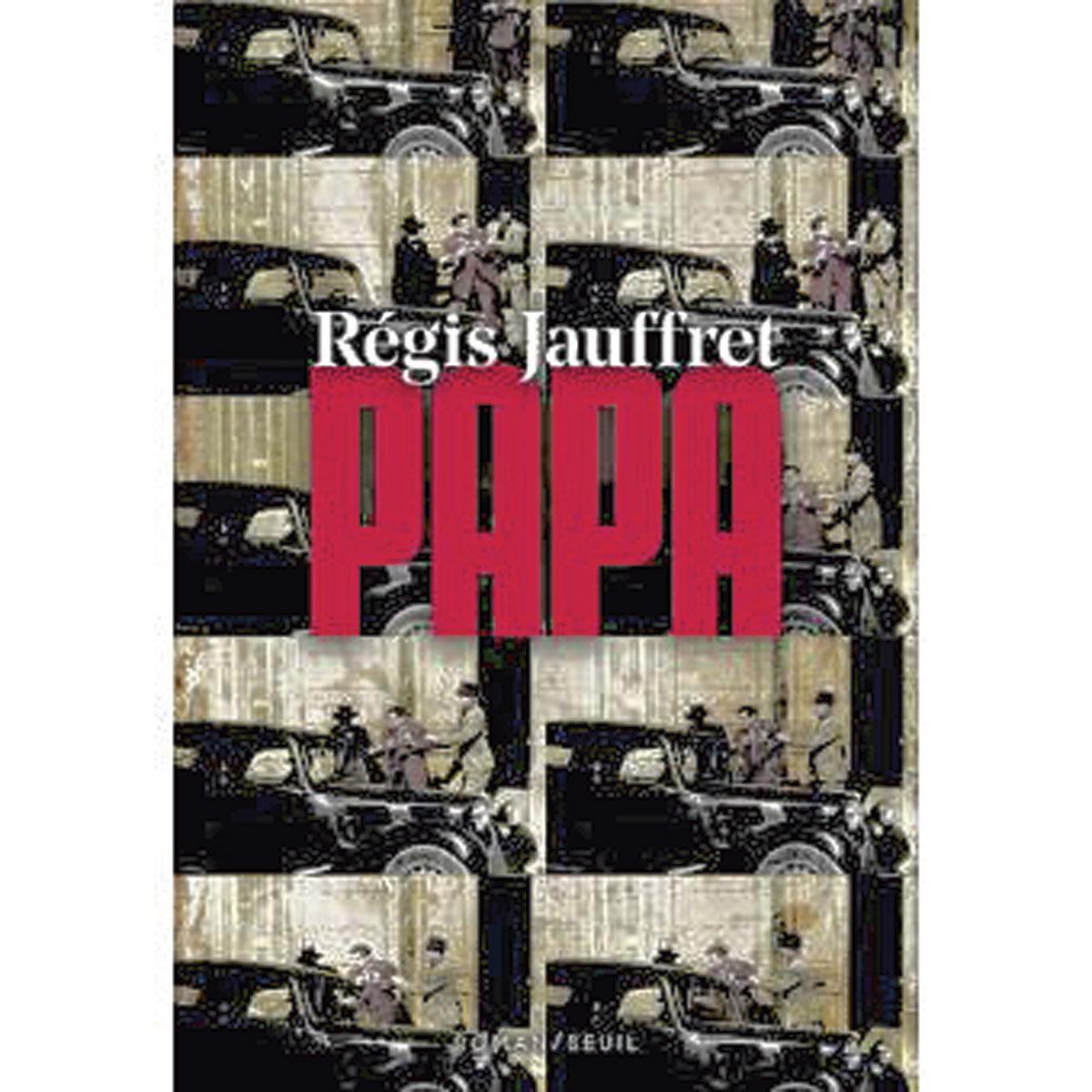
En construisant à partir de bribes, en rêvant un souvenir, n’y a-t-il pas aussi une recherche de réenchantement ?
Il y a quelque chose de très étrange dans ce livre… Ma naissance, cette façon de penser qu’en fait on est né une première fois quand il y a eu une fausse couche, qu’on renaît une deuxième… Comme je pense que mes parents n’auraient pas eu deux enfants, vu leur âge, j’imagine que j’étais le premier aussi. La place de ma mère est très curieuse, par rapport à mon père, ma place entre les deux aussi. Comme je ne peux pas sauver l’enfant, j’essaie de me sauver moi et de sauver l’image en moi de mon père. Vers la fin du livre, je m’aperçois que je n’ai pas de souvenirs avec lui, alors j’en invente un qui soit lumineux… Et désormais, quand je pense à mon père, il est un peu illuminé par la lumière de ce souvenir inventé.
Hormis Lacrimosa, la teneur autobiographique demeure rare dans votre oeuvre. Une façon de se prémunir de l’impudeur ?
Ce n’est pas quelque chose qui a priori m’intéresse. J’étais assez surpris de raconter tout ça sur mon père. Parce que personne ne parlait de lui, moi non plus. Je me suis aperçu que je n’en avais jamais parlé à mes enfants, qui ne l’avaient pas connu, que ma mère ne leur en avait jamais parlé. La vie, vous la prenez comme une torgnole dans la gueule. Je me suis toujours moqué des écrivains qui parlaient de leur famille, de leur père, de leur enfance, ça me retombe en pleine tronche. Ce qui était impressionnant, c’était de parler de cet enfant que j’étais. Je n’ai pas trouvé son destin, j’ai trouvé le mien. Ce qui m’a bouleversé, c’est d’écrire sur mon père. C’est un homme qui, finalement, a été escamoté de son vivant et après sa mort.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici