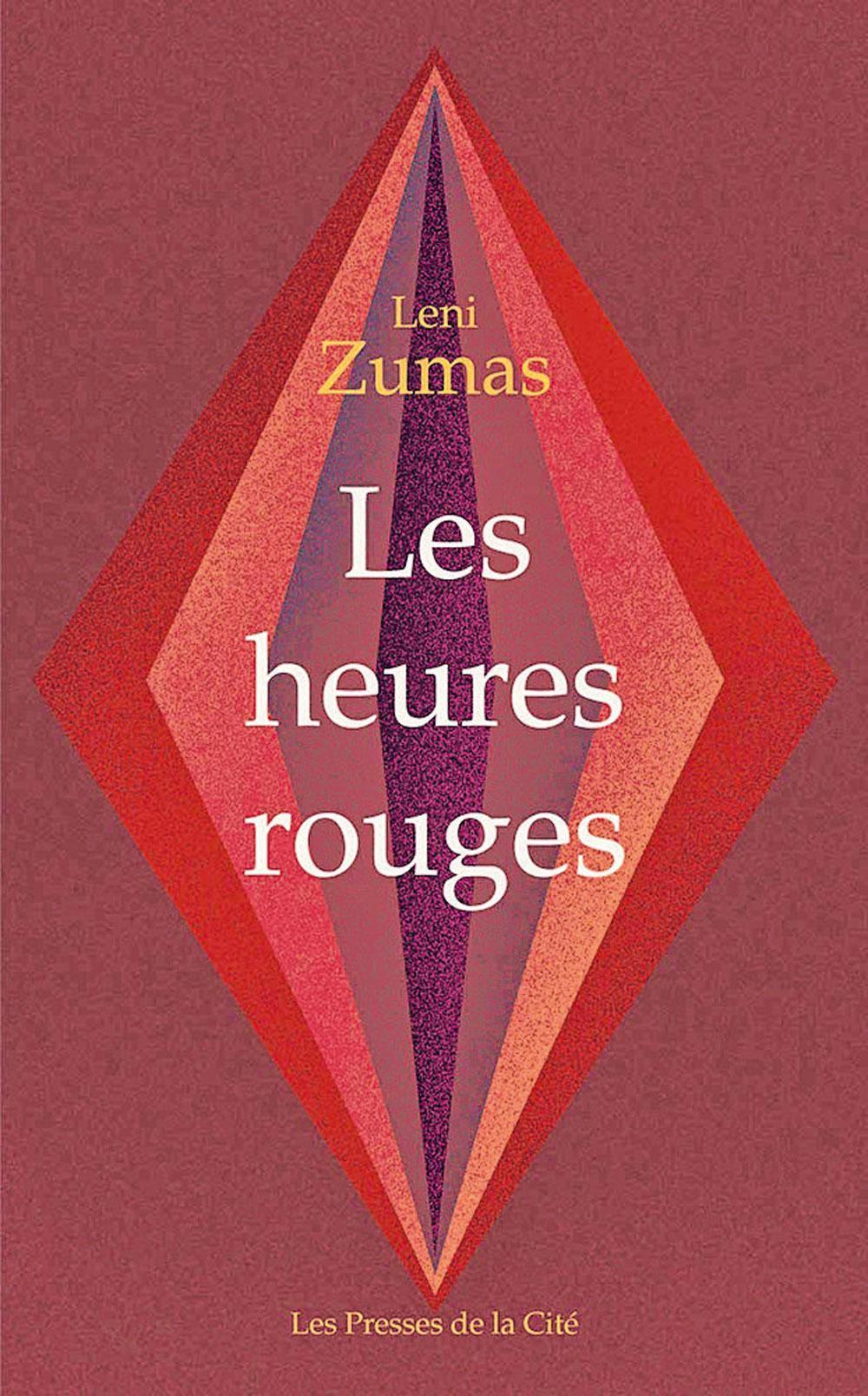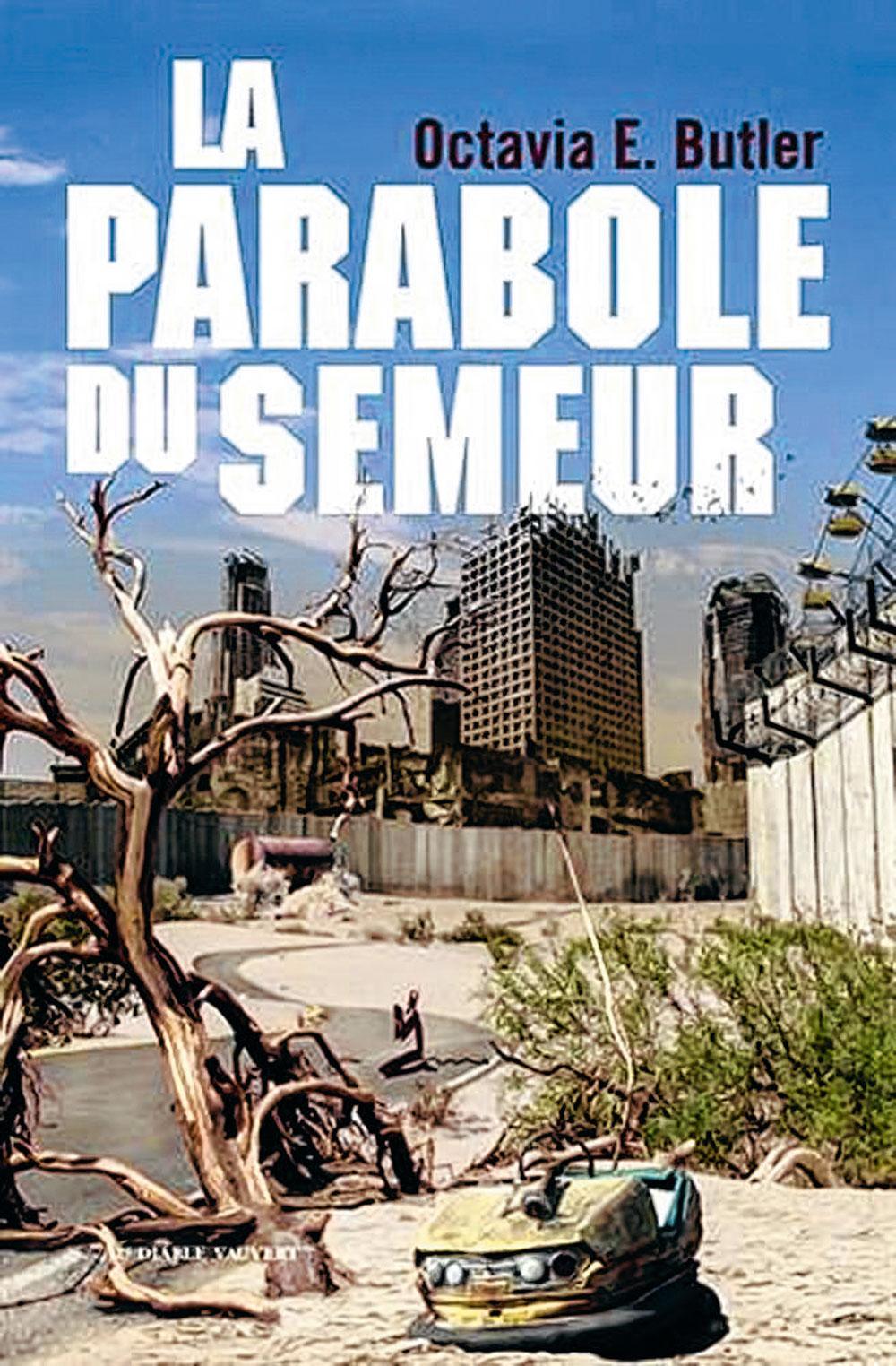Futurs au féminin
Dans la foulée de la redécouverte de La Servante écarlate, un roman écrit il y a près de trente-cinq ans par la Canadienne Margaret Atwood, et récemment adapté en série télé, une nouvelle vague de dystopies aux visées féministes déferle sur la littérature anglo-saxonne. Décryptage.
Le 12 mars, lors de la très courue Foire du livre de Londres, l’éditeur anglo-saxon Vintage a étonné en n’hésitant pas à rendre plus poreuse la frontière entre réalité et fiction autant que celle entre militantisme et marketing. Le coup consistait en une manifestation en faveur des droits civiques des femmes, mais en vue de la promotion de The Testaments, très attendue suite du roman La Servante écarlate ( The Handmaid’s Tale en VO) dont la publication n’est prévue que le 10 septembre prochain. Porteuses de slogans ( » Nolite te bastardes carborundorum » ou » Free The Women of Gilead « ) décryptables grâce au succès de la série éponyme diffusée depuis bientôt trois saisons sur la plateforme américaine de streaming Hulu (NDLR : lancement de la diffusion de la saison 3 début juin), les femmes présentes à Londres étaient d’ailleurs loin d’être les premières à prendre appui sur l’univers de Margaret Atwood pour asseoir leurs revendications.
Le roman culte de la romancière canadienne a vu le jour en 1985. Dans un futur où la pollution a provoqué une infertilité massive, le régime théocratique de Gilead a hiérarchisé la société. Les femmes, particulièrement stigmatisées, y sont réparties en classes, reconnaissables à la couleur des vêtements. Les servantes écarlates, en bas de l’échelle sociale, y sont considérées comme utiles car toujours fécondes. Elles font l’objet de relations sexuelles contraintes et ritualisées dans le but d’assurer l’héritage des dignitaires. June, la narratrice, se retrouve assignée à la famille du commandant Waterford, devient Defred (littéralement propriété du chef, Fred) mais n’entend pas se résigner à son sort. A l’écran, cette résistante privée de libre arbitre est incarnée par la très expressive Elisabeth Moss.

Cape rouge et cornette blanche
Si l’oeuvre avait déjà connu une adaptation cinématographique en 1990 (par Volker Schlöndorff), elle est désormais devenue un phénomène, un signe de ralliement. Aux Etats-Unis, depuis une manifestation muette devant le Capitole suite à des compressions budgétaires du planning familial jusqu’à l’audition de Brett Kavanaugh devant la commission judiciaire du Sénat en vue de sa nomination à la Cour suprême, nombreux ont été les moments clés où des militantes ont arboré une cape rouge et une cornette blanche, comme les héroïnes de Gilead. Ce dispositif nous rappelle tacitement qu’aujourd’hui encore, les droits des femmes sont mis à mal depuis l’élection de Donald Trump. N’est-il pas comblé, l’abîme entre la fiction des années 1980 et notre époque dès lors que le président d’un des pays les plus puissants du monde tourne en dérision le viol ? Quand en Pologne et ailleurs, le droit à l’avortement est remis en question ?
Le regain de succès de la La Servante écarlate (et de sa version sérielle) pourrait donc s’expliquer non seulement par le retour d’un climat rétrograde propice à se projeter dans la terrifiante tragédie de June, mais aussi, et de façon plus positive, par la montée en puissance d’une nouvelle vague de résistance féministe, prête à mettre en place les moyens pour lutter contre l’oppression. A chaque moment de l’histoire où un changement massif dans la vie des femmes était pressenti, des auteures s’illustrant dans la fiction spéculative ont été tantôt les témoins privilégiés de ces bouleversements tantôt pionnières dans les réflexions menées. Citons, par exemple, Herland, utopie féministe de Charlotte Gilman Perkins écrite en 1915, soit cinq ans avant l’adoption du 19e amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui accorde le droit de vote à tout citoyen, quel que soit son genre. Ou encore L’Autre moitié de l’homme de Joanna Russ, publié en 1975, soit après que la révolution sexuelle de 1968 a bouleversé les moeurs.
Si le roman de Margaret Atwood n’est donc pas la dystopie féministe originelle, il est toutefois devenu une balise reconnaissable. Un archétype amenant dans son sillage quantité d’oeuvres qui se réclament, explicitement ou non, de son héritage. Récemment Le Pouvoir de Naomi Alderman (Calmann-Lévy), Vox de Christina Dalcher (NiL Editions), Les Heures rouges de Leni Zumas (Presses de la Cité) ont rejoint nos tables de librairie ou de chevet. Leur succéderont, prochainement, Women Talking de Miriam Toews ou The Water Cure de Sophie Mackintosh, tous deux en cours de traduction. Il n’est pas non plus anodin que Joyce Carol Oates, prolifique reine du roman, ait choisi cette période foisonnante pour écrire Hazards of Time Travels ( Le Petit Paradis, Philippe Rey), sa première fiction spéculative.

Qu’est-ce qui pousse, autrefois ou aujourd’hui, les auteures à s’emparer de la dystopie ? Le genre est connu pour dépeindre des sociétés inaptes au bonheur mais aussi pour mettre en garde le lecteur en lui montrant les conséquences néfastes d’une idéologie présente à notre époque. Il engendre un effet miroir, pas si déformant, de nos travers. Il y a donc là, en filigrane, place possible pour des effets satiriques, pour une liberté de ton et pour des projections radicales que ne permettent pas le roman traditionnel, voué à une forme de cohérence héritée du réel. Plus symboliquement encore, s’emparer d’un genre littéraire qui a longtemps été l’apanage des hommes (tant du point de vue des auteurs, que du public visé, ou même des protagonistes) est déjà en soi un acte de résistance au patriarcat, un transfert salutaire de territoire.
Nouveau genre
Quelles thématiques récurrentes sous-tendent ces romans doublement d’un nouveau genre ? On sait combien, dans les récits de science-fiction emblématiques (comme 1984 de George Orwell, avec sa novlangue ou néoparler), la langue, à la fois arme du pouvoir en place et moyen d’aliénation du plus grand nombre, joue un rôle considérable. C’est aussi le cas ici : depuis un quota de 100 mots alloué aux citoyennes (toute contrevenante subissant des électrochocs) dans Vox de Christina Dalcher, en passant par le discours jugé subversif d’Adriane Strohl dans Le Petit Paradis de Joyce Carol Oates, tout nous rappelle combien museler la parole des femmes vise à annihiler leur capacité de penser mais aussi, de se révolter. A l’inverse, dans sa trilogie Native Tongue (à partir de 1984, non traduite en français), Suzette Haden Elgin, auteure et linguiste, permet à ses héroïnes de créer le laádan, grâce à leur connaissance de la communication extraterrestre. Ce nouveau langage est cette fois non plus source d’oppression mais vecteur d’ empowerment.

Le corps des femmes fait bien évidemment également partie des enjeux majeurs dont s’emparent les dystopies féministes. Victime de violences répétées, dans Women Talking de Miriam Toews, (inspiré de faits réels) ou trophée à conquérir, dans The Water Cure de Sophie Mackintosh, il est au coeur de chaque récit, bien plus ample symboliquement que sa frontière de peau. Il n’est guère étonnant que, dans Le Pouvoir, la Britannique Naomi Alderman ait choisi que ce fameux pouvoir électrique jaillisse directement des mains des jeunes filles, les reconnectant à l’importance de l’organique. Le fait de pouvoir porter la vie étant l’apanage exclusif du sexe féminin, et une puissance impossible à acquérir autrement, leurs opposants régulent souvent ce potentiel immense tantôt en assignant les mères exclusivement à leur rôle, tantôt en ne permettant pas aux femmes seules la procréation assistée, tantôt en interdisant l’avortement. Autant de cas développés par Leni Zumas dans Les Heures rouges.
Tant que les droits fondamentaux des femmes seront menacés, le terreau restera donc accueillant pour les dystopies féministes. Il est toutefois important de préciser que le genre n’est pas dénué de travers. Peu de protagonistes autres que caucasiennes sont présentes dans les fictions spéculatives récentes, comme si, ainsi que le souligne un article de Cosmopolitan à propos de la série La Servante écarlate, ces fictions » extrapolaient les expériences des femmes blanches comme étant représentatives de toutes les femmes « . Afin que le genre ne s’essouffle pas aussi vite qu’il était réapparu et dépasse l’effet de mode, il semble essentiel que les auteures creusent plus profondément dans le champ des inégalités, ouvrent la réflexion à d’autres marginalisations. Qu’elles fassent littérature et langue propres bien au-delà des thèses.
Bibliothèque idéale
La plus ancienne
Herland, de Charlotte Gilman Perkins (écrit en 1915, publié en 1979, tout récemment reparu, en Points). Ce roman doit beaucoup aux Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, et est davantage une utopie. Trois aventuriers dénichent une terre entièrement peuplée par des femmes. L’un est séduit, le deuxième atterré, le dernier, pragmatique face à cette civilisation où les filles naissent par parthénogenèse et où la maternité n’est plus affaire individuelle. Roman à thèse, Herland met certes en exergue les incohérences de la société patriarcale mais est aussi entaché d’un eugénisme propre à l’époque de rédaction et aux convictions de son auteure.
La plus personnelle
Les Heures rouges de Leni Zumas (Presses de la Cité). Dans un pays où l’avortement est interdit, où l’adoption et la PMA pour les femmes seules sont sur le point de l’être aussi, que faire quand vous êtes directement concernée ? Les quatre protagonistes que l’Epouse, la Fille, la Guérisseuse et la Biographe vont devoir lutter. Sans que leur sororité soit immédiate, ces héroïnes vont devoir dépasser leur peur et sortir de leur solitude choisie. Zumas réfute l’appellation » dystopie » pour son roman, tant » les restrictions concernant les droits à la reproduction sont déjà vraies pour de nombreuses femmes dans certaines régions du monde « .
La plus politique
La Parabole du semeur, d’Octavia Butler (Au Diable Vauvert. Première publication 1993). Dans une Amérique proche, l’exclusion et la misère font loi. Jetée sur les routes suite au massacre de sa famille, Olamina, adolescente noire de 15 ans, trace son chemin à travers le chaos, semant une parole d’espoir pour une nouvelle humanité auprès des déshérités. Octavia Butler, auteure afro-américaine, fait partie des écrivaines les plus emblématiques de la science-fiction et son oeuvre, si elle ne s’inscrit pas toujours directement dans le genre dystopique, est toujours profondément engagée.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici