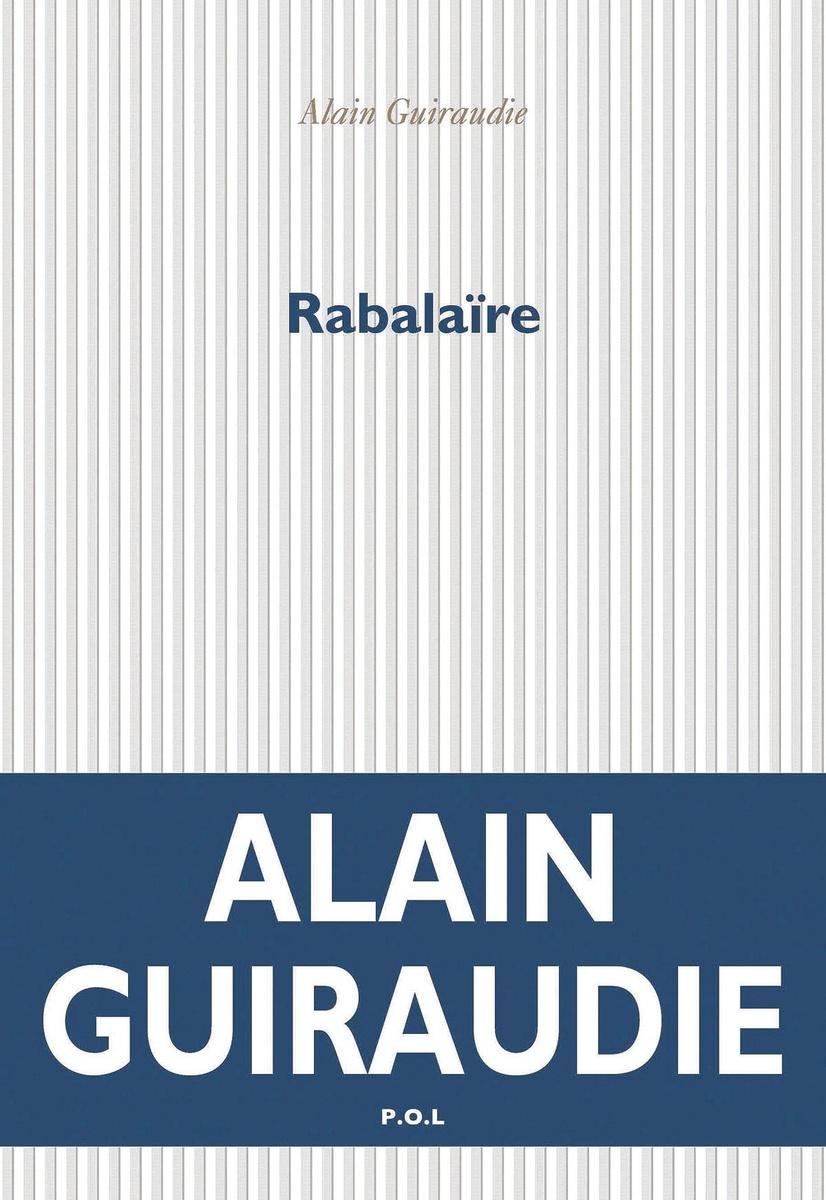Alain Guiraudie, le goût des autres
Confirmant un talent d’écrivain hors norme, le réalisateur Alain Guiraudie signe une fresque excitante sur le terroir, le désir de l’autre et le beau bordel de l’engagement d’une vie.
Chômage et quarantaine bien tassés, Jacques est un « rabalaïre », terme occitan désignant quelqu’un qui va de droite et de gauche, toujours fourré chez les gens. Enfourchant sa bicyclette, ouvert à toutes les rencontres (et les aventures sexuelles qui les accompagnent), Jacques découvre un paysage singulier à quelques kilomètres de chez lui et s’entiche d’une prostituée, d’un vieux garçon, d’un curé… Entre vertiges existentiels, enquête qui patine et rasades de Brigoule, une gnôle qui donne la gaule et des éclairs d’hyperlucidité, c’est le début d’une folle épopée dans un triangle des Bermudes aveyronnais.
Après le remarqué Ici commence la nuit (Prix Sade 2014), le réalisateur Alain Guiraudie transforme l’essai. Du reste, le cinéaste de L’Inconnu du lac n’a jamais caché aborder l’écriture de ses scénarios comme des manuscrits. Travaillant au corps une langue populaire terriblement vivante, il signe un texte fleuve (1 040 pages! ), monologue intérieur jouisseur et inquiet, questionnant l’idée de l’engagement, du combat contre un certain confort idéologique, la jouissance éphémère de la société de consommation. Bousculant les convenances, savourant tous les troubles du désir, Guiraudie lutte contre l’uniformisation des corps, un certain (dé)goût de la laideur et n’a de cesse de faire perdurer le désir de l’autre, « comment on y dit », pour l’accomplir jusqu’au-delà de la vie.
J’aime ce qui m’emmène ailleurs. C’est important pour moi d’inventer le réel.
Le terme « rabalaïre » désigne celui qui va chez l’un chez l’autre. L’errance, être poreux à ce qui advient, nourrit également vos films. Le rabalaïre, c’est vous?
Complètement. C’est un hommage à ma mère qui me traitait de rabalaïre quand j’étais plus jeune. Jacques est en train de laisser tomber son entourage pour découvrir un nouveau monde. Il y a chez lui la peur de la fin du désir, la peur de perdre le goût des autres. C’est vrai que j’ai toujours eu un truc avec les gens qui parcourent le monde – enfin, généralement de petits territoires. Il y a un côté grand voyage pas très loin de chez soi. Ça a été aussi ma façon de vivre, souvent.
Le roman arpente sur plus de mille pages une sorte de triangle des Bermudes aveyronnais. Le terme d’épopée vous paraît juste?
Oui, il y a un côté épique, de l’ordre du roman picaresque: la multiplication des aventures, des personnages, des histoires, des lieux aussi. Ça se rapproche d’un biotope que je connais, moitié fantasmé moitié réel ; on peut penser aux Cévennes. Je l’ai écrit de façon jubilatoire. On part, le parcours n’est pas spécialement planifié et les choses arrivent comme elles arrivent. Aujourd’hui, beaucoup de romans mettent en scène la vie réelle, se détournent de la fiction. J’aime cultiver le mélange des genres: le polar, le fantastique. J’aime ce qui m’emmène ailleurs. C’est important pour moi d’inventer le réel. Je préfère qu’on trouve la liberté dans la façon dont c’est raconté plutôt que dans ce qui est raconté.
Vous travaillez l’oralité, notamment en recourant à l’occitan. Le jeu sur le rythme, la musicalité du phrasé populaire fait songer à Céline…
Je suis un grand fan de Céline. Le premier roman que j’ai écrit, à 20 ans, était truffé de points de suspension partout… C’était du plagiat tout bête, sans intérêt. Avec Rabalaïre, j’ai trouvé ma musique personnelle. J’invente un monde à partir de la nostalgie de mon enfance: les vieux paysans qui vivent dans les bois, ça me rappelle des gens qu’on allait voir quand j’étais gamin. Des maisons paumées où je me demandais: « Comment on fait pour vivre là? ». Je trouve ça très beau que des gens restent en bordure du monde. L’ occitan fait partie de ça. Depuis Céline ou Bukowski, j’ai toujours été sensible à cette idée de renouer avec une langue populaire, par opposition à une littérature plus bourgeoise, plus académique, avec des phrases bien faites – même si je suis très fan de Proust. La façon qu’on a de s’exprimer dans les romans s’uniformise énormément. On est souvent dans une langue bien torchée. J’avais envie d’explorer, de revenir à la langue populaire.
On retrouve nombre de thématiques et de figures aperçues dans vos films. Peut-on dire qu’il y a tout Guiraudie dans ce livre?
Ça brasse tous les thèmes qui me sont chers, tout mon petit monde. A mes débuts, je traitais beaucoup le désir et la jouissance de manière hédoniste, maintenant c’est nettement plus lié à de l’inquiétude. Par exemple, la grande chaîne de l’éternité, c’est quelque chose que j’ai déjà évoqué dans mon premier long métrage ; je trouve qu’ici ça prend une autre ampleur, on est réellement dedans, je précise les choses. Ce qui me plaît aussi, c’est le côté kaléidoscopique: on va dans toutes les directions qui nous intéressent. C’est le grand avantage du roman par rapport au cinéma: on peut ne pas se limiter. C’est très jouissif.
Un roman du doute
L’une des grandes forces du livre est de se déployer tout entier dans la tête de Jacques, à l’intérieur de son monologue intérieur. « Ça me plaisait d’être dans la tronche d’un mec et de ne pas en sortir, reconnaît Guiraudie. Même s’il y a des histoires qui se déroulent hors champ, avec des personnages qui disparaissent, dont on ne s’occupe plus, qui réapparaissent… Jacques a un côté misanthrope. Il est gagné par une sorte de flemme sociale, au point de ne plus vouloir se rendre aux fêtes, boire un coup avec les copains. Puis il y a la difficulté à s’exprimer de manière intelligible, la peur d’être mal compris. Les doutes de Jacques, ses questionnements incessants, son hyperlucidité ou sa paranoïa, selon la façon dont on voit les choses, c’est l’enjeu formel du roman. C’est aussi ce qui m’a fait tenir mille pages, c’est de là que vient cette espèce de langue entre parler et penser. C’est un roman du doute. »
Rabalaïre, par Alain Guiraudie, P.O.L., 1 040 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici