
Ensemble, c’est tout
Vingt ans après son premier roman Le Dieu des petits riens, l’auteure, essayiste et militante indienne Arundhati Roy nous happe avec Le Ministère du bonheur suprême, édifice foisonnant et politiquement acéré.
Arundhati Roy est née en 1961 dans le sud de l’Inde, d’une mère chrétienne militante pour le droit des femmes et d’un père hindou. Elle est munie d’un cursus d’architecture quand la sortie, en 1997, du Dieu des petits riens la révèle. Immense succès public, ce roman la dote d’un statut de voix à suivre. Opposée au nucléaire, à la toute-puissance du capitalisme et farouchement pacifiste, elle publie de nombreux essais, dont L’Ecrivain-militant (Gallimard, 2003) et Capitalisme : une histoire de fantômes (Gallimard, 2016). Retour à la fiction après deux décennies, LeMinistère du bonheur suprême (1) est un fabuleux millefeuille où l’auteure jongle avec tous les registres de langage. Dans une Inde lacérée par les conflits de croyances, des êtres hybrides bâtiront une famille au-delà de leurs failles. Anjum, mélomane installée dans un cimetière, deviendra l’hôte des vivants comme des morts et S. Tilottama, artiste énigmatique, sera bouleversée par l’amour et l’innommable de la guerre. Un poignant plaidoyer pour la solidarité qui nous a donné l’envie d’une rencontre.
les débats actuels sur l’identité sont essentiels mais réducteurs
Comment avez-vous trouvé l’équilibre entre l’urgence que nécessitent vos essais et l’attention longue que requérait ce nouveau roman ?
Je vois mon travail comme une rivière à deux courants : le premier aurait cette allure prompte, et celui du dessous serait plus tranquille. Une grande partie de ma compréhension de ce qui se trouve dans le roman provient de mes discussions sur la matière même des essais. Grâce à ce que j’ai écrit durant vingt ans, j’ai été invitée au coeur d’endroits auxquels je n’aurais jamais eu accès. Personne ne va sans autorisation au Cachemire, par exemple. Ce n’est pas tant que c’est dangereux, c’est surtout que les habitants vous tiendront à l’écart, qu’il faudra gagner le droit à accompagner la guérilla dans la forêt, à être convié dans les maisons. Je ne voyais pas ça comme des recherches pour un livre. Ce sont mes amis : il n’y a pas de séparation entre eux et ma vie.
Le Ministère du bonheur suprême comprend plusieurs parties (à la résidence des hijras, dans le cimetière, au Cachemire), toutes finement entrelacées. Comment avez-vous procédé au montage ?
La façon dont une histoire est racontée est aussi importante pour moi que ce qu’elle raconte. Du point de vue formel, je voulais utiliser tout ce qui était possible et le pousser au paroxysme. J’ai pensé à ce livre comme à une ville. Cela impliquait des voies principales mais aussi de toutes petites ruelles. C’est quelque chose que je ressens très fort à Delhi : il y a des gens de la campagne qui arrivent par millions. Je suis incapable, quand je tombe sur un chauffeur de taxi ou un garde de sécurité, de ne pas imaginer aussitôt d’où il peut venir, ce qui a pu survenir dans son village, etc.
Vous éprouvez le besoin de prendre en considération le cadre complet de chaque personne ?
Oui, ça amène aussi à se poser la question de la caste, évidemment ! Je me sens touchée quand on me dit » un cordonnier n’est rien d’autre qu’un cordonnier « . La tapisserie de la vie en Inde est invisible mais bien là. C’est impossible de se rendre dans un village sans prendre ce maillage en compte. Qui sera votre sésame pour y pénétrer ? Est-ce que vous y entrerez avec un propriétaire de la caste supérieure ? Ou bien avec un intouchable, au ban de la société ? Vous verrez à chaque fois une réalité différente. Pour moi c’est donc très choquant de constater l’incapacité des intellectuels, ou même de certains auteurs de fiction, tous privilégiés, à voir ce monde en marge. C’est comme s’ils écrivaient sur l’Afrique du Sud sans jamais mentionner l’apartheid. Non seulement ils vivent dans une bulle mais donnent une mauvaise impression de ce qui se passe, non seulement maintenant, mais depuis des années et des années.

Le point commun entre tous vos personnages est qu’ils sont confrontés à des tensions d’identité…
Ils sont tous scindés par une frontière interne, qu’il s’agisse du genre, de la caste, etc. L’Inde vous contraint à afficher une seule caractéristique : vous êtes marqué par votre provenance, votre sexe, etc. Même en Occident, les débats actuels sur l’identité sont essentiels mais réducteurs. On m’a beaucoup demandé pourquoi j’avais écrit autour d’une hijra(NDLR : une transsexuelle), mais pourquoi ne pas me demander pourquoi j’ai écrit sur un officier du renseignement ? J’ai choisi Anjum parce que c’était une personne, pas parce qu’elle incarnait un sujet. Elle est aussi musulmane, née et élevée dans une époque où cette condition-là est même plus dangereuse que celle d’ hijra. J’aime voir les identités comme un paquet de cartes. Laquelle vous met en sécurité, laquelle vous met en danger ? Laquelle utilisera-t-on pour vous étiqueter ? Laquelle arborerez-vous pour vous définir ?
Au début du roman, la mère d’Anjum s’interroge : est-il possible de vivre en dehors du langage ? Cette puissance des mots constitue une échine du livre…
Beaucoup de gens citent ma phrase prononcée il y a quelques années : » Un autre monde est non seulement possible mais il est déjà en marche. Un jour calme, si j’écoute attentivement, je peux l’entendre respirer. » Pour moi, écrire Le Ministère du bonheur suprême, c’était exactement ça. Une autre façon d’appréhender tous les recoins : l’histoire, le genre, l’amour, la guerre, la civilisation, etc. Bien sûr, on peut discuter de l’état du monde, mais un romancier tentera aussi de vous suggérer une autre lentille pour envisager l’ici et maintenant, avec ses inégalités, ses injustices, etc. Il explorera d’autres types d’amour et de solidarités. Si on prend l’exemple du cimetière où se rassemblent certains des personnages, en Inde aujourd’hui, ça constituerait un ghetto mais je n’ai pas voulu le dépeindre comme ça.
Vous faites de cette Jannat Guest House, aussi bien salon funéraire que maison d’hôtes, un carrefour symbolique très fort…
Cette façon de gérer l’endroit est radicale, et ne provient pourtant pas d’une forme de manifeste, pas de ceux que la gauche pourrait imaginer. L’enterrement de ces gens si différents dans le même cimetière, tout comme cet élan commun que vont avoir les personnages quand ils découvriront un bébé, c’était essentiel pour moi. Je voulais aussi une scène de Nativité qui agisse comme un contre-pied. On est loin de la venue de Jésus : on a là une petite fille noire, surgie des déchets, entourée de singulières créatures. Ces chapitres-là, avec ces personnages tendus par leurs contradictions et leurs rêves, je les ai imaginés comme la scène du bal dans Guerre et Paix de Tolstoï, avec toutes les jalousies, les croyances, et où on se demande qui va ou non arriver, etc.
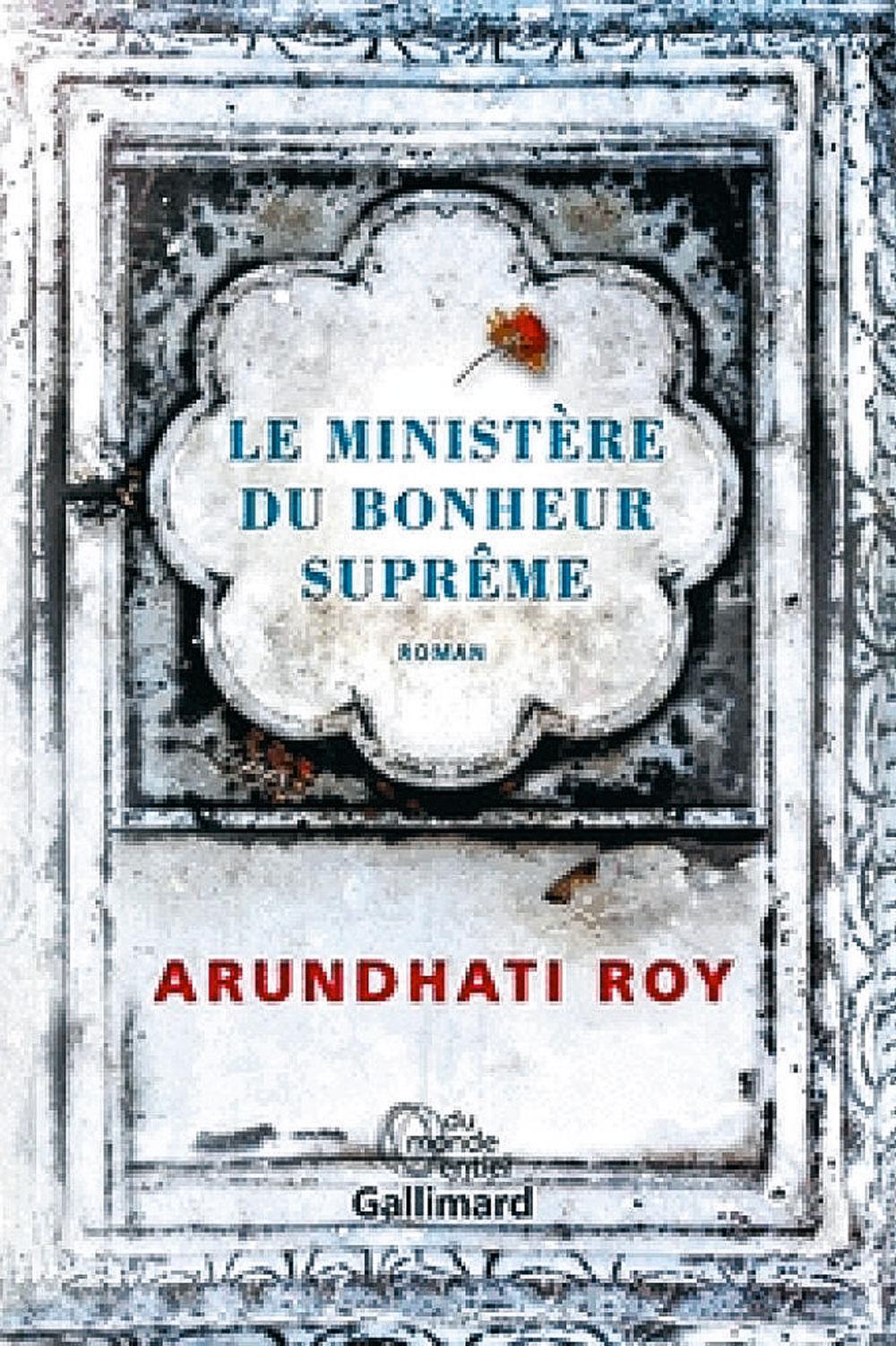
Votre roman est secoué par la violence. On trouve cette phrase à la fin du livre : » Quelle dose de sang est acceptable dans la bonne littérature ? » Avez-vous des tabous quand vous écrivez ?
C’est un présupposé invisible mais que je ressens pourtant. On essaie toujours de diviser les livres par catégorie : est-ce un livre politique ? Est-ce une histoire d’amour ? On sépare les livres intimes qui touchent au coeur de ceux qui abordent les questions politiques et pour moi, cette frontière n’a pas d’importance. Etre à la fois profondément politique et intime et pouvoir regarder la violence avec le regard aussi clair qu’on envisage l’amour, considérer aussi bien la fresque épique que ce qui se passe de plus infime de l’autre côté de la fenêtre ? J’ai besoin que ça soit mon credo. A force de retirer les gens en marge du tableau, de vouloir censurer la violence, on donne de la réalité une vision édulcorée.
Un de vos personnages, Gujarat ka Lalla, est fortement inspiré du premier ministre indien actuel et ce portrait est tout sauf rassurant… Quel genre d’attentes avez-vous pour votre pays ?
Cette question est surtout difficile parce que je ne suis même pas sûre que mon pays en soit un, avec tant de réalités en une, et certains territoires qui ne veulent pas, ou plus, en faire partie. Pour le moment, je suis plus que jamais inquiète. Le projet de nationalisme hindou ne se résume pas à Narendra Modi. L’organisation d’extrême droite à laquelle il appartient, le RSS (Organisation patriotique nationale), fait des dégâts considérables : ils sont en train de modifier les livres d’histoire, ils remplacent les professeurs, les personnes engagées à la Cour suprême, dans l’armée… c’est une contagion qui ne cesse de s’étendre. Il ne s’agit pas juste de remporter ou de perdre les élections : ils instaurent un régime où la stupidité a sa place, où la haine a le droit de cité. Je ne sais vraiment pas comment on pourra s’en sortir et combien de temps ça va nous prendre. Les gens commencent enfin à réaliser, j’espère donc qu’un processus d’antipoison pourra se mettre en place. En 2019, c’est la grande élection. L’assassinat de masse des musulmans fait partie des questions de campagne et la situation risque de s’envenimer terriblement.
D’une certaine manière, vous ressemblez à votre personnage Tilottama : il y a en vous quelque chose d’impossible à cantonner…
Donner à lire des femmes de tempérament, ce n’était pas une décision politique, mais ce sont les personnes les plus intéressantes ! Ce qui m’attirait aussi, c’est de montrer des réalités étrangères à ce qu’on nous vend en permanence au sujet de la famille. Mes deux héroïnes sont davantage comme l’eau sur les rochers, elles tracent leur propre chemin : Anjum est une créature braillarde et généreuse et Tilottama est au contraire calme mais on pressent que si sa tête était tranchée, elle continuerait farouchement à réciter de la poésie, comme Hazrat Sarmad (2). Ce saint est essentiel pour moi : il est contre l’hégémonie, contre l’homogénéité. Il est celui qui ne veut pas que le cercle se ferme. Le croyant parmi les blasphémateurs et le blasphémateur parmi les croyants.
(1) Le Ministère du bonheur suprême, par Arundhati Roy, trad. de l’anglais (Inde) par Irène Margit, éd. Gallimard, 544 p.
(2) Hazrat Sarmad Shaheed ou Sarmad Kashani, marchand juif arménien qui s’est converti à l’islam, puis a renié l’islam orthodoxe. Rejetant tout dogmatisme religieux, il sera condamné à mort en 1661 pour ses écrits jugés hérétiques. Il est surnommé le Fakir nu. Arundhati Roy réexplique son histoire en détail au début du roman.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici