
« La Belgique a perdu sa confiance en elle lors de la Grande Guerre »

A jamais traumatisée par la Grande Guerre, la Belgique a renoncé à sa mentalité de conquistador pour se réfugier dans une stabilité faussement sécurisante. Une enquête historique explore les racines du mal-être économique belge.
Danger, chute d’emplois. Caterpillar, AXA Assurances, CP Bourg, Truvo (éditeur des Pages d’or), on en passe et des meilleures : la cadence a quelque chose d’infernal. Les charrettes sont de sortie, emplies de travailleurs remerciés en dépit de bons et loyaux services rendus au monde de l’entreprise. La série noire n’est peut-être pas que le fait du hasard. A croire qu’une malédiction ne lâcherait plus le pays, s’acharnerait à détruire sa prospérité à petit feu.
Deux historiens flamands spécialisés en économie versent à l’instant même une pièce au dossier. Un pavé de 500 pages (1) qui accompagne une Belgique, parvenue au stade de superpuissance industrielle au XIXe siècle, dans le long déclin économique qui la poursuit toujours.
Erik Buyst et Kristof Smeyers parcourent avec minutie un siècle de soubresauts et de mutations économiques pour comprendre comment deux guerres mondiales, un chapelet de crises et quelques révolutions technologiques ont pu avoir raison d’une splendeur industrielle et d’une dynamique conquérante. Comment la Belgique, faute de s’être configurée pour absorber des ruptures brutales, s’est transformée en un pays où » le changement de cap résolu ne va jamais de soi, est un concept creux. La Belgique est en état permanent de crise, dit-on avec une régularité d’horloge. Et cette horloge sonne la même heure depuis cent ans. »
» Le pays a perdu sa confiance en lui lors de la Première Guerre »
C’est dans la tête que tout se serait joué. Dans l’indépassable traumatisme vécu il y a cent ans de cela, lorsque le pays est sorti de la Première Guerre mondiale pillé, ruiné, exsangue. Mais surtout moralement et mentalement ébranlé. Cheville ouvrière du commerce mondial jusqu’en 1914, la Belgique éprouve brutalement la sensation angoissante de ne plus être qu’une petite partie d’un tout. Elle prend conscience que sa place dans le peloton de tête des grandes puissances économiques mondiales est désormais usurpée. Douloureux cheminement, aux funestes conséquences. » Le pays a perdu sa confiance en lui et son optimisme lors de la Première Guerre. Il s’est alors accroché à ses certitudes, s’est encapsulé pour se préparer au pire « , constatent les deux chercheurs.
Face à la peur du vide et à l’urgence de la situation, la Belgique se réfugie dans le réflexe apaisant du compromis. Ses acteurs politiques, économiques et sociaux, s’installent dans la culture de la concertation, manifestent un penchant pour les comités, les commissions et autres instruments de prévention des conflits, et multiplient les constructions légales, fiscales, institutionnelles. Comme autant de sacs de sable que l’on empile pour épargner au pays de nouvelles ruptures de digues.
» Ne résoudre les problèmes que lorsqu’ils se posent « , règle d’or de la gouvernance
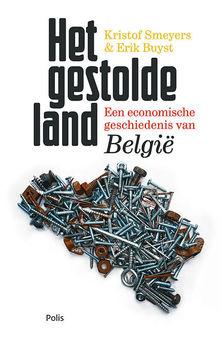
» La pacification lors de la reconstruction du pays a fortement mis l’accent sur la continuité et la stabilité. Le siècle passé montre ainsi un pays qui, après le traumatisme d’une guerre mondiale, ne s’est à nouveau ouvert qu’avec défiance « , prolongent les historiens. Ce goût prononcé pour le statu quo cadre mal avec les canons de l’économie moderne et de l’esprit d’entreprise qui n’ont que faire de la frilosité.
Or, la politique du bétonnage n’a qu’un temps puisque, rappellent les deux spécialistes, » le béton se fatigue à la longue « . » Ne résoudre les problèmes que lorsqu’ils se posent » devient une boutade érigée en art de gouverner et de gérer. La Belgique ne s’ébroue, ne se ressaisit que lorsque la pression extérieure se fait trop forte, lorsqu’il est bien souvent minuit moins cinq. Elle peine à se projeter et à s’inscrire dans la durée, hésite constamment sur la marche à suivre, opte pour la politique du » ni-ni « . » Son incapacité à choisir entre la main invisible du marché et l’économie planifiée a conduit le pays, au siècle passé, à courir après les événements, en contraste total avec la Belgique du XIXe siècle « , à la posture résolument avant-gardiste. Au fil du temps, la Belgique aurait ainsi perdu sa mentalité de conquistador des marchés pour se complaire dans ses clichés : un pays à la fiscalité écrasante, un paradis du travail au noir, un Etat endetté jusqu’au cou…
Se déroule, sous la plume des deux historiens, la trajectoire d’une Belgique figée, au milieu du gué, qui louvoie depuis un siècle entre stabilité et renouveau. » Les idées de réformes structurelles nécessaires ont toujours été présentes et n’ont jamais été mises en oeuvre de manière conséquente. » L’immobilisme est devenu un luxe que le pays ne peut plus s’offrir, à l’heure où l’économie mondiale a chaussé ses bottes de sept lieues.
(1) Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België, par Kristof Smeyers et Erik Buyst, (uniquement en néerlandais), éd. Polis, 512 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici